C’est à l’infini de la disponibilité « de l’encre et du papier en ce monde«
_ pour reprendre un élément crucial de la situation que se donnait Montaigne en sa Tour d’écriture (Essais, III, 9, De la vanité) _
que continue de s’affronter, avec une immense générosité, la tâche que s’assigne,
depuis en quelque sorte toujours
_ tel un destin passionnément et librement assumé, et cela dès sa toute première enfance, ainsi qu’elle même le note, page 124 de 1938, nuits : « Toute ma vie ou presque, j’ai pris des notes, je ne sais pas pourquoi avant d’écrire j’écrivais, déjà dans les années soixante _ ou plutôt bien avant ! _ je notais des phrases d’Omi ma grand-mère, je ne relisais pas, ce n’était pas de la littérature, je ramassais des feuilles encore vivantes, je ne laissais pas tomber » : voilà !.. : « ne pas laisser tomber » ; jamais : la tâche (et avec, bien entendu, ses reprises, afin de toujours mieux comprendre) est en effet proprement infinie… Comme l’écriture via ses relectures infinies (et ajouts, en encres diverses), de Montaigne… _
Hélène Cixous,
cette année-ci _ 2018, en sa maison d’Arcachon _
dans l’écriture _ plus que jamais miraculeuse _ de 1938, nuits (aux Éditions Galilée).
…
…
Á propos de la frénésie d’écriture qui prend certains auteurs _ tel (pas mal par accident : il lui fallait vider son sac, et donner à l’avenir le maximum de détails de son précieux témoignage de l’horreur nazie qu’il venait de vivre) ; tel un Fred Katzmann, en mars 1941 _ qui narrent leur Erfahrtung _ le très important concept benjaminien d‘Expérience _ de l’horreur subie,
Hélène Cixous écrit, page 33 :
…
« L’auteur _ Fred Katzmann, au mois de mars 1941, à Des Moines, Iowa _ ne voulait pas perdre une seconde de parole _ à prendre maintenant, ou/et à noter du passé récent, encore frais dans la mémoire, pour se défendre du gouffre terriblement effaceur de l’oubli qui le menaçait… _,
il n’y aurait jamais assez de papier en ce monde _ voilà l’expression montanienne _ pour décrire _ voilà ! avec un maximum de précisions ; et la tâche, bien sûr, est immense _ toute la vérité _ en sa pleine et plus riche extension possible _,
ça se voyait ce que l’auteur voulait faire, disons Fred : un mémoire _ Bericht _ qui ne négligerait pas un _ seul _ instant, pas une _ seule _ goutte de sang, pas une virgule acérée,
…
car ce fut le temps Unique dans l’Histoire,
certains ont tout oublié, certains se souviennent de chaque minute de l’Unique, personne ne sait avec exactitude ce que c’est qu’oublier, ce que les souvenants oublient, ce que les oubliants n’oublient pas, combien de temps dure l’oubli, le souvenir,
l’auteur se souvient-il une fois pour toutes afin de pouvoir _ enfin, lui, pour se remettre à vivre en mettant tout cela à distance vivable… _ oublier, » _ lit-on pages 33-34 ; on ne dira jamais assez combien la phrase-souffle d’Hélène Cixous est admirable !
…
…
Témoigner de cet Unique-là
constitue donc une nécessité et un devoir
absolus
pour les rares qui ont réussi à pouvoir en réchapper !
_ Primo Levi a dit, lui : Les Naufragés et les rescapés…
…
Et déjà pour ceux qui n’en réchapperaient pas _ lire ainsi, parmi tant d’autres témoignages d’outre-tombe sacrés,
l’admirable Des Voix sous la cendre…
…
…
Comme je l’ai, au passage pointé, dans mon article introductif d’avant-hier,
« 1938, nuits », ou dans la peau de Siegfried-Fred Katzmann (1912 – 1998) : le très véridique dialogue poursuivi à l’infini d’Hélène Cixous avec ses proches, qu’ils soient défunts, lointains, et même réticents jusqu’au mutisme,
…
cet opus-ci, d’Hélène Cixous, 1938, nuits,
est à certains égards une simple suite _ -poursuite _ à _ de _ son dialogue-conversation continué(e) _ infernalement poursuivi (et paradisiaquement enchanté) _ avec quelques uns de ses plus proches _ dont sa fille et son fils, au présent de l’écriture, l’été 2018 à Arcachon ; mais aussi ses défunts bien aimés (sa mère Ève Klein-Cixous et sa grand-mère Omi Rosie Jonas-Klein) avec lesquels la conversation se poursuit très intensément _ ;
…
et, au tout premier chef, pour commencer, bien sûr, sa mère, Ève Cixous, née Klein (Strasbourg, 14 octobre 1910 – Paris, 1er juillet 2013) _ la reine pour jamais des interlocuteurs vibrants d’Hélène _ :
une redoutable et plus encore hyper-efficace interlocutrice,
avec son formidable inépuisable allant et répondant ! Quel extraordinaire punch !!! jusqu’en ses 103 ans…
…
…
Mais aussi, en un peu _ ou beaucoup _ moins loquace _ et répondante _,
sa tendre et chère _ et infiniment discrète (via les épreuves traversées de profondes meurtrissures) _ grand-mère, Omi : Rosalie (Rosie) Klein, née Jonas (Osnabrück, 23 avril 1882 – Paris, 2 août 1977),
parvenue dare-dare, et tant bien que mal, et avec quelques bagages, et presque in extremis, chez les Cixous, à Oran, à la fin du terrible mois de novembre 1938 _ du moins à ce qu’il me semble pour ce qui concerne sa date d’arrivée à Oran ; il faudrait mieux le vérifier ; mais cela me semble être juste…
…
…
Et c’est à Osnabrück surtout _ mais pas seulement, bien sûr ; probablement à Dresde aussi ; du moins pour Omi (et sa sœur Hete-Hedwig, et son beau-frère, Max Stern) _
que s’est jouée une partie importante du sort tragique de la famille maternelle _ côté Jonas, pas côté Klein _ d’Hélène,
durant les terribles années du nazisme
_ Osnabrûck, qui ne venait tout juste de s’ouvrir à des résidents juifs que depuis deux années à peine, en 1880, lors de la naissance de Rosie, en 1882 ; très peu avant qu’y naisse, en effet, le 23 avril 1882, la petite Rosalie Jonas, au foyer d’Abraham Jonas (Borken, 18 août 1833 – Osnabrück, 7 mai 1915) et son épouse Hélène Meyer (décédée à Osnabrück le 21 octobre 1925) : oui, en 1880 seulement. Jusqu’alors les Jonas, juifs, vivaient un peu plus loin d’Osnabrück, à Gemen-Borken ; les Juifs étant demeurés jusque là indésirables comme résidents à Osnabrück…
…
…
Comprendre !
Oui, c’est bien là le maître mot de la vie et de l’œuvre _ d’écriture, poursuivie depuis toujours _ d’Hélène Cixous, face aux énigmes et mutismes du monde, y compris _ ou peut-être même surtout _ le plus proche.
…
…
Ainsi, page 101, Hélène Cixous se confronte-t-elle à l’énigme de « ceux qui ne sont pas partis« , voire « sont partis puis revenus » ; tel son grand-oncle _ « Oncle André« , le frère aîné d’Omi : il lui est, en effet, assez emblématique de pas mal d’autres, dont le parcours semble lui être demeuré un peu plus obscur _ Andreas Jonas _ dit « l’oncle André« par Ève _, parti en, puis revenu de, Palestine (ou Eretz-Israël) _ en 1936, après dispute avec sa tendre, pas si tendre que cela, fille Irmgard, qui vivait dans un kibboutz près du Lac de Tibériade, en Eretz-Israël _, se mettre « dans les mâchoires du Léviathan » (l’expression se trouve page 58 de Gare d’Osnabrück, à Jerusalem).
…
Page 58, mais cette fois de 1938, nuits, se trouve,
et à propos de Walter Benjamin _ dont le parcours a pu croiser celui de Siegfried Katzmann : peut-être « à Paris, en 1937, dans le café près de l’ambassade des États-Unis« , page 62 ; ou peut-être à une autre date (1935 ?) le doute demeure… _,
la phrase :
…
« Et pourquoi Benjamin reste ici où là _ réfugié en France _ jusqu’à ce que les dents du crocodile se referment sur lui _ cf sur son parcours si maladroit de fuite, le sublime Le Chemin des Pyrénées, de Lisa Fittko (paru aux Éditions Maren Sell, en 1987) _,
il a eu le temps d’écrire l’essai sur le charme des mâchoires… » ;
…
et page 107 :
« Il y en a qui partent, mais pas assez loin, c’est comme si on se déplaçait soi-même d’un KZ à un KZ,
quand Frau Engers va se réfugier à Amsterdam, c’est comme si elle venait cacher ses petits dans la gueule du loup » ;
…
et encore, page 116 :
« La grande Mâchine ouvre ses mâchoires et referme. Clac ! Cyclope amélioré » ;
…
et page 145 :
« la gueule de la mort« …
…
…
Ainsi, page 102, Hélène constate une fois de plus que
sa « mère _ Ève Cixous née Klein _ n’a jamais compris comment pourquoi sa _ propre _ mère Rosi Klein née Jonas ne comprenait pas » ;
quoi donc ? qu’il devenait _ en 1929, 1933, 1934, 1935, 1938… _ de plus en plus vitalement urgent de fuir ! Fuir, et au plus vite, et Osnabrück, et Dresde, et l’Allemagne. Fuir les mâchoires des Nazis !
…
Et Hélène en conclut _ et cela la chagrine passablement ! voire la poursuit… _ :
« je n’arrive pas à entrer dans l’intérieur d’Omi » ;
…
un peu plus loin, pages 109 à 119,
c’est « dans l’intérieur de Fred » que _ à défaut, donc, d’« entrer dans l’intérieur d’Omi » elle-même… _ vient
_ « mais faire Fred, c’est _ seulement, et par défaut… _ une excursion » (page 109), pour Hélène ;
même si c’est à cette principale et très essentielle, pour Hélène, fin de mieux comprendre (enfin ?) Omi, demeurée si longtemps en Allemagne, et se trouvant à Osnabrück (ou plutôt Dresde ? l’ambigüité demeure !) au mois de novembre 1938, dans la « mâchoire« des nazis !, qu’Hélène s’est décidée, ici à cette « excursion« qu’est « faire Fred« ! _
se placer l’auteure :
…
« Je n’aurais jamais pu m’imaginer que je me glisserais _ ici, et cet été 2018, dans l’écriture de ce 1938, nuits _ dans l’intérieur de Fred »
_ un personnage peu pris au sérieux de son vivant par Hélène, ni même, déjà, par sa mère, pour laquelle Fred n’était qu’un commode compagnon (sur le tard de leur vie de retraités) de voyage d’agrément de par le vaste monde… _,
même si « faire Fred, c’est _ seulement _ une excursion » _ j’insiste, j’insiste : soit seulement un détour de l’écriture et l’imageance, à défaut de (et afin de, surtout), mieux comprendre vraiment, enfin, Omi « de l’intérieur« .
…
…
Laquelle Omi, toujours page 102, « ne voyait pas _ vraiment _ qu’elle ne voyait pas _ avec lucidité _ ce qu’elle voyait » _ de ses yeux ; oui, ce qui pourtant, là, sous ses yeux, aurait dû lui crever les yeux ! faute de comprendre vraiment ce qui s’offrait, là, à sa vue, juste sous ses yeux (« je n’arrive pas à entrer dans l’intérieur d’Omi, Nikolaiort 2, par la fenêtre _ à Osnabrück « Nikolaiort 2, par la fenêtre« , du moins, comme c’est fort bien spécifié là, page 102 ; mais Omi ne se trouvait-elle pas bien plutôt alors à Dresde ? Il y a une ambiguïté persistante pour moi _ elle donnait _ voilà ! depuis sa fenêtre de la maison osnabrückienne des Jonas _ sur l’horlogerie-bijouterie Kolkmeyer NSDAP en chef, elle ne voyait pas qu’elle voyait la bannière du Reich pendre jusqu’au sol, elle ne voyait pas qu’elle ne voyait pas ce qu’elle voyait « , page 102, toujours), mais bêtement (sans vraiment voir !), ce qui crevait pourtant les yeux d’autres un peu plus lucides qu’elle, Rosie ; mais pourquoi ? Faute d’en échanger un peu, si peu que ce soit, là-dessus avec d’autres ? Et de « s’entrecomprendre« (le mot est prononcé page 101) avec eux ?.. Manquant cruellement de la plus élémentairement vitale lucidité, par conséquent.
…
…
Et je poursuis l’élan de la phrase que je viens de commencer à citer :
…
« Depuis 1938, elle ne voyait ni 1933 ni _ se profiler très vite, sofort... _ 1942
_ et la mort à venir à grands pas, cette seule année 1942, à venir si vite, de deux de ses frères et de deux de ses sœurs (à part l’oncle André, mort à Theresienstadt le 6 septembre 1942, je n’ai pas encore réussi à identifier de quel autre des frères Jonas et de quelles deux sœurs nées Jonas d’Omi, il s’agit là (même si son beau-frère, le mari de sa sœur Hete-Hedwig, Max Stern, le banquier, est effectivement décédé à Theresienstadt en 1942 (le 8 décembre 1942)… ; manque ainsi, pour les Jonas, l’éclairage d’une généalogie, telle celle donnée pour les Klein, aux pages 193-194, dans le cahier final, avec aussi des photos, de Photos de racines)… _,
une femme si distinguée« …
…
…
« Tu m’écoutes ? dit _ une page plus loin, page 103 _ ma mère _ décédée depuis cinq ans (le 1er juillet 2013), cet été de l’écriture de 1938, nuits _,
à ces mots je me réveille de ma rêverie éloignée,
je n’ai pas écouté, quand ma mère me raconte _ le verbe est bien au présent ; c’est que la conversation avec Ève, décédée, oui, depuis cinq ans, se poursuit très effectivement ; Hélène converse bien et régulièrement avec elle ; même si c’est non sans de menues intermittences, qui ne manquent pas d’angoisser, voire de mettre en colère, Hélène (cf l’épisode narré à la page 10 du voyage en Cadillac d’Ève et Fred, à partir de Des Moines (en 2000)… _ la famille Flatauer, les Nussbaum _ de futurs assassinés d’Osnabrück _,
plus tard je ne pourrai _ si le fil, coupé, est perdu _ plus jamais remonter le temps _ pour, le retrouvant, en écrire-témoigner de ce qui a été autrefois si précieusement mais fragilement témoigné par quelques uns, parfois même un unique (cf Carlo Ginzburg : Un seul témoin ; où est superbement analysé et merveilleusement commenté l’adage du droit : Testus unus, testus nullus… _
et à jamais je ne saurai pas comment finit l’histoire _ de ces personnes-ci, dont les noms prononcés n’ont pas été, une fois le fil de témoignage rompu (ne serait-ce que par inattention ou distraction), retenus, c’est-à-dire sauvés !.. (…)
…
Dans L’Iliade, tous les noms sont sauvegardés _ voilà ! par le récit, qui les retient, d’Homère _,
ici dans le poème effiloché _ magnifique expression ! _ d’Osnabrück, il y a des trous _ des lacunes ;
cf mon article du 17 juillet 2008 sur mon blog En cherchant bien, de la librairie Mollat : lacunes dans l’Histoire : à propos de l’enquête menée à Objat, en Corrèze, par Jean-Marie Borzeix en son passionnant Jeudi saint, à propos de Juifs raflés par des nazis en 1944… _ partout,
on n’écoute pas _ le constat est assez général, et assez significatif, si l’on y réfléchit trois secondes ; si vient à manquer quelque témoin narrateur… ;
…
cf aussi, à propos de ce travail pour inlassablement combler les lacunes voulues par les assassins,
le magnifique travail du Père Patrick Desbois en son indispensable Porteur de mémoires… _,
…
quarante ans nous séparent,
pas seulement entre temps et générations,
dans la rue même, dans la maison, à table,
il y a toujours ces épaisseurs _ quelle écriture admirable ! et quelle justesse du penser ! _ entre nous _ qui ne nous entrecomprenons pas assez ! à la façon des idiosyncrasiques monades de Leibniz, qui n’ont « ni portes, ni fenêtres« … _,
…
Omi n’écoute pas ma mère _ sa fille Ève, si pragmatique, invariablement, elle _,
…
ces larges étendues neutralisées qui entourent le moi d’une bande _ formidablement dangereuse _ d’indifférence _ anesthésie, cécité, surdité, inattention coupable, imbécile légèreté… : quelle qualité phénoménale d’expression ! _,
…
même la manifestation _ nazie _ de 1935 qui rassemble 30 000 Osnabrücker sur la place Ledenhof, c’est-à-dire toute la ville en âge de s’exprimer, ne propage pas jusqu’aux tympans de l’âme _ celle seule à même de comprendre vraiment les signaux (muets, hors discours) qui parviennent du corps _ son effroyable vacarme de mort
_ mais Omi se trouvait-elle alors à Osnabrück, au Nikolaiort 2 ? ou bien plutôt à Dresde ?.. _,
on n’écoute pas les nazis disent certains, on n’écoute pas les Juifs,
on n’écoute personne » _ voilà la terrifiante erreur, qu’il faudrait encore et toujours et en permanence avec le plus grand soin méditer : s’entrécouter et « s’entrecomprendre« vraiment les uns les autres…
…
…
Ici, sur la mécompréhension,
et les terribles difficultés à « s’entrecomprendre » _ le terme, capital !, apparaît, en hapax, au bas de la page 101 _,
je veux remonter un tout petit peu plus haut, aux pages 100-101 :
…
…
« Mais on n’entendra jamais les réponses ou les explications de ceux-qui-ne-reviennent-pas à Osnabrück
parce qu’ils ne sont pas _ du tout _ partis _ et se sont bientôt trouvés pris, capturés, puis massacrés, enfermés-englués qu’ils étaient dans la nasse
(ou « la cage« , ou « le coffre, le Safe… », page 76, et c’est alors Ève qui parle avec une ironie acerbe)
refermée (« Clac !« ) sur eux.
…
Les Nussbaum, par exemple ? Et les Jonas. Et Raphael Flatauer ?
…
…
C’est à ceux-là _ les massacrés, privés de tombes, ceux-là, avec leurs noms gravés dessus _ que je m’adresse depuis des années
_ clame ici Hélène : au moins depuis l’écriture d’Osnabrück, en 1998 _,
…
à ceux qui sont restés _ encalminés, poissés, à quai _ quand leurs amis _ tel son ami Gustav Stein pour Andreas Jonas, le 23 octobre 1935 (voir les deux terribles tranquilles photos du cahier final de Gare d’Osnabrück à Jérusalem… _ ont commencé à partir,
…
…
ceux qui ont accompagné leurs enfants ou leurs frères à la gare d’Osnabrück _ un lieu éminemment stratégique : la voie de salut de la fuite ; et ce n’est évidemment pas pour rien qu’un volume suivant d’Hélène Cixous, écrit l’été 2015, s’est intitulé Gare d’Osnabrück à Jérusalem ! _ … _,
…
…
ceux qui ont regardé _ du quai _ partir _ sans eux, qui restaient _ les trains vers toutes les directions de correspondance avec la France ou avec Amsterdam, car Osnabrück est un nœud ferroviaire (…),
ils sont restés sur le quai ils ont agité la main et souri (…),
…
et en rentrant à pied de la gare à Nikolaiort _ que surplombe, au n°2, la belle, large et haute demeure des Jonas (Abraham, puis son fils aîné Andreas) à Osnabrück _,
que pensait _ donc, en son for intérieur _ Omi ma _ discrète et intériorisée _ grand-mère? (…),
…
…
ceux qui sont rentrés « à la maison« , alors qu’objectivement on ne pouvait plus rentrer à la maison,
…
…
je ne cesse de me dire que je ne les comprends _ eux tous _ pas
_ et ce point-là est bien sûr décisif ! Et mieux encore : carrément obsédant-torturant pour Hélène.
…
…
Et pourquoi mon esprit revient-il _ en effet ! _ depuis tant d’années _ obstinément _
cogner à la vitre _ trop muette _
de cette scène ?«
_ quelle langue admirable ! Nous sommes confondus d’admiration !
Et nous nous reporterons aussi, j’y insiste, au terrible (en sa pleine assassine innocence) cahier de photos offert en conclusion de Gare d’Osnabrück à Jérusalem, après la page 160 :
…
aux deux terriblement innocentes photos d’adieux d’Andreas Jonas à son ami Gustav Stein, le 23 octobre 1935, sur le quai de la gare d’Osnabrück….
…
…
Avec ce nouveau terrible constat de l’auteure, aux pages 101-102 :
…
« Selon moi, les Juifs d’Osnabrück fin 1938 ne comprennent pas _ non plus _ les Juifs 1940,
…
les Juifs selon les dates _ à nouveau quelle sublime cixoussienne expression ! _ s’entrecomprennent _ et ici plus encore !!! _ de moins en moins,
…
ils se font des signes _ mais pas assez parlants ; ou sans les bonnes phrases (d’un peu lucide avertissement ; ou de vraie compréhension rétrospective des tenants et aboutissants de l’idiosyncrasie, toujours complexe, des diverses situations…) ! _ sur les quais des trains, sur les montagnes, sur les rives,
…
ils s’appellent,
…
ils ne s’entendent pas »
_ faute de pouvoir déplier vraiment, en phrases, et en phrases effectivement prononcées, et si possible aussi vraiment entendues, leurs pensées et arrière-pensées, demeurant ainsi non pensées, faute d’être exprimées dans de vraies phrases, réellement déployées, et réellement échangées, et réellement entendues, c’est-à-dire vraiment comprises.
Mais était-il seulement possible de se représenter un peu lucidement en 1938 ce qui adviendrait en 1940 ? L’uchronie ne peut être hélas que fantasmatique ; et ne peut décidément pas être efficacement à 100 % prospective…
…
Une part, même si ce n’est pas le principal, du processus de la tragédie, réside aussi là : réussir à « s’entrecomprendre« vraiment.
…
…
Ainsi, page 104, Hélène conclut-elle que
« jusqu’en 1938, Omi ne s’est pas _ vraiment _ rendue compte _ de la réalité d’Osnabrück (ou peut-être de Dresde) et l’Allemagne sous Hitler _,
sinon elle serait partie avant« …
…
…
Mais _ et cela sans cuistrerie, ni lourdeur, aucune _ un concept plus précis va bientôt apparaître et intervenir, cependant, dans l’intelligence un peu profonde de ce qui fut,
…
et via un auteur
avec lequel un des personnages, Siegfried Katzmann, a tenté d’établir un contact,
par lettre adressée à Vienne, probablement en 1938, mais hélas un peu trop tard _ Freud va quitter Vienne (pour gagner Londres) le 4 juin 1938 _,
en vue d’en recevoir un conseil ;
…
et lui aussi, Siegfried-Fred Katzmann, est peut-être, au moins alors, victime de ce que Hélène qualifie magnifiquement, page 95, de « démon du contretemps«
_ quelle sublime expression, ici encore ! _
…
auquel, presque tous _ ajoute-t-elle _,
« nous obéissons comme des insensés« ;
…
sauf Ève, toujours si lucide-réaliste-pragmatique, vive, et surtout prête, elle :
« ready, the readiness is all« , aime-t-elle proférer ;
même si elle attribue à Heine ce qui revient à Shakespeare (Hamlet, V, 2), page 10 de 1938, nuits :
…
cet auteur qu’a effectivement cherché à joindre par lettre Siegfried Katzmann
_ mais sans en obtenir de réponse : le « démon du contretemps« ayant cette fois encore, en 1938, frappé ! _
étant Sigmund Freud
_ Freiberg (aujourd’hui Příbor, en Moravie), 6 mai 1856 – Londres, 23 septembre 1939.
…
À suivre…
…
…
Ce mercredi 6 février 2019, Titus Curiosus – Francis Lippa
news and informations automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travelautomotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel
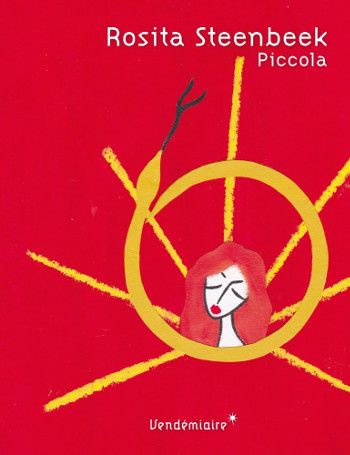 …
…