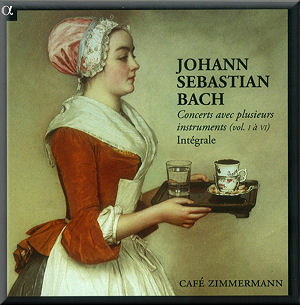Texte intégral
…
…
Q – Bonjour, Clément Beaune.
R – Bonjour.
Q – Merci d’être avec nous. Puisque cette émission s’appelle « Les enfants de la République« , la question que je pose chaque dimanche à tous les invités de cette émission, c’est : qu’est-ce que représente la République, pour vous, Clément Beaune ?
R – Une chance de vivre ensemble, de pouvoir s’élever, se sortir, soit d’un milieu, soit d’une condition, et d’avoir une liberté, de choix, de vie, et d’être ensemble, dans cet esprit exigeant, parce que j’associe beaucoup la laïcité à la République, cela ne la résume pas, mais cela en fait partie, je crois, et c’est une forme d’exigence d’être ensemble.
Q – Pour commencer cette émission, on va parler un peu de vous, Clément Beaune. Vous êtes quelque part un enfant de la génération Mitterrand, puisque vous êtes né en août 1981, quelques mois après la victoire du 10 mai 81. Cette époque, ces années Mitterrand, cela a compté pour vous, Clément Beaune ?
R – Oui, beaucoup parce que c’était le Président de ma jeunesse, de mes quatorze premières années. Et dans ma famille, on s’intéressait à la politique, sans être actif, mais on était très intéressé par l’actualité politique. Et quand le Président de la République, quand François Mitterrand s’exprimait, on le regardait. Mes parents l’aiment bien. Donc, il y avait une forme d’attachement….
Q – Vos parents étaient socialistes ?
R – Oui, mon père avait été militant socialiste. Il ne l’était plus quand j’étais jeune, mais il était électeur socialiste et mitterrandien. Et donc, pour moi, il y avait à la fois une forme d’autorité, c’était le souvenir, quand j’étais jeune, parce que sans doute, on a une image d’enfant : je trouvais qu’il parlait avec une forme de sagesse, de lenteur. On regardait ses interventions. Moi, cela me fascinait un peu.
Q – Mais vous étiez tout jeune, alors.
R – J’étais tout jeune, je ne comprenais sans doute pas tout, mais il y avait une espèce de respect, d’affection, d’autorité qui s’en dégageait. Et puis, j’avais vraiment l’impression, parce que j’ai pris conscience de la vie politique, de l’actualité, à la fin des années 80, qu’autour de nous, avec François Mitterrand, mais plus largement en Europe, notamment, il se passait quelque chose, il y avait un mouvement.
Q – Ces mouvements, c’est après la chute du Mur. Mais François Mitterrand, quarante ans après le dix mai, vous en gardez quelle image ? Puisque depuis Mitterrand, vous avez eu Chirac, Sarkozy et Hollande, maintenant Emmanuel Macron. C’est un président qui aura marqué son temps, l’histoire ?
R – L’image rétinienne, si je puis dire, pour moi, c’est Mitterrand et Kohl, la poignée de main. Pas seulement parce que je m’intéresse à l’Europe…
Q – Donc la poignée de main à Verdun.
R – La poignée de main à Verdun en 84, je crois. Parce qu’après, dans beaucoup de circonstances, on me l’a décrite ; les circonstances, c’était un geste spontané et c’est lui qui l’a initié. Cela représentait…
Q – Donc c’est l’Europe.
R – C’est l’Europe, c’est la réconciliation. C’est littéralement la main tendue. C’est le sens de l’histoire. Moi, ce que je retiens de Mitterrand, c’est le sens de l’histoire par la grandeur, la vision de la France, la capacité à avoir cet attachement à la grandeur, à la vision, à la souveraineté, tout en acceptant de surmonter, pour lui-même, qui avait été jeune pendant la guerre – on connaît son passé avec ces zones d’ombre aussi, mais qui, malgré tout, était un enfant de la guerre.
Q – Donc c’est les ombres, et les lumières….
R – Bien sûr, les ombres et les lumières. Parce que j’ai aussi fait partie – c’était un peu mon éveil au débat politique…
Q – Donc, quand on parle d’ombres – pardon mais on précise les choses -…
R – Bien sûr, la Jeunesse française, avec Pierre Péan…
Q – Sa rencontre avec Pétain et puis son amitié avec Bousquet.
R – Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, j’avais, je crois, quand le livre de Pierre Péan est sorti, 12 ou 13 ans. Et donc, sans doute, là encore, je ne comprenais pas tout ce qu’il se jouait, mais je voyais que l’image était écornée, que l’on avait un débat sur l’histoire. Mais malgré tout, je garde tout de même, sans illusion, avec lucidité, l’image d’un grand président. Et avec ce sens du temps long, de prendre son temps, de maîtriser les choses qu’il dégageait.
Q – C’est lui qui avait eu cette formule : il faut laisser du temps au temps. Et alors ce qui a marqué votre jeunesse, vous le rappeliez il y a quelques instants, c’est la période 89/90, avec notamment la chute du Mur dans la nuit du 9 novembre 1989. Vous en avez quel souvenir ? Et puis, c’est peut-être d’ailleurs à partir de ce moment-là, que vous êtes vraiment intéressé à l’Europe ?
R – Ce n’est jamais une révélation comme ça. Cela sème une graine en quelque sorte… Mais j’étais tout jeune, j’avais huit ans. Absolument, mais j’ai le souvenir bien sûr de ces images. On m’expliquait ce qui se passait. Je comprenais que c’était important. Pour tout vous dire, mes images politiques de cette période-là, c’est plutôt, bizarrement, la révolution roumaine. J’ai le souvenir, je crois, Noël 89, l’hiver 89.
Q – Donc la chute de Ceausescu.
R – Oui, la chute de Ceausescu, la violence aussi, mais la chute d’une dictature, la mobilisation populaire, ces images de souffrance, d’une vraie révolution, qui avait une sorte de puissance d’évocation, et d’impression de mouvement massif, de liberté, avec aussi la violence qui s’accompagne…
Q – Et qui a débouché sur un faux procès.
R – Qui a débouché sur un faux procès effectivement, sur l’exécution, sur des fake-news aussi effectivement.
Q – Avec Timisoara.
R – Oui, Timisoara. Pour moi, 89, c’est d’abord ça. Et puis vous parliez du Mur de Berlin. C’est ensuite pas tant novembre 89, dont j’ai un souvenir, pour être honnête, assez vague personnellement, mais le fait que mes parents m’aient emmené à Berlin l’été 90.
Q – À Berlin.
R – Et j’ai vu le mur qui était cassé, encore debout, mais cassé, ouvert.
Q – Et donc vous avez ces images en mémoire.
R – Ah oui, j’ai ces images très claires, ces photos… des bouts de Mur d’ailleurs, que l’on a gardés dans la famille. Mes parents ont eu cette envie ou cette intuition qu’il fallait me montrer ce que c’était – pas encore une capitale – cette ville européenne coupée en deux, déchirée, réouverte, et tout ce qui s’en accompagnait, les grues qui reconstruisaient déjà, un sentiment d’immensité, parce que vous aviez cette zone au milieu de la ville qui s’ouvrait à nouveau. Et là encore, l’impression qu’il se passait quelque chose, et quelque chose de bon, de positif.
Q – Et je crois que vous avez visité d’autres pays, notamment des pays de l’Est, et aussi l’Italie, à ce moment-là.
R – Oui, parce que mes parents m’emmenaient souvent l’été en voiture. C’étaient des trajets assez longs, par étapes, vers d’autres pays européens. Donc, c’est peut-être comme cela d’ailleurs, que sans que je ne m’en rende compte à ce moment-là, mon goût de l’Europe qui, comme dit Steiner, se parcourt à pied. Moi, je la parcourais en voiture, mais je voyais bien qu’à quelques dizaines ou centaines de kilomètres, tout au plus, on changeait de langue, on changeait un peu d’architecture…
Q – Et on changeait quelque part de monde, aussi ?
R – Et on changeait de monde. J’ai d’ailleurs, en 90, été encore – puisque la réunification n’était pas faite – en Allemagne de l’Est. Et j’ai vu ce que c’était que les cantines d’autoroute… L’Allemagne de l’Est, ce n’était pas le même monde. Pour un enfant qui est habitué à l’Ouest, si je puis dire, ce n’est pas le même monde.
Q – Et la Tchécoslovaquie.
R – La Tchécoslovaquie… Mes parents m’ont emmené en 92 en Tchécoslovaquie, donc après la chute du communisme, mais avant d’ailleurs la partition. J’ai le souvenir d’une Prague encore très sombre, très noire, des immeubles qui avaient les impacts d’ailleurs des événements de 68, mais aussi des immeubles pas rénovés. Une ville très noire.
Q – C’est vrai que cela a changé, depuis.
R – Cela a changé beaucoup. Et je suis allé aussi à ce moment-là en Hongrie. J’ai eu la même impression, un peu partout en Europe de l’Est.
Q – Ensuite 95 : fin de l’ère Mitterrand, Clément Beaune, et début de l’ère Chirac, avec le 16 juillet 95, l’un des moments les plus forts de son mandat présidentiel, avec la reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des juifs de France. Vous avez un souvenir précis, Clément Beaune ?
R – Oui, j’ai le souvenir – là aussi, on me l’expliquait sans doute encore, même si j’étais plus âgé -, mais je comprenais mieux. Il y avait dans ma famille, pour être honnête, l’image, puisque l’on avait beaucoup aimé Mitterrand, que Chirac, c’était une autre ère et que c’était un changement qui n’était pas un moment heureux dans ma famille sur le plan personnel et politique. Mais ce discours-là avait donné de la grandeur et une forme de tournant, qui je crois d’ailleurs – quand le président Chirac s’est éteint, il y a quelques mois – que quand on pense à Jacques Chirac, aujourd’hui encore, on pense d’abord au discours du Vél d’Hiv. Et je sais que les débats – c’est d’ailleurs intéressant, parce qu’aujourd’hui, il y a une forme de consensus -, à l’époque…
Q – De consensus, et on se souvient que Mitterrand ne voulait pas du tout…
R – Ne voulait pas…
Q – Sur le fait de devoir reconnaître la responsabilité des crimes de Vichy…
R – Oui, parce que cela n’était pas la continuité de la France et de la République. Ce débat existait à l’époque. Et d’ailleurs, il ne faut pas le caricaturer : il y avait des arguments, si je puis dire, pondérés dans les deux sens. Mais néanmoins, Jacques Chirac a fait cet acte qui, je crois, à ce moment-là, cinquante ans, quarante ans après la libération, avait – cinquante ans, pardon, après la libération – avait besoin de se poser, de reconnaître aussi, parce que la France devait regarder son passé – on était justement après les révélations du début des années 90, les grands procès – devait faire, je crois, cet acte de rupture, de responsabilité et de transmission aussi. C’était une façon de dire – je ne sais pas si c’était son intention, mais moi, comme jeune, je le prenais comme une forme de responsabilité pour nous. Il fallait comprendre ce qui s’était passé, ne pas le refaire.
Q – Peut-être que vous avez eu cette réaction aussi, parce que vos arrières grands-parents, les Naroditzky ont fui l’Ukraine et sont arrivés à Marseille dans les années 1910 à cause des pogroms tsaristes. Ils ont fui l’Ukraine à cause de l’antisémitisme et des massacres tsaristes.
R – Oui, c’est vrai. J’ai une famille – la génération de mes arrières grands-parents, qui étaient établis à Odessa, dans ce qui était encore l’Empire russe, mais dans l’Ukraine actuelle, et qui ont fui avant la révolution, qui ont fui les pogroms, et qui _ en 1910 _, en passant par la Méditerranée et l’actuelle Turquie, sont arrivés à Marseille. Et c’est une histoire, comme la raconte un peu Henri Verneuil dans Mayrig, que je trouve un sublime récit…
Q – Donc un parallèle entre les Arméniens et les Juifs, à ce moment-là.
R – Oui, parce que c’était les communautés qui fuyaient une persécution, déjà, qui trouvaient refuge en France, avec un grand dénuement. C’était une famille très nombreuse. Ils étaient neuf enfants. Certains sont nés en France après leur arrivée, mais la plupart étaient déjà nés, et qui a trouvé dans la France un espoir immense qui n’a pas d’ailleurs été déçu, et une exigence, là aussi, immense. C’est pour cela que je faisais ce lien avec la République. Pour eux, cela voulait dire quelque chose. La France, c’était la République française. C’était l’école, c’était la langue. Ils tenaient absolument à ce que leurs enfants ne parlent pas leur langue, mais apprennent tout de suite, à marche forcée, le français, pour s’intégrer.
Q – Parce que vos arrière-grands-parents _ Naroditzky _ parlaient le russe et le yiddish à la maison.
R – Je crois qu’entre eux, ils parlaient russe et yiddish, surtout russe ; et ils n’ont pas voulu que leurs enfants continuent à même utiliser la langue à la maison pour s’habituer et apprendre vite le français, parce que pour eux, c’était la liberté, l’intégration.
Q – Pour vous parler de cette émission, en préparant cette émission, je suis allé voir sur le site du mémorial de la Shoah et j’y ai appris – on apprend – que votre arrière-grand-père, Israël Naroditzky, qui est né le 18 janvier 1876 à Odessa, a été déporté par le convoi 67 du 3 février 1944 et il a été gazé à Auschwitz _ le 8 février 1944, il venait d’avoir 68 ans.
R – Oui. Vous m’apprenez les dates. Je savais évidemment sa déportation, celle de tous les hommes de la famille, d’ailleurs, lui, ses deux garçons, ses deux fils. Les sept autres enfants étaient des filles qui ont échappé – c’est aussi une histoire française : ce sont des gens qui se sont intégrés, qui venaient d’ailleurs, qui ont trouvé dans la France cet accueil, qui ont vécu l’antisémitisme. Et je crois – je crois, parce que je n’ai que des récits, pudiques d’ailleurs, et parcellaires – qu’ils l’ont vécu durement, mais que pour eux, cela n’entachait en rien leur amour de la France, mais pendant la guerre, ils ont vécu la dénonciation et la déportation…
Q – Dénonciation, donc, ils ont été dénoncés. Ils vivaient à Marseille et donc ils étaient, ils ont été déportés. Et je ne sais pas si j’ai raison, mais j’ai l’impression qu’il y a une certaine émotion chez vous, quand vous parlez de cette filiation.
R – Oui, parce que, à la fois, elle a toujours été dans la famille et dans ma construction personnelle, et on en parlait peu.
Q – Un non-dit, un tabou.
R – Oui, un non-dit, une pudeur, sans doute un sentiment, parce que beaucoup d’autres, dans la famille, qui heureusement ont été sauvés, n’ont pas été d’ailleurs inquiétés ou déportés, mais s’étaient cachés, pour éviter cela, et ont changé d’identité. Donc, il y avait beaucoup de – et je le comprends d’ailleurs, pour cette génération, celle de ma grand-mère Rose – de volonté, non pas de cacher, mais je crois, de garder une réserve, d’avoir un sens du secret parce qu’ils avaient été marqués par cet épisode où ils avaient dû faire des faux papiers, trouver une famille d’accueil… trouver aussi beaucoup de générosité, en même temps que d’autres avaient fait face à l’horreur de la dénonciation puis de cette déportation…
Q – Avec quand même, quelque part, d’après ce que je comprends, une transmission familiale.
R – Oui.
Q – Transmission familiale autour de la vigilance, autour de la déportation.
R – Oui, parce que tout de suite, très vite, je ne me souviens plus quand, mais j’ai toujours su cette histoire, de venir d’une famille juive qui ensuite, n’était plus pratiquante. Pour moi, cela voulait dire d’abord l’histoire, parce que je n’avais pas une éducation ni religieuse, ni même culturelle, si je puis dire, de cette famille, de cette histoire dont je connais peu de choses encore aujourd’hui. Mais une forme de leçon que ma grand-mère notamment – qui par ailleurs vivait dans mon immeuble, donc que je voyais beaucoup – me transmettait. Ce n’était pas une sorte de leçon professorale, comme on dit à un enfant, fais attention ! Elle n’avait pas besoin de le dire. Elle disait ce qui s’était passé, qui me paraissait à la fois une évidence, parce qu’elle me l’a dit tout petit.
Q – Elle vous disait quoi. Comment elle vous le disait ?
R – Comme quelqu’un… comme cela, comme un récit, simple…
Q – Elle portait une plaie en elle ?
R – Sûrement, mais elle ne se plaignait jamais. Il n’y avait ni rancoeur personnelle, ni aucune – cela, je ne l’ai jamais ressenti – ni aucune rancoeur vis-à-vis de la France, de la République ; au contraire, une immense reconnaissance. Jamais, ils n’ont pensé quitter le pays, ou lui en vouloir, même s’ils savaient ce qui s’était passé, ce que leurs proches, en France, à Marseille, avaient fait.
Q – Alors l’histoire de votre famille, c’est l’histoire aussi de l’intégration, quelque part ?
R – Complètement d’ailleurs, des deux côtés.
Q – D’une intégration.
R – D’une intégration de ces migrants, comme on dit aujourd’hui – je n’aime pas ce terme, parce que cela donne une impression administrative – qui ont trouvé, encore une fois, cette chaleur et cet accueil. Avec les errements et aussi les comportements affreux de certains. Ils ont connu cela dans ces périodes-là, comme on voit le pire et le meilleur de l’humanité. Puis de l’autre côté, d’ailleurs, du côté de mon père, c’est une histoire républicaine aussi, parce que c’est une histoire d’agriculteurs devenant instituteurs, devenant pharmaciens, devenant professeurs…
Q – La méritocratie républicaine.
R – Oui, j’en ai une – et j’ai grandi là-dedans d’ailleurs – une immense reconnaissance à l’égard de l’école, en particulier, de l’Etat, si je puis dire. J’aime ce mot, sans avoir de naïveté sur le fait que cela ne se passe pas comme cela pour tout le monde, bien sûr. Mais je crois que ces histoires, parfois c’est dans sa famille, parfois c’est chez un voisin, dans un livre, on en a besoin parce que cela nous montre que ce n’est pas systématique, mais que cet espoir est possible et qu’il y a peu d’endroits au monde où il a été possible et où il l’est encore.
Q – C’est que quelque part, le modèle français ?
R – Oui, c’est le modèle français dont je connais… Le défendre, ce n’est pas nier ses failles. Ce n’est pas nier ses dysfonctionnements, au contraire. C’est avoir un attachement si profond qu’on doit essayer de le réparer, de le défendre parce que nous l’avons vu au moment de, encore, l’assassinat du professeur Samuel Paty, des attaques contre la laïcité. On doit l’expliquer, le défendre. Moi, s’il y a une chose pour laquelle je me battrai, c’est cette exigence de la République et cette liberté qu’elle nous offre.
Q – Alors vous êtes, quelque part, Clément Beaune, un symbole de la méritocratie républicaine. Vous avez fait Sciences Po, le Collège d’Europe de Bruges en Belgique, puis l’ENA, promotion Willy Brandt. Est-ce que le problème de la France, l’un de ses problèmes aujourd’hui, c’est que l’on déteste ses élites et que l’on ne respecte plus les élites, et notamment les enseignants ?
R – Cela existe. Oui, mais c’est un symptôme.
Q – Un symptôme de quoi ?
R – Un symptôme d’une société qui n’a pas su assez – je pense que justement, on a considéré que c’était des notions désuètes, l’école, la République, la devise, le drapeau. Moi, je suis, par mes fonctions et par mon engagement, un européen convaincu, précisément parce que j’aime la France et je pense que c’est une chance pour nous. Cela n’enlève pas un gramme de mon attachement viscéral à cette identité, à ces symboles, à ces lieux de mémoire, comme on les dit au sens de Pierre Nora. Et je crois qu’on ne les a pas assez défendus. Ce sont des petits renoncements, des petites lâchetés, dans la vie quotidienne, dans la relation entre les hommes et les femmes, dans la tolérance, dans le rapport à l’autorité, aux professeurs en particulier _ oui… Donc oui, cela existe. Je ne veux pas jouer – mon jeune âge encore ne me le permet pas – au vieux con, si je puis dire, mais c’est de tout âge de défendre cette idée. Encore une fois, cela passe d’abord par l’école _ oui, et c’est crucial…
Q – Cela passe d’abord par l’école. Mais alors, est-ce que quelque part, les intellectuels jouent encore leur rôle, on va dire, de lanceurs d’alerte, peut-être aussi de transmetteurs des valeurs républicaines ?
R – Pas assez ; pas assez, je crois. Quand vous avez eu d’ailleurs ces violences, ces débats, après l’affaire Samuel Paty, ce drame qui nous a beaucoup marqué, très peu ont relancé des débats intellectuels sur la laïcité, ont défendu l’Etat, ont défendu l’école. Heureusement, quelques voix. Parfois, elles sont décriées, elles sont vues comme presque conservatrices. Quand Caroline Fourest fait son travail, que je considère remarquable, de défense de la laïcité, de l’égalité entre les hommes et les femmes, qui en fait partie, elle fait une oeuvre utile, mais elle est menacée. Elle est attaquée. Je prends cet exemple mais on peut en trouver quelques autres, et heureusement. Est-ce qu’elle est aujourd’hui vue comme une figure du débat intellectuel soutenue par tous ? Non. Et je ne dis pas que cela a été mieux dans d’autres périodes. Dans les années 80, on voyait des manifestations sous les fenêtres de Robert Badinter. Ma grand-mère me disait d’ailleurs, elle-même, dans les années 60-70…
Q – Votre grand-mère, Rose ?
R – Rose, oui, dont on a parlé tout à l’heure. Elle me disait qu’elle avait été une fois dans un taxi, où le chauffeur de taxi lui avait dit, je ne sais pas comment, mais peu importe, « les juifs, je les sens à deux kilomètres« . Elle est sortie. Donc, je veux dire, n’idéalisons pas.
Q – C’est comme le » vieil homme et l’enfant « …
R – On a été sans doute un peu trop faible.
Q – Par rapport à la défense de la laïcité ?
R – Oui, on le sait. Le drame des démocraties, c’est d’arriver à être libre sans être faible. Leur immense avantage, mais leur fragilité, c’est ça.
Q – Alors, justement dans l’actualité, il y a un fait qui a un certain lien avec ce que vous dites. Le maire d’Ollioules dans le Var, a voulu rendre hommage au professeur Samuel Paty, décapité le 16 octobre dernier par un terroriste islamiste. Il a voulu lui rendre hommage en donnant son nom au collège de sa commune. Mais voilà, le maire a dû renoncer à ce projet. Pourquoi ? Parce qu’une partie non négligeable des professeurs, dont la responsable du CNES _ ou plutôt SNES ? _, Sandrine Olivier, et je cite son nom parce qu’il faut le citer, une partie aussi des parents d’élèves, ont refusé que cet hommage soit rendu à Samuel Paty à travers le fait que l’on donne son nom au collège. Pourquoi ? Parce que cette responsable du CNES a dit, je la cite « On ne veut pas que notre collège devienne une cible« . On ne veut pas devenir une cible. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
R – Il ne faut jamais renoncer. Après je ne veux pas personnaliser. Ce que je peux comprendre quand on est parent, quand on est professeur, c’est pour sa sécurité. Pour moi, c’est plus facile de vous le dire ici, pas de lâcheté. Mais je le pense profondément, on ne doit rien céder, même quand c’est dur. Mais la responsabilité des autorités républicaines, dans l’Education nationale, ailleurs, c’est de protéger aussi. Parce que sinon, on demandera à chacun de faire cet arbitrage. Il faut ce courage. Quand je parlais de petits renoncements… chacun, on a été menacé, et je ne donne aucune leçon parce que je n’ai jamais été une victime de quoi que ce soit, de très peu de choses. Donc, quand un professeur est menacé, je comprends qu’il ait peur dans sa chair.
Q – Je vais vous poser la question simplement, brutalement. Est-ce que quelque part, ce n’est pas de la lâcheté ?
R – Encore une fois, je ne veux pas que l’on renonce s’il y a un projet de cette nature à Ollioules, ou ailleurs. Il faut revenir, cela se posera ailleurs, il faut le défendre. Il ne faut jamais céder. Mais il faut que l’on se donne les moyens de protéger. Parce que si un professeur, on ne peut que le déplorer, est menacé parce qu’il défend, parce qu’il enseigne sur la Shoah, parce qu’il défend la liberté d’expression, et heureusement il doit le faire, il ne doit jamais arrêter de le faire, jamais, malgré les menaces. Mais il faut aussi qu’on le protège de ces menaces. Ça, c’est de la responsabilité de l’Etat. C’est la responsabilité de l’Education nationale, de la police nationale. On le fait d’ailleurs. Mais il faut qu’on le fasse encore davantage, sinon on n’est pas honnête, quand on est responsable politique et que l’on appelle à ce courage _ voilà. Mais oui, bien sûr, c’est mon obsession. Tous les jours, on peut, chacun d’entre nous, vous, moi, être complices, d’un esprit de Munich _ oui. Qu’est-ce que c’est ? C’est le renoncement facile.
Q – C’est le cas ?
R – Oui et je veux aller au-delà. Ce que vous me décrivez le montre. Il est partout dans notre société. Il menace chacun d’entre nous.
Q – Il est où par exemple ?
R – Quand vous assistez, j’imagine qu’on l’a tous vécu, à une insulte homophobe, antisémite, raciste, c’est la même chose à la fin. En se taisant, en ne dénonçant pas, où pour des drames, on a vécu des affaires ces dernières semaines, sexuelles ou autres, quand on ne dit pas, on est complice. Tous les jours, nous sommes confrontés, chacun d’entre nous, à plus ou moins grande échelle, à ce choix, entre dire et prendre un risque, ou ne pas dire, et préparer nos sociétés à cet esprit de renoncement.
Q – Alors, une question personnelle, c’est pour cela que vous avez dit, que vous avez fait votre outing quelque part, et expliqué dans le magazine Têtu, en décembre 2020, que vous étiez homosexuel ?
R – Oui, d’abord, je ne cherche pas à donner une grande leçon d’histoire avec moi-même, cela serait ridicule. Mais oui, il y a un peu de cela, parce que je l’ai fait à l’occasion, et cela compte parce que je ne l’aurais pas fait autrement, je crois, d’une interview sur le respect des droits et la défense des droits LGBT en Pologne et en Hongrie. J’ai hésité et je l’ai fait, d’abord parce que cela se dit, encore aujourd’hui, on le dit, chacun a son histoire personnelle, à sa famille, à ses amis, à ses proches.
Q – Il y en a beaucoup qui le cachent.
R – Oui, mais justement, je ne prétends pas être un modèle ou un porte-parole. Ce n’est ni mon rôle ni mon tempérament _ de timide _, ce serait une forme d’arrogance _ et Clément Beaune est aux antipodes de l’arrogance, lui. Mais il y en a effectivement qui ne peuvent pas le dire en France, encore aujourd’hui.
Q – Y compris au sein de leur famille.
R – Bien sûr, y compris au sein de leur famille. J’ai vu tellement de familles où l’on pensait que c’était facile, que les choses étaient apaisées, que la famille était progressiste, ouverte ; des amis qui l’ont dit et des réactions ont parfois été violentes, dures. Moi, je vis à Paris, j’ai grandi à Paris, c’est globalement, parce qu’il n’y a pas de règle absolue, plus facile. Je n’ai pas eu de problème, très peu ; mais je sais, par des amis, par des récits, par des associations, par ce que l’on voit, malheureusement…
Q – Ce que l’on voit à Paris et beaucoup aussi dans les banlieues.
R – Pas que dans les banlieues. Cela peut être difficile. Donc, j’aurais trouvé cela étrange, finalement, de me donner à moi-même le sentiment que je cachais quelque chose, et je préfère dire les choses plutôt que subir des rumeurs, des on-dit _ voilà. J’y suis attaché, cela fait partie de mon histoire personnelle, justement, souvent c’est plus facile de dire que de ne pas dire, donc il faut parfois aussi prendre sur soi pour verbaliser ; cela fait partie de ce combat _ oui.
Q – Parce que quelque part aussi, le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie, ont en commun le rejet de l’autre.
R – Oui. Et si l’on fait notre examen de conscience, nous avons tous une forme d’intolérance. Au fond de nous. C’est un travail de surmonter cette intolérance _ certes. Et si chacun, à partir de son expérience personnelle, parce que l’on a une famille qui a connu la déportation, parce que l’on a soi-même une orientation sexuelle qui fait l’objet encore aujourd’hui, pas forcément pour soi mais en général, de discrimination. Je ne me pose en rien en victime ; ce serait indécent puisque je ne le suis pas. Par exemple, l’histoire de ma famille que l’on a retracée rapidement, cette déportation, ne me donne aucun droit. Elle me donne une responsabilité _ voilà _ de parler.
Q – Est-ce que quelque part, vous avez ressenti de l’antisémitisme ou de l’homophobie ?
R – Peu. Une fois.
Q – C’est-à-dire ?
R – A Paris. Une tentative, heureusement, d’agression physique, homophobe. Mais je l’ai très peu vu. A l’échelle de ce que vivent beaucoup de gens, ce n’est rien. Mais d’abord, j’ai été confronté malgré tout à une haine que je ne comprenais pas.
Q – Vous aviez quel âge ?
R – J’étais étudiant. J’avais 23 ou 24 ans, je n’étais pas tout jeune. Je savais ce que c’était. Ce n’est pas pareil de le vivre, même s’il ne m’est rien arrivé, à la fin. J’étais protégé, j’ai pu échapper. Mais je pense que, d’une certaine façon, c’est une leçon et que l’on doit essayer de partir de cette petite difficulté, douleur, ou expérience personnelle, pour en faire un combat. Chacun le vit à sa façon, par un engagement associatif, par un engagement public, par un témoignage, mais cela ne nous donne pas de droits. Cela nous donne une responsabilité quand on a, dans son histoire personnelle, familiale, vécu une douleur ou un drame. Il faut le transformer _ voilà.
Q – Alors, on poursuit sur votre parcours. Il y a eu l’ENA. Ensuite, on passe les années. 2012, c’est la rencontre avec Jean-Marc Ayrault. Cela a compté ces années à Matignon ?
R – Oui, j’ai effectivement, comme beaucoup, et d’assez loin, participé à la campagne présidentielle de 2012, pour François Hollande, à l’époque. Et j’ai rejoint le cabinet de Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre, que je ne connaissais pas et qui m’a fait confiance. Oui, d’abord il a aussi renforcé ma conscience et mon engagement européen, qui était chez lui sans doute viscéralement enraciné, et une certaine éthique du sérieux, de la sobriété _ voilà. Je sais qu’on le lui a reproché. Moi, je considère qu’il m’a donné une leçon à cet égard. Et puis, à titre personnel, c’était une première expérience politique, au sens large. Je n’étais pas en première ligne, j’étais conseiller de. Mais la confrontation au pouvoir, à sa dureté, à ses coûts, à ces décisions, à la difficulté de ces décisions, c’était l’expérience probablement la plus formatrice.
Q – Et alors, 2014, c’est votre arrivée à Bercy auprès d’Emmanuel Macron, le nouveau ministre de l’économie, avant de rejoindre avec lui, auprès de lui, l’Elysée, en 2017. Est-ce que vous pressentiez, en 2014, ou éventuellement un peu après, qu’Emmanuel Macron, pourrait, pouvait, devenir un jour Président de République ? Ou en tout cas qu’il ait cette ambition ?
R – Non, je ne le savais pas. Je ne m’étais pas posé la question, pour tout vous dire. Je l’avais connu rapidement quand il était conseiller de François Hollande. Je travaillais pour Jean-Marc Ayrault, on se croisait de temps en temps. Et puis, il a été nommé ministre, ce qui pour moi était inattendu, et il m’a proposé, ce qui était tout aussi inattendu, de le rejoindre. J’étais heureux de pouvoir, justement, assister, et c’est cela que j’avais en tête, à une sorte de rafraîchissement. Un jeune, en politique, qui voulait s’engager, dont je connaissais l’esprit d’innovation, d’optimisme, qui m’avait toujours marqué, et je me disais que c’était une aventure à vivre, mais je ne savais pas où elle mènerait.
Q – Elle vous a mené à l’Elysée. Ensuite ministre, secrétaire d’Etat aux affaires européennes. La crise sanitaire, Clément Beaune, elle bouleverse tout, aujourd’hui ?
R – Oui, elle bouleverse nos vies, d’abord. C’est une des rares crises, pour plusieurs générations qui la vivent en ce moment, qui touche tout le monde ; dans le monde entier d’abord, en Europe, de la même façon, à peu près partout, et violemment. Et en France, dans nos villes, tout le monde aura fait l’expérience de la Covid. J’allais dire, malheureusement, tout le monde n’est pas égal, par sa santé, son logement, ses revenus, etc. face à la Covid. Mais tout le monde aura vécu cette expérience un peu surréaliste d’être entravé, d’être inquiété. Une espèce de menace invisible, mais dont on connaît la présence, dont nous voyons, chacun dans notre entourage, qu’elle peut toucher, frapper, et elle emporte évidemment, dans ce moment, à peu près tout, même si je crois que chacun d’entre nous a une forme de résilience _ voilà _ et de résistance personnelle qui fait que l’on a envie, toujours, de se projeter sur autre chose, de faire autre chose. Donc, on est dans cette espèce de tension où la Covid est là, on le sait et en même temps, on ne veut pas se laisser enfermer, pas au sens des restrictions, mais enfermé au sens de nos occupations, de notre esprit qui serait trop habité par cette épidémie.
Q – Alors, le coronavirus est venu de Chine il y a un petit peu plus d’un an. La question que nous pouvons nous poser, qui est peu posée d’ailleurs, est-ce que la Chine doit contribuer, entre guillemets, à la réparation des dégâts qu’elle a fait subir à l’économie mondiale ? Parce que si l’on en est là aujourd’hui, c’est tout de même à cause de ce qui s’est passé en Chine.
R – Alors, pour qu’il y ait réparation, il faut qu’il y ait responsabilité. Ce qu’on demande aujourd’hui, par l’Organisation mondiale de la santé en particulier, c’est qu’il y ait de la transparence. La première responsabilité des Chinois, c’est que l’on puisse reconstituer exactement ce qui s’est passé.
Q – D’ailleurs pour éviter que d’autres pandémies puissent voir le jour.
R – Ce qui m’inquiète plus, pour être tout à fait franc, puisque l’on parle de la Chine, c’est la dépendance supplémentaire que cette pandémie aura créée à l’égard de la Chine. On va regarder ces responsabilités et il faudra sans doute réformer l’Organisation mondiale de la santé. La Chine a une stratégie habile que l’on a parfois trop laissé faire, d’influence dans ses grandes organisations, pas que l’OMS. Plus généralement, de dépendance du reste du monde, vis-à-vis d’elle.
Q – Notamment en matière de médicaments ?
R – Les masques, les médicaments, la production industrielle.
Q – Electronique ?
R – Bien sûr. Je crois que le logiciel des Européens, pas que des Français, qui sans doute était, sur ce point, en avance, s’est retourné. Il y a l’idée d’une naïveté, d’une dépendance, finalement anodine, qui est passé. Mais la pandémie va accélérer…
Q – Donc, cela veut dire que rien ne sera plus comme avant ?
R – Je me méfie toujours de cela, mais je crois que non. Il faut, dans toute crise, on l’a vu sur l’Europe, chercher le renforcement. Il faut chercher les leçons. Je pense que les gens auront une aspiration à autre chose et une mémoire aussi, effectivement, de chocs que l’on a vécus, quand on a découvert que l’on produisait des deux tiers aux trois quarts des médicaments de base, en dehors de l’Europe. Aussi, nous l’avons heureusement rattrapé, et on a réussi déjà à tirer des leçons en produisant des masques, mais au début, on ne savait pas le faire. On avait laissé passer des grandes technologies, partir _ voilà. Des choses extrêmement élémentaires, qui devenaient souveraines tout à coup, qui devenaient essentielles. Je pense que c’est un autre rapport au commerce _ à méditer _, un autre rapport à l’échange, un autre rapport à la dépendance mondiale.
Q – Quand vous voyez, Clément Beaune, ce qui se passe autour de nous, vous êtes secrétaire d’Etat aux affaires européennes, donc ce qu’il se passe dans les autres pays, notamment européens, cela se passe aussi ailleurs, est-ce que vous êtes inquiet pour l’avenir de la France ? C’est-à-dire lorsque l’on voit toutes ces manifestations, ces demandes de faire en sorte que l’on fasse comme s’il ne se passait rien ?
R – Sur le confinement, sur les restrictions ?
Q – Sur les restrictions, oui.
R – Ce qu’on voit ailleurs en Europe. J’ai vu, nous l’avons vu, ce qu’il s’est passé par exemple aux Pays-Bas, où c’était une réaction au couvre-feu. La vérité, c’est que nous ne savons pas, jamais, comment les choses vont réagir.
Q – Il y a des manifestations violentes dans un certain nombre de pays.
R – La France d’ailleurs, n’a pas manifesté cela. Je pense que c’est parce que, contrairement aux clichés que l’on véhicule parfois, nous sommes responsables, plus qu’on ne le dit. On a un attachement, même si l’on râle, même si l’on critique, même si on invective, on a un attachement à l’autorité publique et à l’espace commun. Pas toujours ; on a vu des émeutes, des manifestations violentes, encore récemment. Mais je crois qu’il y a un sens du collectif dans ces moments-là ; ce, à quoi il faut faire plus attention, ce sont les effets de long terme. Une espèce de déprime ou de décrochage _ oui… _, à l’école, dans la santé mentale, que cette crise pourrait entraîner. C’est ça qui aujourd’hui nous anime pour essayer de trouver le bon équilibre. L’école en particulier, on y revient _ et c’est très urgent ! C’est tellement important. Nous nous sommes battus et d’ailleurs, je le rappelle là-dessus, parce qu’on fait beaucoup de comparaisons, on est le pays qui, au jour où nous parlons, a été le plus ouvert d’Europe. Ce que je veux dire, c’est que les écoles sont restées, bien que malheureusement fermées au début pendant le premier confinement au printemps 2020, mais nous les avons rouvertes plus tôt et ne les avons pas refermées par rapport aux autres. Il y a des situations très douloureuses à l’université, par exemple. Pour l’enseignement, les transmissions, on cherche des solutions. Parce que nous voyons bien que décrocher du groupe, de la vie collective, de l’apprentissage au sens large du terme, de l’éducation, c’est un drame personnel et cela peut être un drame pour une génération _ oui. C’est cela qu’il faut éviter aujourd’hui, bien plus que, bien sûr, ça compte, plus que des mouvements de court terme.
Q – En tant que secrétaire d’Etat aux affaires européennes, vous êtes aussi concerné par ce qu’il se passe au niveau des vaccins, au niveau de la stratégie vaccinale, aussi bien française qu’européenne. On ne comprend pas très bien ce qu’il se passe avec les laboratoires pharmaceutiques produisant des vaccins. D’abord, est-ce que Pfizer a une juste interprétation du contrat signé avec l’Europe en livrant 20% de flacons en moins, en partant du fait qu’un flacon contient six doses et non pas cinq ?
R – Alors là, il y a beaucoup de questions différentes. Ce que vous dites sur les doses, il n’y a pas de réduction des livraisons à ce titre, il y a un débat qui est un débat d’abord scientifique, pour savoir, sans être trop technique, si chaque flacon peut donner lieu à cinq doses ou à six doses.
Q – A priori, Pfizer dit : c’est six doses.
R – Non, ce n’est pas Pfizer qui le dit. C’est nous qui avons demandé aux autorités sanitaires et elles nous ont dit que l’on pouvait, oui, prélever une sixième dose.
Q – Et Olivier Véran dit : c’est cinq, 5,99…
R – Dans tous les cas, pour faire clair et simple, dans tous les cas où l’on peut prélever six doses, on le fait aujourd’hui et de plus en plus, nous sommes capables techniquement de le faire. Ensuite, il y a des contrats que l’on a signés, par dose, avec un prix fixé. Et si un flacon donné peut donner lieu à plus de doses, c’est en soi une bonne nouvelle parce que cela veut dire qu’à production donnée, on peut vacciner plus de gens. Donc, cela ne doit pas être une excuse pour faire moins, ou pour livrer plus tard. Avec Pfizer, d’ailleurs, il faut quand même souligner les choses quand elles sont positives, d’abord, le vaccin a été rapide, on a recommandé 300 millions de doses au niveau européen et nous avons évité que le retard, qui était annoncé, perdure. Il a été limité à une semaine et maintenant, on reprend la cadence et l’on accélère.
Q – Avec des commandes supplémentaires.
R – Il y a un sujet qui est en train d’être clarifié, pour un laboratoire qui est AstraZeneca,
Q – Justement, il y a un mystère autour d’AstraZeneca qui ne livrera que 4,6 millions de doses à la France, de son vaccin contre la COVID, d’ici à la fin du mois de mars, soit la moitié de ce qui était attendu. Qu’est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu’il y a une logique là-dedans ? Ou est-ce qu’il y a un gros problème ?
R – C’est cela, c’est un problème en soi, mais c’est cela que l’on essaie de déterminer, avec la ministre de l’industrie, Mme Agnès Pannier-Runacher : savoir ce qu’il se passe. S’il y a un problème industriel, ce n’est pas une bonne nouvelle, mais cela peut arriver. Et regardons tout de même, même si nous sommes tous, on en a marre et que l’on veut se faire vacciner vite, on veut sortir de tout cela. Le vaccin est l’espoir, et tant mieux ; mais on l’a développé en moins d’un an ; il est produit plus vite que l’on ne le prévoyait, il y a encore quelques semaines ; donc, s’il y a un problème, un pépin industriel, si je puis dire, il faut le savoir, cela peut arriver. On comprendrait.
Q – Vous y croyez, à ce pépin industriel ?
R – Si c’est un pépin industriel qui donne lieu à une réduction de livraisons pour l’Europe et pas pour les autres, ça, c’est un problème. Parce qu’il n’y a pas de raison. Je pense aux Britanniques.
Q – Quand vous dites « pas pour les autres« , ce sont les Britanniques. Avec cette déclaration de Michael Gove, c’est le ministre d’Etat de Boris Johnson, qui dit : il est hors de question de livrer aux Européens les vaccins des usines AstraZeneca situées en territoire britannique ; en clair, le mystère d’AstraZeneca ressemble quelque part à une entourloupe britannique, non ?
R – Alors, je ne veux pas être dans le soupçon, dans le complot…
Q – C’est une question que je vous pose.
R – Non, mais je vous le dis, il faut de la clarté et la transparence. En ce moment même où nous parlons, il y a une enquête qui est en train d’être finalisée, pour voir précisément ce qui a été livré en Europe et au Royaume-Uni, à partir des usines qui produisent en Europe. Et nous avons, ce vendredi…
Q – Donc, notamment en Belgique.
R – Exactement, nous avons, ce vendredi, au niveau européen, mis en place une autorisation d’exportation, concrètement, toute dose de vaccin qui doit quitter le territoire européen doit faire l’objet d’une autorisation parce qu’elle est produite sur notre sol, quelle que soit la nationalité du laboratoire, pour vérifier que, – il peut y avoir des livraisons ailleurs, dès lors que nos contrats sont respectés -, mais on respecte d’abord nos contrats. Donc, c’est cela que l’on vérifie. Il peut y avoir un problème industriel. S’il y a eu une préférence qui a été donnée aux Britanniques par rapport à nous, là, c’est un problème, je ne le sais pas.
Q – Et vous y croyez, vous, vous, c’est quoi la thèse qui est la vôtre ?
R – Je ne sais pas. Moi, je ne veux pas avoir de thèse par avance. Il faut les étayer scientifiquement ; ce sont des accusations graves, donc, cela ne se fait pas à la légère. Il faut de la clarté _ certes. Le seul moyen de savoir ce qu’il s’est passé, c’est que cela soit transparent, que l’on retrace les livraisons. C’est ce que l’on est en train de faire et qu’ensuite, le laboratoire et la Commission européenne mettent sur la table ce qui se passe exactement ; ce qui est très important, parce que moi, j’insiste toujours sur l’Europe. Je défendrai bec et ongles ce cadre européen de l’achat des vaccins, parce qu’il est bon. Imaginons ce qui serait passé si aujourd’hui, chaque pays européen, la France, l’Allemagne et les autres, étaient en train de négocier et de passer ces coups de fil pour les doses, on ne gagnerait pas forcément à cette compétition. Ce serait la guerre en Europe et peut-être même littéralement.
Q – Et la guerre, peut-être, à l’intérieur du pays, parce qu’il y a un certain nombre peut-être de régions, de municipalités…
R – Quand les régions nous disent : moi, je veux aller négocier dans mon coin. Il faut savoir ce que cela veut dire.
Q – Qu’est-ce que cela veut dire ?
R – Cela veut dire que potentiellement, vous auriez plus de doses en Île-de-France qu’en Auvergne, Rhône-Alpes, plus de doses dans le Grand Est qu’en Nouvelle-Aquitaine. Moi, ce n’est pas de ce pays-là que je veux. Et je ne veux pas de cela pour l’Europe, parce que c’est une question d’éthique, mais c’est une question même d’intérêt. Imaginez ce qu’il se passe si la France est bien vaccinée, et pas l’Allemagne, ou vice versa. On réimporterait immédiatement le virus parce que l’on peut se barricader, il y a tout de même des mouvements inévitables. Donc, c’est une folie de croire que l’on s’en sortirait mieux si l’on se divisait _ certes. En revanche, moi, je crois à une Europe qui défend ses intérêts. Et s’il y a problème, – je ne dis pas qu’il y a problème -, mais s’il y a un problème, et que l’on a privilégié d’autres destinations d’autres pays, par exemple le Royaume-Uni, plutôt que nous, là, nous défendrons nos intérêts.
Q – De quelle manière ? Par des mesures de rétorsion ?
R – En faisant respecter nos contrats. Des contrats, ce ne sont pas des engagements moraux, ce sont des engagements juridiques _ oui. Tout contrat peut être sanctionné par des pénalités, des sanctions…
Q – Par le non-paiement de ce qui est dû à AstraZeneca, par exemple ?
R – Oui, ou la non-commande de doses supplémentaires ou des pénalités. Tout cela est prévu par les contrats et c’est normal, dans un cadre juridique. Mais je ne dis pas qu’il faut en arriver là, je dis d’abord qu’il faut faire la clarté. Et moi, je ne veux pas une Europe qui cache les choses ou qui ne défend pas ses intérêts. Et je crois que ce qu’a fait la Commission, cette semaine, à notre initiative notamment, faire la transparence, hausser le ton, c’était ce qu’il fallait faire.
Q – Boris Johnson peut-il jouer un mauvais coup à l’Europe et à la France ou pas ?
R – Je ne le sais pas. Encore une fois, je ne veux pas faire de mauvais procès.
Q – Est-ce que c’est une hypothèse que vous pouvez avoir en tête ? Est-ce que cela peut être une conséquence du Brexit, d’ailleurs ?
R – Non, alors, non, ce n’est pas une conséquence du Brexit, parce que ce que fait le Royaume-Uni, un pays européen, s’il le souhaitait, pourrait sortir du cadre et le faire. Ce qu’a fait le Royaume-Uni, concrètement, c’est souvent d’accélérer les procédures, en prenant, c’est un fait, plus de risques dans les campagnes de vaccination ; aussi, avec une situation sanitaire qui est douloureuse et qui est difficile, donc, on peut le comprendre, mais qui n’est pas la situation de la France et de l’Union européenne. Il faut regarder les choses que l’on compare. Quand on compare, on dit « en Israël, cela va beaucoup plus vite« . C’est vrai, mais il y a un accord pour transférer des données médicales au laboratoire Pfizer. Je ne crois pas que ce soit le modèle que les Européens veuillent. Au Royaume-Uni, il y a eu une prise de risque ; je ne dis pas « n’importe quoi« , mais « une prise de risque« , qui a été faite sur l’espacement entre les injections de doses, sur l’utilisation de tel ou tel vaccin sur les populations, sans tenir compte de restrictions scientifiques, etc. Et donc, les Européens, je crois, n’accepteraient pas, à juste titre sans doute, cette prise de risque avec leur santé. Donc, je crois que ce qui apparaît parfois, qu’il y ait des lenteurs que l’on puisse surmonter, c’est un fait, faisons-le, très bien. S’il y a des lenteurs qui sont liées à de la prudence et de la recommandation scientifique nécessaire, là, je crois qu’il faut la respecter et que c’est aussi notre modèle, malgré tout.
Q – Dernière question sur ce sujet : ces retards de livraison de Pfizer, d’AstraZeneca, de Moderna, est-ce qu’ils remettent en cause l’objectif du gouvernement qui était de vacciner, et qui est de vacciner tous les Français d’ici à la fin de l’été ?
R – Non. L’objectif que nous avions annoncé, c’est de faire le maximum d’ici à la fin de l’été _ voilà. Et Olivier Véran, Agnès Pannier-Runacher l’ont rappelé, cette semaine : quinze millions de personnes vulnérables, à l’horizon du mois de juin. Cela reste notre objectif.
Q – On assiste, autre sujet, Clément Beaune, depuis 2017, à une recrudescence de discours de haine, de l’omniprésence de la violence dans la rue, et même au sein du débat politique, une remise en cause, aussi, des décisions démocratiques, y compris à une « dé-légitimation » de l’élection du Président de la République et des députés. Est-ce que c’est compatible avec la démocratie, voire avec les valeurs de la République, et comment vous avez vécu cela de l’intérieur ?
R – Je pense qu’il faut toujours faire attention, moi, j’ai un immense respect pour les institutions et le vote. Et je crois qu’il ne faut pas considérer, que l’on a tendance à considérer que le vote, cela a été anecdotique. Quand on met un bulletin dans une urne, on choisit un maire, un député, un Président de la République, pour une durée de cinq, six ans. Cela nous engage. C’est un geste sérieux. Nous n’allons donc pas considérer qu’il y a mieux que cette légitimité de l’élection. Laquelle ? Cela ne veut pas dire que l’on ne doit pas avoir des moments de respiration, de participation démocratique.
Q – Ce n’est pas à la rue de décider.
R – Non, cela ne veut pas dire que quand il se passe quelque chose dans une société, quand il y a un mouvement, un mouvement social, on l’a vu au moment des gilets jaunes, il ne faut pas l’entendre parce que cela veut dire quelque chose ; mais il ne faut pas confondre une protestation, une colère sociale à laquelle je pense qu’il faut répondre en ouvrant la discussion, en prenant des mesures comme nous l’avons fait, et une sorte de légitimité parallèle, hors élections, parce que cela, je crois que c’est l’essence de la démocratie. On parlait de ne pas renoncer, de ne pas être lâche. Cela fait partie de la défense ferme de nos principes.
Q – Comment expliquez-vous cette haine contre Emmanuel Macron ?
R – Je ne sais pas si elle est spécifique. On a malheureusement, dans notre société, par le jeu des réseaux sociaux, de l’information permanente, du déversement continu, on a une société qui est plus haineuse qu’elle pouvait l’être, il y a quelques années. Et je crois que cela, il faut l’avoir toujours en tête, – cela peut paraître une banalité et tant mieux si cela l’est -, la violence verbale ne s’arrête jamais aux mots. D’abord, elle peut gravement blesser, mais ceux qui commencent anonymement à déverser des insultes, des mots d’une extrême gravité…
Q – Cela peut conduire à la violence.
R – Bien sûr, cela conduira toujours à la violence. On l’a vu d’ailleurs, aux Etats-Unis, récemment.
Q – Un sondage Harris Interactive publié, lundi, par L’Opinion, place Marine Le Pen devant Emmanuel Macron au premier tour, 26 à 27 pour Le Pen, 23 à 24 pour le président Macron et au coude à coude au second tour : 48% pour elle, contre 52 pour celui qui pourrait être, qui devrait être le président candidat. Qu’est-ce que cela vous inspire ? Est-ce que, quelque part, il n’y a pas le feu au lac ?
R – Il ne faut pas, si je puis dire, se décider ou juger des choses en fonction d’une enquête d’opinion ou d’un sondage. Mais ce que cela veut dire, moi, je…
Q – Est-ce que cela veut dire que le pire est possible ?
R – Mais bien sûr.
Q – Et le pire, pour vous, c’est Marine Le Pen, présidente ?
R – Je pense que ce serait immensément grave, mais je ne suis pas un pessimiste. Mais il faut regarder l’histoire avec les yeux ouverts et le sens de ce qui s’est passé. Nous ne sommes jamais à l’abri. Ce n’est pas une garantie d’être dans un espace, une Europe apaisée, un pays démocratique, ce n’est pas une garantie que ce sera toujours le cas. Et au-delà de ces grandes bascules, je pense que croire que ce qui nous paraît être redoutable, dangereux, voire très dangereux, ne peut pas arriver, ne pas y croire, ça, c’est aussi un début de lâcheté et de renoncement. Il faut ne pas se résigner, il faut combattre, politiquement, démocratiquement en l’occurrence, mais ne jamais penser, – je ne crois jamais au retour de l’histoire -, que nous avons définitivement écarté les menaces.
Q – Pour vous, Marine Le Pen, présidente, c’est possible ?
R – Oui, c’est possible, si l’on ne se bat pas. Il faut se battre, toujours. Moi, je ne considère pas que personne n’a droit à, que personne n’a une garantie de, personne n’a une sécurité absolue, et croire, en politique, que ce que l’on pense impossible, impensable, n’arrive pas, nous l’avons vu ! Moi, vous le savez, j’étais en charge des questions européennes auprès d’Emmanuel Macron quand le Brexit est arrivé. Peu de gens croyaient que c’était possible ; eh bien, même chose, c’est arrivé. Donc, tout est possible, bien sûr. Toujours, tout est possible, tout est ouvert, mais le pire n’est jamais sûr et on peut l’éviter. Cela ne dépend que de nous.
Q – On se quitte sur cette phrase : « cela ne dépend que de nous« . Merci, Clément Beaune, d’avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.
…
Source https://www.diplomatie.gouv.fr, le 9 février 2021