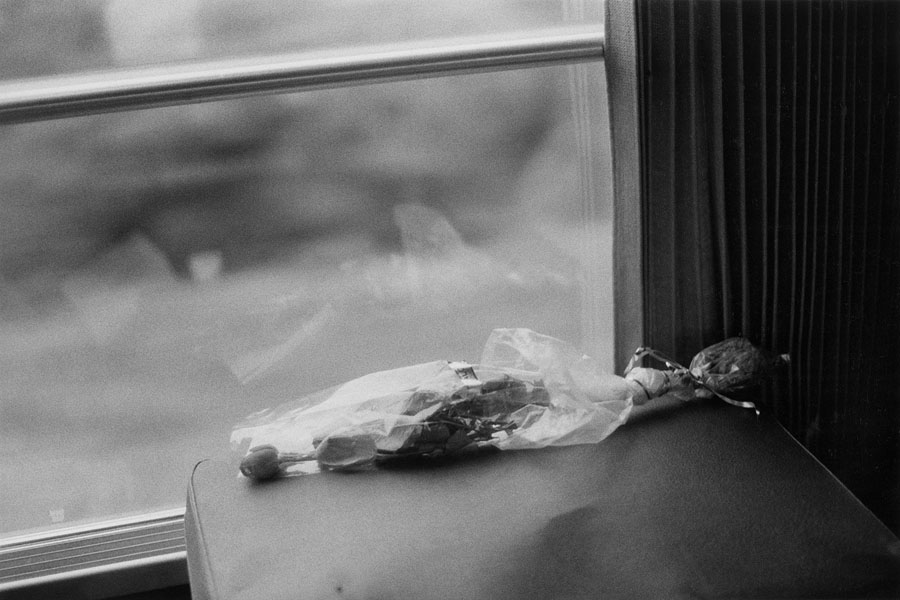C’est la piste de la recherche (éminemment concrète) du « génie des lieux » dans l’élaboration de la fine pensée nietzschéenne,
qui m’a conduit à lire Le Voyage de Nietzsche à Sorrente _ sous-titré Genèse de la philosophie de l’esprit libre… _, de Paolo D’Iorio,
thésaurisé par moi dès sa parution en mai 2012.
…
Et en avant-propos à cet article-ci,
j’invite à l’écoute de l' »Hymne à la vie » de Nietzsche, Gebet an das Leben,
composé en 1882 sur un poème de Lou Salomé,
par exemple tel qu’il conclut le récital de Lieder de Nietzsche de Dietrich Fischer-Dieskau accompagné au piano par Aribert Reimann, enregistré à Berlin en septembre 1989, tel que le propose le CD Philips 426 663-2…
…
En voici le texte traduit en français (par Bertrand Vacher) :
…
Oui, comme un ami aime son ami,
je t’aime, vie énigmatique !
Que tu m’aies fait jubiler ou pleurer,
que tu m’aies apporté la souffrance ou le plaisir,
je t’aime, avec ton bonheur et tes tourments,
et si tu dois m’anéantir,
je m’arracherais douloureusement de tes bras,
comme on s’arrache de la poitrine d’un ami.
…
…
Le « génie des lieux » depuis bien longtemps sollicite ma curiosité _ et c’est ainsi que j’ai amené les élèves de mon atelier « Habiter en poète » à l’exercice d’oser saisir (et donner, rendre) par la photo (sur le terrain même, à arpenter !, d’une ville étrangère : loin d’ici…) le regard d’un grand écrivain européen contemporain sur sa ville (et son monde), en l’idiosyncrasie de son écriture (= son style), regard auquel leur lecture hyper-attentive du livre de ce grand écrivain sera auparavant et en même temps à la fois, parvenu ; en essayant, à leur tour, et sur le terrain à découvrir, de se faire artistes de la photographie : « saisis » par la rencontre de leur propre découverte de la ville, avec ce qu’ils avaient peu à peu découvert, en leur lecture (et, en même temps, incorporé, en leur pratique photographique), du regard de l’écrivain, en son propre style : il s’agissait du regard d’Antonio Lobo Antunes sur sa Lisbonne, en son Traité des passions de l’âme ; et du regard d’Elisabetta Rasy sur sa Rome, en son Entre nous : des chefs d’œuvre !.. ; le projet que faute de financement nous n’avons pas pu réaliser, concerne Naples et le regard sur Naples de Diego De Silva dans son puissant roman Je veux tout voir…
…
Quant à Nietzsche,
il est, pour moi, une des portes _ décisive ! via l’analyse qu’il mène du nihilisme ; et des voies qu’il conçoit afin de le surmonter… _ de l’intelligence effective de notre présent historique :
depuis de nombreuses années, nous avons très attentivement arpenté, labouré et décrypté, chaque année, et en un nombre suffisant de séances, le Prologue _ capital ! _ d’Ainsi parlait Zarathoustra _ conçu et écrit, lui (ainsi que « les vingt-trois chants qui composent la première partie« ) à Rapallo, l’hiver 1882-1883, « en trente jours » : « dix pour le premier jet, dix pour la rédaction, dix pour une dernière mise au point« , indique Daniel Halévy (1872-1962) aux pages 348-349 de son (toujours !) vibrant Nietzsche, paru en 1944, aux Éditions Bernard Grasset (d’après une première version, intitulée La Vie de Frédéric Nietzsche, parue en 1909 chez Calmann-Lévy : ainsi l’enquête de Daniel Halévy l’avait-elle amené à rencontrer et interroger bien de ceux qui avaient croisé la route de Nietzsche, tel, par exemple Paul Lanzky (1852-1935), chez lui, à Vallombrosa, en 1909 (page 466 de ce Nietzsche dans l’édition Le Livre de Poche-Pluriel) ; « ce Lanzsky qu’on oublie toujours« (page 464) avait fait le voyage de Nice (en octobre 1884) et celui de Rapallo (en septembre 1886) pour rencontrer Nietzsche ; et Nietzsche, lui-même, avait fait le voyage de Florence et de Vallombrosa, pour rencontrer Lanzky, à l’automne 1885…) : de ce très vivant Nietzsche de Daniel Halévy, Georges Liébert a donné une superbe édition magnifiquement commentée en 1977, en Livre de Poche-Pluriel, avec 110 pages de notes fort judicieuses par lui-même et Georges-Arthur Goldschmidt…
…
Et quant à Paolo D’Iorio,
d’une part, il a dirigé avec Olivier Ponton la publication, en 2004, de Nietzsche, Philosophie de l’esprit libre _ Études sur la genèse de Choses humaines, trop humaines ;
et, d’autre part, il dirige la mise en œuvre, depuis 2009,
et des Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe,
et des Digitale Faksimile Gesamtausgabe, de Frédéric Nietzsche : une mine de documents à très minutieusement explorer : et c’est là la source principale de ce qu’apporte ce travail-ci _ d’analyse de la « genèse« (tant interne qu’externe !) des œuvres _ de Paolo D’Iorio…
…
Ce premier travail publié
ainsi que ces deux très vastes chantiers _ de numérisation _ en cours de Paolo D’Iorio
sont en effet décisifs pour éclairer le sens du projet et la genèse, donc, de ce Voyage de Nietzsche à Sorrente _ Genèse de la philosophie de l’esprit libre,
dans la mesure où ils constituent,
l’un, une première étape importante,
et les deux autres, des matériaux décisifs de la démarche d’enquête de cet ouvrage-ci, en sa très remarquable précision et toute sa richesse,
…
afin de mieux mettre à jour, en toute leur finesse et remarquable _ nécessaire : c’est ainsi que progressent la recherche et la connaissance… _ subtilité,
les itinéraires _ de « fil de soie« … _ du penser de Nietzsche, entre l’automne 1876 _ quand la maladie devient de plus en plus perturbatrice de l’enseignement du professeur de philologie à l’université de Bâle, et que s’élargit la rupture de pensée (de « l’esprit libre« , en gestation et devenir, de Nietzsche) vis-à-vis de l’autorité que représentait jusqu’alors la personnalité forte, aussi, de Richard Wagner _ et l’effondrement final de Nietzsche à Turin, le 6 janvier 1889.
…
Car Paolo D’Iorio,
parti, dans sa propre démarche de chercheur, de l’éclaircissement des circonstances de la rédaction de Choses humaines, trop humaines _ pages 196-197 , et en s’appuyant sur les remarques de Charles Andler, aux pages 321-322 du volume II de son Nietzsche. Sa vie, sa pensée (dans l’édition de 1958 en 3 volumes), Paolo D’Iorio explicite le choix de la traduction de ce titre, traditionnellement traduit par Humain, trop humain _,
a considérablement nourri l’élucidation très fine des tenants et aboutissants de cette enquête,
de l’analyse fouillée de toutes les très fécondes variations-corrections de l’écriture même de Nietzsche, en ses diverses (très riches) strates, notamment à l’aide de ce qu’il nomme les « Sorrentiner Papiere » de Nietzsche _ le chapitre 4 du livre, pages 111- 156, leur est consacré.
…
Page 129, Paolo D’Iorio écrit précisément : « En promenade, ce sont les chemins mêmes de Sorrente qui offrent à Nietzsche de quoi traduire ses pensées en images _ ce que je nomme, pour ma part, et d’après le travail de Marie-José Mondzain, « imageance« … _ : « Cheminer par des allées de pénombre à l’abri des souffles, tandis que sur nos têtes, agités par des vents violents, les arbres mugissent, dans une lumière plus claire »… » ;
et page 135 : « Depuis sa retraite sorrentine, le philosophe recueille d’autres images et d’autres métaphores qui lui servent à définir _ c’est-à-dire cerner par des focalisations successives, en quelque sorte _ la figure du philosophe à l’esprit libre _ qui émerge ainsi peu à peu, se désenlise… _, son amour de la connaissance et sa position sociale.
Lisons une de ces images, fixée comme d’habitude par trois petites phrases jetées dans les carnets de Sorrente :
« La lumière du soleil étincelle au fond et montre ce sur quoi les ondes courent : d’âpres pierrailles.
Ce qui compte, c’est le souffle que vous avez pour plonger dans cet élément : si vous en avez beaucoup, vous pourrez voir le fond.
La lumière scintillante du soleil de la connaissance, traversant le fleuve des choses, en touche le fond. »
…
Et voici, poursuit immédiatement Paolo D’Iorio page 136, comment cette image passe _ et ce qu’elle devient et donne ! _ dans le texte de Choses humaines, trop humaines _ il s’agit de l’aphorisme 291 _, avant le dernier aphorisme consacré à l’esprit libre :
« Les hommes à l’esprit libre, qui ne vivent que pour la connaissance, auront tôt fait de parvenir au but extérieur de leur existence, à leur position définitive vis-à-vis de la société et de l’État ; ils se déclareront volontiers satisfaits, par exemple d’un petit emploi ou d’un avoir tout juste suffisant pour vivre ; car ils s’arrangeront pour vivre de manière telle qu’un grand changement des finances publiques voire un bouleversement de l’ordre politique, n’entraîne pas en même temps _ existentiellement, en quelque sorte _ leur propre ruine. Toutes ces choses, ils leur consacrent aussi peu que possible de leur énergie, afin de plonger avec toutes leurs forces rassemblées, et comme avec toute la longueur de leur souffle _ en son inspiration vraie _, dans l’élément de la connaissance. C’est ainsi qu’ils peuvent espérer descendre assez bas et peut-être voir _ vraiment !!! _ jusqu’au fond »… » ;
…
cf aussi cette citation, donnée page 132, de l’aphorisme 478 de Choses humaines, trop humaines , ultra-importante dans l’économie même du livre (et ses variations) : « L’activité du Midi et celle du Nord. L’activité provient de deux sources très différentes. Les artisans du Sud en arrivent à être actifs non point par envie de lucre _ voilà ! _, mais à cause des besoins perpétuels des autres. Comme il vient toujours quelqu’un qui veut faire ferrer un cheval, réparer une voiture, le forgeron presse le travail. S’il ne venait personne, il s’en irait flâner sur la place. Se nourrir n’a guère d’urgence dans un pays fertile _ là où fleurissent (et fruissent généreusement) les orangers, les citronniers, les figuiers… _, il ne lui faudrait pour cela qu’une minime quantité de travail, en tout cas nulle presse ; il finirait bien par s’en aller mendier, content néanmoins. _ L’activité de l’ouvrier anglais découle au contraire _ cf la si parlante analyse de Locke à l’article « Désir » de son Essai sur l’entendement humain : un texte crucial, à mes yeux ! _ de son goût du lucre : il se fait une haute idée de lui-même et de ses ambitions, et dans la possession c’est la puissance qu’il cherche, dans la puissance le plus de liberté et de distinction individuelle possible« ; j’ai admiré cette pensée de Nietzsche au point de l’adresser à l’ami Martin Rueff, en commentaire en contre-point, en quelque sorte, à sa traduction, parue dans le numéro de Libération du lundi 25 mars, de l’article de Giorgio Agamben Quand l’Empire latin contre-attaque :
…
« En 1947, Alexandre Kojève, un philosophe qui se trouvait aussi occuper des charges de haut fonctionnaire au sein de l’État français, publie un essai intitulé l’Empire latin. Cet essai est d’une actualité telle qu’on a tout intérêt à y revenir.
Avec une prescience singulière, Kojève soutient sans réserve que l’Allemagne deviendra sous peu la principale puissance économique européenne et qu’elle va réduire la France au rang d’une puissance secondaire au sein de l’Europe occidentale. Kojève voyait avec lucidité la fin des États-nations qui avaient jusque-là déterminé l’histoire de l’Europe : tout comme l’État moderne avait correspondu au déclin des formations politiques féodales et à l’émergence des États nationaux, de même les États-nations devaient inexorablement céder le pas à des formations politiques qui dépassaient les frontières des nations et qu’il désignait sous le nom d’« empires ». A la base de ces empires ne pouvait plus se trouver, selon Kojève, une unité abstraite, indifférente aux liens réels de culture, de langue, de mode de vie et de religion : les empires – ceux qu’il avait sous les yeux, qu’il s’agisse de l’Empire anglo-saxon (Etats-Unis et Angleterre) ou de l’Empire soviétique – devaient être des «unités politiques transnationales, mais formées par des nations apparentées».
C’est la raison pour laquelle Kojève proposait à la France de se poser à la tête d’un « Empire latin » qui aurait uni économiquement et politiquement les trois grandes nations latines (à savoir la France, l’Espagne et l’Italie), en accord avec l’Église catholique dont il aurait recueilli la tradition tout en s’ouvrant à la Méditerranée. Selon Kojève, l’Allemagne protestante qui devait devenir sous peu la nation la plus riche et la plus puissante d’Europe (ce qu’elle est devenue de fait), ne manquerait pas d’être inexorablement attirée par sa vocation extraeuropééene et à se tourner vers les formes de l’Empire anglo-saxon. Mais, dans cette hypothèse, la France et les nations latines allaient rester un corps plus ou moins étranger, réduit nécessairement à un rôle périphérique de satellite.
Aujourd’hui, alors que l’Union européenne (UE) s’est formée en ignorant les parentés culturelles concrètes qui peuvent exister entre certaines nations, il peut être utile et urgent de réfléchir à la proposition de Kojève. Ce qu’il avait prévu s’est vérifié très précisément. Une Europe qui prétend exister sur une base strictement économique, en abandonnant toutes les parentés réelles entre les formes de vie, de culture et de religion, n’a pas cessé de montrer toute sa fragilité, et avant tout sur le plan économique.
En l’occurrence, la prétendue unité a accusé les différences et on peut constater à quoi elle se réduit : imposer à la majorité des plus pauvres les intérêts de la minorité des plus riches, qui coïncident la plupart du temps avec ceux d’une seule nation, que rien ne permet, dans l’histoire récente, de considérer comme exemplaire. Non seulement il n’y a aucun sens à demander à un Grec ou à un Italien de vivre comme un Allemand ; mais quand bien même cela serait possible, cela aboutirait à la disparition d’un patrimoine culturel qui se trouve avant toute chose une forme de vie. Et une unité politique qui préfère ignorer les formes de vie n’est pas seulement condamnée à ne pas durer, mais, comme l’Europe le montre avec éloquence, elle ne réussit pas même à se constituer comme telle.
Si l’on ne veut pas que l’Europe finisse par se désagréger de manière inexorable, comme de nombreux signes nous permettent de le prévoir, il conviendrait de se mettre sans plus attendre à se demander comment la Constitution européenne (qui n’est pas une constitution du point de vue du droit public, comme il n’est pas inutile de le rappeler, puisqu’elle n’a pas été soumise au vote populaire, et là où elle l’a été – comme en France, elle a été rejetée à plates coutures) pourrait être réarticulée à nouveaux frais.
De cette manière, on pourrait essayer de redonner à une réalité politique quelque chose de semblable à ce que Kojève avait appelé « l’Empire latin »« … _,
…
de même que du croisement de ces éléments proprement nietzschéens
avec toute la documentation que Paolo D’Iorio a pu et su réunir (et surtout croiser et analyser en leur entrecroisement !) de témoignages de ceux qui ont accompagné ou croisé alors _ ces huit mois-là _ la route du philosophe, en ce voyage de Sorrente,
depuis le 1er octobre 1876 _ début du séjour de Nietzsche à l’Hôtel du Crochet, à Bex, dans le canton de Vaud, juste après le départ de Bâle _ jusqu’en mai 1977 _ c’est le 12 mai au soir que Nietzsche franchira la frontière du retour, entre l’Italie et la Suisse, à Chiasso, et se trouvera à Lugano, dans le canton du Tessin (il y passe la nuit du 12 au 13 à l’Hôtel du Parc), avant de gagner d’abord Pfäffers-Bad Ragaz (cf ceci : le 7 mai 1877, la veille de quitter Sorrente, Nietzsche prévenait ainsi (page 159) « son fidèle ami Franz Overbeck, à Bâle : « Ma santé empire toujours au point que je dois vite m’en aller. Demain, je pars en bateau, je veux tenter une cure à Pfäffers, près de Ragaz »…) ; puis, suite à l’échec de cette première cure, ce sera Bad Rosenlaui, à partir du 11 juin, pour une nouvelle une cure thermale de trois semaines ; Nietzsche y séjournera tout l’été… _ :
…
_ l’étudiant (lui-même très malade _ de la tuberculose _, il décèdera le 18 avril 1878, à l’âge de 21 ans) Albert Brenner (1856-1878),
_ l’ami philosophe Paul Rée (1841-1909),
_ et d’abord et au tout premier chef Malwida von Meysenbug (1816-1903), l’organisatrice _ et en quelque sorte « puissance invitante » ! _ de ce long séjour amical, qui les reçoit à Sorrente, à la Villa Rubinacci _ et Nietzsche lui en sera éternellement reconnaissant ! _ ;
…
_ mais aussi, une jeune voyageuse, Isabelle von der Pahlen _ devenue plus tard, par son mariage, baronne von Ungern-Sternberg… _, qui partage un compartiment de train entre Genève et Gênes _ via le tunnel du Mont-Cenis _, les 19 et 20 octobre 1876 ; qui visite avec Nietzsche « les rues et les ruelles pittoresques de Gênes » _ « Combien s’intensifia la jouissance de cet endroit pittoresque, quand à partir de la magie du présent, l’éloquence de Nietzsche évoqua les ombres des puissants temps anciens« , page 38 _ ; et, encore, « le 24 octobre, à Pise« , « le dôme, le baptistère et le campo santo »… ;
_ et l’ami Reinhart von Seydlitz, qui se rend lui aussi et séjourne à Sorrente, avec son épouse Irène, à la Villa Rubinacci, « de la fin mars au début de mai 1877 » (page 111) ;
_ et aussi _ last, not least ! _ Cosima et Richard Wagner, présents à Sorrente (à l’Hôtel Vittoria) à l’arrivée de nos voyageurs, le 27 octobre 1876 _ ils y séjournent depuis le 5 octobre et gagneront Naples le 7 novembre _ : « Du 27 octobre au 7 novembre, les pensionnaires de la Villa Rubinacci et ceux de l’Hôtel Vittoria se sont probablement échangé plusieurs visites » (pages 61-62) ; et plus jamais Nietzsche et Richard et Cosima Wagner ne se reverront…
…
Paolo D’Iorio croise ainsi très judicieusement ces divers témoignages des uns et des autres aux textes mêmes de Nietzsche, et cela, en leurs diverses et très riches strates ;
et il dégage très finement ce que chacun de ces divers croisements est à même de révéler des activités, des humeurs, et surtout des pensées philosophiques naissantes et évolutives de Nietzsche
…
_ cf page 165-166 cette citation de Mazzino Montinari, page 9 de son Nietzsche (aux PUF en 2001) : « La vie de Nietzsche, ce sont ses pensées, ses livres. Nietzsche est un exemple rare de concentration mentale, d’exercice cruel et continu de l’intelligence, d’intériorisation et de sublimation d’expériences personnelles, des plus exceptionnelles aux plus banales, de réduction de ce qu’on appelle communément « la vie » à « l’esprit », ce mot entendu au sens du terme allemand « Geist » qui est entendement-raison-intelligence, aussi intériorité ou spiritualité (mais pas mysticisme ou Seele, âme). »… _
en une précision d’analyse féconde véritablement passionnante !
…
Le cinquième et avant-dernier chapitre du livre, intitulé « Les cloches de Gênes et les épiphanies nietzschéennes« , aux pages 157 à 220, introduit un outil opératoire absent en tant que tel de la boîte-à-outil nietzschéenne, mais emprunté par Paolo D’Iorio à James Joyce,
celui d' »épiphanie« ,
afin de « traiter » le devenir philosophique dans l’œuvre ultérieure de Nietzsche d’un « thème » particulier, en l’occurrence celui des cloches :
perceptible ici à partir de celles entendues lors de l’arrivée à Gênes _ le 10 mai au soir _ du bateau en provenance de Naples.
…
Voici comment l’introduit et l’amène Paolo D’Iori, pages 166-167-168 :
…
« Les papiers de Sorrente qu’il porte dans une valise et le projet d’un nouveau livre encore sans titre sont une promesse de liberté,
mais aussi une tâche imposante.
Trouvera-t-il jamais la force et le courage de l’écrire et de le publier ? Ne serait-il pas plus simple de renoncer ?
Une traversée en bateau suffit pour susciter le doute sur la valeur de la vie ; et quand, à l’aube _ du 10 mai _, surgissent les lumières du port de Gênes, lui viennent les paroles les plus sombres que celles envoyées dans sa lettre :
…
« Désir de la mort, comme celui qui ayant le mal de mer et voyant aux petites heures de la nuit les feux du port, a désir de la terre. »
Cette pensée affleure dans un carnet écrit sur la terre ferme à Gênes, probablement le jour suivant, onze mai ;
…
et sur la même page on trouve une autre brève note :
…
« Son de cloche le soir _ de ce même 10 mai _ à Gênes _ mélancolique, effroyable, enfantin. Platon : rien de ce qui est mortel n’est digne d’un grand sérieux. »
…
Marchant dans les rues de Gênes à l’heure du crépuscule, Nietzsche avait entendu le son de cloche venant du haut d’une tour.
En un instant, les souvenirs du fils du pasteur, l’érudition du philologue et la réflexion du philosophe se fondent _ voilà ! _ en une expérience de pensée _ ou le cœur du mouvement de penser nietzschéen ! _ qui le bouleverse profondément. La page de ce carnet en garde la première trace écrite« .
Les cloches de Gênes sont une épiphanie nietzschéenne » (page 168).
…
Page 172, Paolo D’Iorio explique :
« Nietzsche n’a pas utilisé le terme d’épiphanie dans ses œuvres, mais nous l’utiliserons en tant que concept critique pour comprendre un certain nombre de traits propres à la genèse et à la structure de son écriture philosophique.
S’il n’a pas utilisé le mot, Nietzsche était bien conscient que notre existence est scandée par des moments à la signification intense, et que ces moments représentent les modulations les plus significatives _ voilà ! _ dans la symphonie de la vie _ qu’il appartient au philosophe d’apprendre à véritablement saisir, sonder et explorer ! _ :
…
« A propos des aiguilles des heures sur l’horloge de la vie. La vie consiste en de rares moments isolés à la signification intense et en d’innombrables intervalles lors desquels, dans le meilleur des cas, les ombres de ces moments continuent à flotter autour de nous. L’amour, le printemps, toute belle mélodie, la montagne, la lune, la mer _ tout ne parle qu’une seule fois vraiment à notre cœur, s’il parvient jamais à parler. Mais nombreux sont les hommes qui ne connaissent pas de tels moments et qui eux-mêmes sont ces intervalles et ces pauses dans la symphonie de la vie réelle » _ ce texte éminemment significatif se trouve aux pages 172-173…
…
Dans les carnets du philosophe se trouve parfois la trace _ visible et accessible _ de ces épiphanies, poursuit Paolo D’Iorio. Ce sont des épiphanies biographiques, comme lorsque Nietzsche se remémore la première fois où, enfant, près du ruisseau de Plauen, il a vu des papillons dans le soleil du printemps (…)
Les épiphanies biographiques sont rares dans les écrits de Nietzsche.
Le philosophe se sentait « comme transpercé par la flèche de curare de la connaissance », et les événements les plus importants de sa vie étaient en réalité ses propres pensées.
Les véritables épiphanies nietzschéennes parlent donc de philosophie ; ce sont des épiphanies de la connaissance, courts-circuits mentaux qui par une étincelle résolvent un problème philosophique _ qui le travaillait déjà sourdement _ ou ouvrent de nouvelles perspectives en associant _ par une féconde imageance proprement philosophique ici _ des concepts apparemment éloignés« , pages 173-174…
…
« Certaines épiphanies sont particulièrement importantes parce qu’elles annoncent un tournant _ de l’œuvre nietzschéen _, signalent comme un sursaut _ créatif _ de la réflexion _ vis-à-vis de clichés-ornières où s’enlise dans des opinions trop installées le penser _, et impriment une accélération au développement déjà très rapide _ voilà ! _ de la pensée de Nietzsche.
…
Les épiphanies philosophiques nietzschéennes peuvent donc être utilisées comme un instrument heuristique à l’intérieur d’une perspective génétique _ telle que celle de ce travail-ci de Paolo D’Iorio _, comme le signal d’un fort trouble émotif provoqué par la naissance d’un nouveau scénario cognitif _ ou imageance en travail…
Suivre les épiphanies _ en les métamorphoses de leur devenir ultra-fin et si riche _ peut nous aider à découvrir le mouvement parfois souterrain de la pensée de Nietzsche _ son imageance philosophique, donc, au travail… _ et à en comprendre _ surtout ! _ les changements profonds.
Toutes les épiphanies ne marquent pas un tournant,
mais toutes les métamorphoses de la philosophie de Nietzsche sont précédées ou accompagnées par une épiphanie« , page 174 _ et Nietzsche met lui-même l’accent sur l’idiosyncrasie de toute philosophie…
…
« Les épiphanies nietzschéennes sont des moments où se manifeste à l’improviste au philosophe _ qui doit apprendre à les accueillir _ toute la féconde richesse sémantique d’un événement, d’un objet ou d’un concept » _ en sa capacité d’imageance, ici philosophique, qu’il faut explorer, déployer et approfondir _, page 175.
Et l’apport de Paolo D’Iorio est de repérer ici cela !
……
Revenant, dès la page 178, à « l’épiphanie gênoise » des cloches,
Paolo D’Iorio s’efforce de « suivre _ de texte en texte, de document en document _ le développement et la manière dont cette épiphanie s’enrichit de significations _ voilà _ à travers ses réécritures« , page 191.
…
Nietzsche y travaille d’abord lors de son séjour, l’été _ 1877 _ qu’il passe à Rosenlauibad, cherchant « à reformuler en vers l’intuition de Gênes » ;
puis, « de retour à Bâle, Nietzsche travaille à l’écriture de son nouveau livre ; et l’épiphanie des cloches se mêle de nouveau aux mots sur le désir de la mort.
…
Les deux annotations qu’on lisait sur la même page du carnet de Sorrente
sont _ alors _ recopiées sur une feuille, numéro 222 d’un dossier de feuilles volantes destinées à Choses humaines, trop humaines ;
celui qui porte sur les cloches de Gênes est intitulé Menschliches insgesamt, tout ce qui est humain ;
et celui qui porte sur le suicide Sehnsucht nach dem Tode, désir de la mort.«
…
Paolo D’Iorio en dégage ceci, page 193 :
…
« La différence la plus voyante de cette reformulation est l’usage du terme Menschliches, ce qui est humain, à la place du terme initial Sterbliches, ce qui est mortel.
Cela suggère que Nietzsche avait repris en main _ et renversé ! _ le texte de Platon. Et peut-être est-ce à cette occasion qu’il a souligné les mots (en grec) dans son exemplaire personnel de La République.
…
Dans l’étape génétique suivante,
on note deux importantes modifications.
L’aphorisme sur le suicide disparaît ; il ne sera pas transcrit et publié par Nietzsche.
Dans le même temps, Nietzsche ajoute une pointe à l’aphorisme sur les cloches, dans le sens technique du terme conclusif dans lequel se concentre l’effet que l’aphorisme veut _ maintenant _ produire. Ce terme conclusif est l’adversatif trotzdem (toutefois, malgré tout, pourtant), qui devient même _ c’est important ! _ le titre de l’aphorisme.
…
Pourtant. _ À Gênes, un soir à l’heure du crépuscule, j’entendis les cloches carillonner longuement d’une tour ; elles n’en finissaient plus et, par-dessus la rumeur des ruelles, vibraient d’un son comme insatiable de lui-même qui s’en allait dans le ciel vespéral et la brise marine, si effroyable, si enfantin à la fois, d’une infinie mélancolie. Alors il me ressouvint des paroles de Platon et je les sentis tout à coup dans mon cœur : Aucune des choses humaines n’est digne du grand sérieux ; et pourtant – -« , page 193.
…
Et Paolo D’Iorio de commenter :
« Au lieu de se limiter à ressentir profondément et à exprimer toute l’angoisse de la dévaluation du monde,de l’erreur, de la mort, l’angoisse de la condition humaine face à la vision de l’éternité atemporelle telle qu’elle avait été imaginée par Platon, par le christianisme et à travers eux par toute la tradition philosophique occidentale,
Nietzsche relève maintenant le défi _ de ces divers pessimismes et nihilismes.
Il ajoute un trotzdem : rien n’a de valeur, tout est vain ; pourtant…
…
Relever le défi signifie aussi renoncer au suicide ;
et cela explique pourquoi la genèse de l’aphorisme sur la nostalgie de la mort s’est interrompue _ définitivement _ à ce moment précis.
…
L’élaboration génétique de l’autre aphorisme, au contraire, se poursuit en introduisant une dernière modification textuelle et structurelle, très parlante.
En effet, dans le manuscrit envoyé au typographe, cet aphorisme sur la vanité des choses humaines sera intitulé _ on ne peut mieux explicitement ! _ Épilogue
et placé sur la dernière page d’un livre
qui _ ce n’est pas un hasard _ s’appellera Menschliches, Allzumenschliches, Choses humaines, trop humaines.
…
L’aphorisme, et le livre sur les choses humaines, se terminent donc par un adversatif
qui reste en suspens
et qui est suivi par deux Gedankenstricke, deux tirets de suspension.
…
Dans l’écriture de Nietzsche, ce signe typographique correspond à une stratégie de réticence
qui sert à distinguer le plus superficiel de la pensée du plus profond,
et qui invite le lecteur à méditer davantage l’aphorisme« , page 194.
…
Commentaire que renforce encore Paolo D’Iorio, page 195 :
…
« Les deux tirets placés à la fin du dernier aphorisme nous invitent donc à relire
non seulement l’aphorisme,
mais le livre entier
à la lumière des cloches du nihilisme _ à surmonter, donc… _,
l’insérant dans un contexte de pensée philosophique qui remonte _ dans un mouvement qui devient ici même, où nous le saisissons, rien moins qu’un renversement _ à Platon et à toute la tradition pessimiste _ en son entier : jusqu’à Schopenhauer et Wagner _,
et considérant que
toutefois, trotzdem,
il doit y avoir _ voilà ! _ une manière de donner _ positivement cette fois : avec un amour profond de la vie ! _ de la valeur aux choses humaines.
…
Choses humaines, trop humaines traite précisément de cela.
…
Nietzsche prend position contre Platon,
contre le pessimisme
et propose les esquisses d’une vision autre :
chimie des idées et des sentiments, confiance dans l’histoire et en la science, épicurisme, innocence du devenir, réévaluation des choses les plus proches« , page 196…
…
Mais « les aventures de l’aphorisme sur les cloches de Gênes ne sont pas encore terminées« , intervient encore page 197 Paolo D’Iorio :
…
« durant la correction des épreuves, Nietzsche ajoute, en effet, dix aphorismes avant l’Épilogue
qui dans les secondes épreuves passe du numéro 628 au numéro 638.
…
Mais ensuite, au dernier moment _ in extremis, donc _,
Nietzsche échange l’aphorisme 638 avec l’aphorisme 628 ;
et l’aphorisme sur les cloches perd ainsi sa position finale.
…
En conséquence, Nietzsche change aussi le titre de l’aphorisme
qui d’Epilog devient Spiel und Ernst, « Jeu et sérieux » _ allusion au fait que dans l’aphorisme retentit un Glockenspiel, un « jeu de cloches » _ ;
et puis, continuant dans le jeu de mot,
Nietzsche trouve le titre définitif : « Sérieux dans le jeu« .
…
Pourquoi Nietzsche échange-t-il les deux aphorismes ?
(…) Probablement, parce qu’il veut terminer le livre avec l’image _ joyeuse, en sa plénitude _ de la cloche de midi
à la place de celle du soir.
…
En effet, le dernier aphorisme intitulé Le Voyageur (Der Wanderer), se termine avec l’image des voyageurs et des philosophes qui « songent à ce qui peut donner au jour, entre le dixième et le douzième coup de cloche, un visage si pur, si pénétré de lumière, si joyeux de clarté _ ils cherchent la philosophie de l’Avant midi« , pages 197-198.
…
« De la sorte, tout en maintenant une référence intertextuelle à l’image des cloches, Nietzsche donne un caractère plus affirmatif _ voilà _ à la fin du livre,
qui renvoie au trotzdem _ avec son sens de « réticence« envers le nihilisme ; et même de « renversement« du nihilisme _ contenu dans l’aphorisme 628,
et en même temps le renforce _ encore ! _ avec une image solaire et matinale.
…
Il annonce, de plus, l’image du vagabondage intellectuel et de la philosophie du matin
qui trouveront plus tard leur expression dans Le Voyageur et son ombre et dans Aurore,
ainsi que les thèmes de la félicité méridienne et de la cloche d’azur
qui seront développés dans Ainsi parlait Zarathoustra« , pages 198-199.
…
« Ce dernier aphorisme contient également un hommage caché, d’ordre privé,
à la gestation sorrentine _ à la source même ! avec ses « épiphanies« … _ de ce livre.
…
En effet, on y lit :
« Lorsque paisible, dans l’équilibre de l’âme _ une notation cruciale ! _ des matinées, il se promène sous les arbres, verra-t-il de leurs cimes et de leurs frondaisons tomber à ses pieds une foison de choses bonnes et claires, les présents de tous les libres esprits qui sont chez eux dans la montagne, la forêt et la solitude, et qui, tout comme lui, à leur manière tantôt joyeuse et tantôt réfléchie, sont voyageurs et philosophes ».
…
Comment ne pas penser en lisant ces lignes, souligne alors Paolo D’Iorio, à l’arbre de Sorrente duquel, ainsi que Nietzsche le racontait à Malwida, lui tombaient sur la tête les pensées de la philosophie de l’esprit libre ?« , page 199.
…
« Même dans le chapitre « Sur les îles bienheureuses » de Ainsi parlait Zarathoustra, reviendra _ encore une autre fois _ l’image des pensées de Zarathoustra qui tombent des arbres, comme des figues mûres :
…
« Les figues tombent des arbres, elles sont bonnes et sucrées ; et en tombant leur pelure rouge éclate. Je suis un vent du Nord pour les figues mûres. Ainsi, pareils à des figues, ces préceptes tombent à vos pieds, mes amis : buvez-en le jus, mangez-en la chair sucrée ! C’est l’automne tout alentour, et le ciel est pur, et c’est l’après-midi ».
…
Du reste, nous avons vu que
lorsqu’il imaginait les îles bienheureuses,
Nietzsche pensait à l’île d’Ischia
qu’il avait souvent contemplée de Sorrente, depuis le balcon de la villa Rubinacci« , pages 199-200.
…
…
L’analyse du « statut et la forme de l’épiphanie dans la philosophie de Nietzsche » à laquelle procède Paolo D’Iorio
montre que « les épiphanies nietzschéennes n’établissent aucun type de relation « verticale » _ transcendante, métaphysique.
…
Ce qui apparaît au sujet n’est pas une qualité transcendante de l’objet, son essence, sa quidditas,
et pas même son sens profond _ d’où, toujours la fondamentale et profonde modestie de Nietzsche en l’ambition de son discours philosophique, ainsi que son indéfectible humour ; et cela quelle que soit la force implacable de sa fermeté à l’égard des illusions (métaphysiques) que joyeusement il ne cessera jamais de dénoncer et démonter.
…
Dans l’ontologie nietzschéenne, les essences n’existent pas,
et pas même le sens originaire des choses ;
les objets de notre monde sont des formes _ toujours métaphoriques ; et seulement phénoménales, non nouménales _ en mouvement _ ludique _ continuel,
et même dans les périodes de relative stabilité, leur sens change continuellement : « la forme est fluide, mais le « sens » _ formé toujours en un discours, et nécessairement pris dans les « rets » du langage _ l’est encore davantage » _ pour qui a à le former, élaborer, en une nécessaire imageance sienne, quand il parvient à échapper au filet des clichés les plus partagés.
…
Donc, d’un point de vue gnoséologique, les épiphanies nietzschéennes ne sont _ certes _ pas des instants d’illumination mystique (…) ; elles sont au contraire la concentration et la condensation, dans une image ou dans un concept _ que forme l’imageance ; le concept conservant toujours quelque chose de ses propres sources métaphoriques ! _, de multiples connaissances rationnelles _ connectées.
…
Les épiphanies nietzschéennes sont des moments _ en un processus qui court, voire danse !, joyeusement infini et ouvert, toujours ludique _ où se manifestent à l’improviste _ d’où la gratitude à témoigner à l’égard de ces carrefours lumineux d’inspiration _ au philosophe
toute la féconde richesse sémantique _ Nietzsche est aussi philologue _ d’un événement, d’un objet ou d’un concept« , pages 174-175…
…
« Elles sont des carrefours de signification _ voilà ! à rencontrer, sinon convoquer et provoquer : y entre toujours une très généreuse part d’aléas et de contingence ; le semi-divin Kairos passe par là…. _
parce que,
loin d’établir une relation verticale _ métaphysique _ avec les essences,
…
elles sont le point de rencontre _ ponctuel et toujours circonstanciel _ d’une relation _ toujours seulement _ horizontale de lignes _ vectorielles _ de pensée _ activement imageantes _ qui proviennent _ en partie kaléïdoscopiquement _ de contextes différents _ qu’il faut aussi savoir bien relier : avec fécondité…
…
Ce sont des instants _ poïétiques, et prodigieusement magiques _ où le sujet voit confluer _ par une inspiration qui, survenant, lui advient _,
en une seule figure mentale _ absolument électrique _ qui les résume,
les théories philosophiques, les expériences personnelles ou les images littéraires qui l’occupent à une certaine période« , page 175 : d’où la nécessité de l’excellence (de vivacité) de cet accueil et réception ; puis mise en culture…
…
« En second lieu, les épiphanies, si elles n’ont pas de transcendance, ont une profondeur, une profondeur historique _ à savoir mettre en son relief adéquat le plus riche et fécond en même temps que le plus clair et lucide.
…
En accompagnement des lignes sémantiques qui naissent de l’actualité _ électrique sur-le-champ _ de sa réflexion,
se manifestent à l’esprit du philosophe les multiples _ riches : à explorer _ stratifications du sens qui constituent l’histoire _ culturelle et civilisationnelle _ de l’objet,
c’est-à-dire les connotations qui ont été données _ de manière en partie contingente _ à cet objet à travers la littérature, l’art, la philosophie ou le simple usage linguistique (métaphores, métonymies)« , page 176.
Comme tout cela est juste !!!
…
« Et enfin, le philosophe a l’intuition de la potentialité sémantique _ en son imageance proprement philosophique _ de l’événement philosophique.
La troisième caractéristique importante des épiphanies nietzschéennes, en effet, est qu’elles sont des instruments pour produire _ poïétiquement et philosophiquement _ du sens.
…
Dans le moment _ vif et heureux _ de l’épiphanie _ éprouvée _,
le philosophe comprend qu’il peut réunir et fondre plusieurs éléments d’une tradition culturelle en une seule image
qui devient porteuse et surtout génératrice _ voilà ! _ de sens _ comme un creuset qui a déjà accueilli de nombreuses significations et qui est encore suffisamment vaste et malléable pour permettre la création _ par l’ingenium mis alors en alerte et bientôt déployé _ d’un sens nouveau s’ajoutant aux strates préexistantes et modifiant _ avec aussi du courage _ le sens de la tradition,
parfois en le renversant ou en le parodiant« , page 176 _ d’où la double dimension et critique et d’ironie-humour….
…
« Pour résumer :
dans le moment de l’épiphanie, le sujet a l’intuition de la capacité de l’objet à devenir symbole d’une vision du monde _ rien moins ! et élargie et partageable… _ grâce à une convergence de significations multiples qui à l’improviste se condensent de manière cohérente en une image« , page 176 :
c’est excellemment résumé !
…
« En outre,
il prend conscience que l’objet, à travers toute une tradition littéraire, philosophique, artistique, a été investi par des apports _ riches et féconds _ de sens
qui constituent désormais non pas sa quidditas
mais sa profondeur historique« , page 176.
…
« Et enfin,
avec le tissu _ fertile _ de corrélations existantes,
se manifestent au philosophe la vitalité et la potentialité sémantique de l’image épiphanique
qui en rendent possible le réemploi et la réinterprétation dans un nouveau contexte philosophique » _ fécond _, page 176.
…
En conséquence de quoi,
« l’épiphanie nietzschéeenne » « n’exprime pas _ métaphysiquement _ l’essence de l’objet ;
et a une valeur sémantique plus riche qu’une _ banale et stérile _ série de lieux communs.«
…
Pour Nietzsche, « l’épiphanie est l’impulsion _ dynamique et dynamisante (sinon dynamitante !) _ pour un nouveau mouvement de la pensée« , page 177.
…
Et elle « est une expérience privée,
qui donne origine à un nouveau scénario cognitif,
mais qui ensuite n’est pas nécessairement utilisée dans l’écriture du texte philosophique,
qui ne contient pas tant le moment épiphanique initial
que les connaissances et les contenus philosophiques qui en ont été tirés _ par Nietzsche.
…
Par conséquent,
les épiphanies nietzschéennes demeurent souvent confinées dans les carnets
et n’apparaissent pas en tant que telles dans le texte publié« , page 177 :
…
c’est au lecteur-défricheur et déchiffreur tant soit peu hyper-attentif, tel qu’ici Paolo D’Iorio,
qu’il appartient de les exhumer et mettre en meilleure lumière,
à leur place dans le mouvement de genèse _ riche et fécond _ de l’écriture même _ telle qu’elle résulte, en ses divers moments et strates déposées et conservées, de l’imageance même de l’auteur _ de l’œuvre,
en ses diverses et successives strates :
…
repérées, recherchées et connectées, entre elles, ainsi qu’à leurs éventuelles sources, par l’analyste chercheur et commentateur.
C’est dire l’étendue (et la patience _ en droit infinies, l’une comme l’autre ! _) de ce travail
auquel s’est livré ici Paolo D’Iorio…
…
Après avoir très précisément détaillé-analysé-commenté les successives reprises du motif de la cloche dans les œuvres ultérieures de Nietzsche,
et tout particulièrement dans les quatre parties d’Ainsi parlait Zarathoustra,
…
le chapitre « Les cloches de Gênes et les épiphanies nietzschéennes » s’achève et se boucle, pages 219-220, par un court mais significatif « Épilogue à la cloche«
qui dégage la leçon de cette épiphanie (gênoise),
à l’aune, donc, de l’œuvre entier _ en amont comme en aval de l’épisode sorrentin et de ses « épiphanies« … _ de Nietzsche ;
…
et cela à l’occasion de la re-lecture par Paolo D’Iorio d’une « note« , en 1885,
pour un projet _ qui n’aboutira pas _ de ré-écriture de Choses humaines, trop humaines en en « reparcourant » ce qui en avait été les « thèmes principaux » :
…
cette « note » se « conclut en effet par l’exclamation suivante :
« IV Conclusion :
A Gênes : Oh mes amis. Comprenez-vous ce Pourtant _ Trotzdem _ ? – – « …
…
Voici ce qu’en dégage alors Paolo D’Iorio, page 222 :
…
« Nietzsche montre ainsi qu’il est parfaitement conscient que l’aphorisme 628 _ en la version finale de l’ouvrage tel qu’il fut livré à la publication _ est la véritable conclusion, Schluss, du livre,
et que le sens de cet écrit tient justement _ voilà ! _ dans le défi,
dans le « pourtant »,
qu’après l’épiphanie gênoise _ du 10 mai 1877, pour l’audition de la cloche, et du 11 mai pour la rédaction de ce qu’elle inspirait à Nietzsche _ l’auteur lance à la tradition platonicienne.
…
Nous avons vu que dans La Naissance de la tragédie les choses humaines n’avaient de valeur qu’en rapport à la métaphysique de l’art,
et que lorsque Nietzsche ne croit plus à la métaphysique,
il doit dire avec Platon, ou mieux avec Leopardi,
qu’aucune des choses humaines n’est digne de valeur.
…
Mais ensuite
l’ajout d’un trotzdem
ouvre _ voilà ! Nietzsche « surmonte« … ; et c’est cela que signifie sous sa plume le mouvement même du « Sur-humain » (qu’il ne faut jamais fossiliser en l’image-cliché de quelque « Sur-homme » que ce soit… _
une gamme de possibilités
à l’intérieur d’un scepticisme résigné mais agissant _ par ce mouvement même de « surmonter« ; de même que la « Grande Santé » de Nietzsche lui fait « surmonter » les douleurs quasi permanentes de sa maladie : Nietzsche reprenant le fameux « Ce qui ne me tue pas, me renforce« … _,
qui s’intéresse aux choses humaines
et soutient, avec Épicure, que
certaines des choses humaines ont de la valeur.
…
Jusqu’à ce que,
grâce à la pensée de l’éternel retour du même,
toutes les choses _ en leur ensemble (ou package…) même… _ acquièrent enfin _ et au final : ainsi « surmontées« … _
une immense valeur« .
…
Voilà donc ce que je me permets de nommer « l’hymne de l’amour de la vie de Nietzsche«
_ et auquel renvoie ma citation introductive de l’Hymne à la vie (Gebet an das Leben) de 1882, chanté par Dietrich Fischer-Dieskau _ ;
…
et que je réfère, pour ma part, aux sublimes remarques (pétries d’ironie et d’humour !..) de Montaigne en commentaire à l’expression « Passer le temps« , au final _ pour lui aussi _, ou presque, de son sublime dernier chapitre testamentaire des Essais : De l’expérience (Essais, III, 13) ;
…
juste après le fameux « Pour moi donc j’aime la vie« ,
Montaigne terminera son chapitre et son livre par une célébration _ magnifique ! _ de l’inspiration _ poétique tout autant que philosophique : mais Montaigne ne les sépare pas… _ par l’intercession merveilleusement gracieuse d’Apollon et des Muses, à savoir accueillir et recevoir comme il se doit…
…
On remarquera aussi, au passage, que le développement de ce dernier chapitre _ plus que jamais « à sauts et à gambades« … _ de Montaigne
commence par un long détail très précis des maux que subissait Montaigne du fait de sa maladie de la pierre ;
…
mais quel sublime feu d’artifice alors en ce final
_ et du chapitre, et du livre, et de la vie de Montaigne.
…
Voilà ainsi _ pour Nietzsche comme pour Montaigne _ ce qu’est apprendre à vivre !
et apprendre à célébrer la vie !
à lui rendre toutes les grâces _ « condignes » dit Montaigne… _ que cette improbable et fragile, mais aussi ludique et lumineuse, vie,
mérite !..
…
Tel est le chemin de la joie…
…
Le penser itinérant de Nietzsche, en ses voyages, tel que celui à Sorrente, en 1876-1877,
est donc bien l’aventure d’un « esprit libre« , à la recherche d’une anthropologie (fondamentale) constructive et ouverte, à mettre en chantier ;
et qui est aussi, tout uniment, une éthique de valeurs vraiment épanouissantes,
afin de « bien faire l’homme« , pour reprendre le vocabulaire de notre cher Montaigne…
…
…
Titus Curiosus, ce 31 mars 2013
news and informations automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travelautomotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel