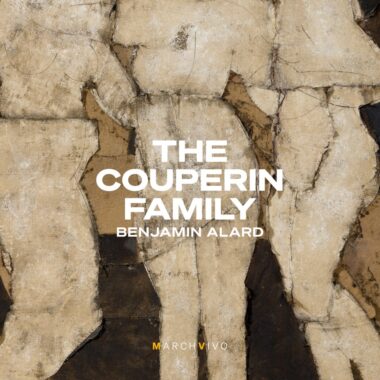…
…
Martine de Gaudemar Professeur des Universités (Philosophie) Membre honoraire de l’Institut Universitaire de France
…
…
Orphée de Monteverdi, souvent considéré comme le premier opéra, a de quoi nous instruire sur la particularité d’un art qui passe entre des mondes, et les chemins qu’il prend invinciblement vers le tragique et la plainte [1]. Orphée qui va chercher Eurydice dans le monde des enfers et tente de la ramener à la vie terrestre, cette histoire s’alimente d’un rêve millénaire où il est question du sort des disparus et de ceux qui leur survivent. Pour parler du rapport entre la philosophie et le théâtre lyrique qu’est l’opéra, il ne faut donc pas en rester à une contextualisation historique des œuvres[2] : elle pourrait nous faire croire à la mort de l’opéra, qui ne serait plus un « art vivant » [3]. Certains regardent en effet l’opéra comme un genre clos, ou même mort depuis le milieu du XIXe siècle. Il faut plutôt interroger la séduction universelle _ voilà _ de ces œuvres, longtemps après la disparition de leur contexte historique. Cette dimension de survivance est peut-être essentielle à l’opéra, qui transmet des formes de vie en les réactualisant, et interroge les bords de l’existence terrestre : la mort est donc toujours présente à l’opéra. L’opéra présente des moments forts où le chanteur semble se parler à soi-même tout en faisant entendre une plainte dans un au-delà du spectateur : les cieux sont-ils vides, ou nous entend-on ? L’opéra serait alors un art réflexif. Nous considérerons l’opéra, théâtre lyrique, comme un art dont la particularité est de s’appuyer sur une vocalité _ voilà _ qui montre la réflexion et exprime la solitude fondamentale de l’existence humaine. Or la vocalité, inscrite dans des dispositions indissolublement physiques et sociales, conduit à interroger les modes d’échange caractéristiques d’une culture. Le codage symbolique de la vocalité qu’effectue l’opéra donne à l’expressivité naturelle des corps une forme hautement culturelle et socio-historique, sans jamais perdre l’ancrage sémiotique et proto-symbolique que lui confère la voix. Cet ancrage dans la vocalité pourrait éclairer la durable fascination exercée par l’opéra, lors même qu’il a perdu ses liens avec un contexte socio-historique donné.
…
…
Au-delà de l’évidente séduction du théâtre lyrique, il faut donc interroger la véritable passion ou fascination que peut exercer une voix d’opéra, en tant qu’elle semble nous parvenir du ciel ou des enfers, d’outre tombe ou du monde des dieux[4]. Ce pourquoi le philosophe américain Stanley Cavell interprète l’opéra comme un dispositif de passage entre des mondes. Le recours à des éléments théoriques psychanalytiques, comme le font remarquer Slavoj Zizek et à sa suite Mladen Dolar[5], est très éclairant. J’invite pourtant à aller au-delà de cette approche psychanalytique, classique depuis les travaux de Michel Poizat _ oui _, en la prolongeant par les méditations de Stanley Cavell sur la voix des chanteuses d’opéra : cette voix soutient un cogito original, qu’il nomme leur claim, leur revendication et leur affirmation _ voilà _, et que nous entendons dans certains arias célèbres, pour l’écoute desquels certains d’entre nous passent des nuits entières à attendre une place pour une représentation ou se déplacent d’un pays à l’autre pour entendre une diva chanter cet « aria ».[6] Les méditations de Cavell ont de quoi nourrir une réflexion proprement philosophique sur le phénomène de l’opéra, phénomène à la fois particulier, puisqu’il est historiquement et socialement daté, et universel parce qu’il touche ou est susceptible de toucher tout un chacun. Mais pour cela, il faudra s’accorder sur le caractère fondamental et transversal d’une activité expressive fondée dans la corporéité de tout vivant, et qui prend dans l’espèce humaine une forme particulière, celle d’un langage articulé.
…
…
En quoi la philosophie est elle concernée par l’opéra ? Nous interrogerons d’abord la voix comme condition de l’opéra, avant de souligner sa dimension réfléchissante. Enfin, nous mettrons en vedette un office généralement sous-estimé de l’opéra : comme dispositif de transcendance, scindant corps et esprit, il transmet des messages des ancêtres _ disparus _ et montre, en les réactualisant, leurs formes de vie. L’opéra, au cœur de pratiques communes, fait partie de ces objets symboliques dans lesquels s’incarnent les formes de vie d’une culture, à travers lesquels une culture se réinvente tout en maintenant des règles et des valeurs ancestrales.
…
…
I – La vocalité, condition de l’opéra
…
…
La philosophie est d’abord concernée, à l’opéra, par une vocalité qui semble préluder au langage. L’opéra met en vedette la dimension d’une voix qui communique des émotions en-deçà et au-delà des messages qu’elle articule, dans une dimension proto-symbolique ou sémiotique. Voix qui peut s’entendre comme plainte et virtuel appel au secours, lorsque les personnages semblent se parler à eux-mêmes tout en s’adressant aux dieux ou à un au-delà. Cette dimension expressive pourrait préluder au langage, si « les passions arrachèrent les premières voix » et si les premières langues furent « chantantes », comme l’écrivait Rousseau. La voix se constitue elle-même à partir d’une dynamique d’expression inséparable de la corporéité des êtres vivants, dans les dialogues et les interactions propres à une culture donnée.
…
…
Plusieurs types de travaux contemporains mettent l’accent sur cette dimension sémiotique et expressve que va privilégier et mettre en vedette l’opéra :
…
a) Pour certains linguistes, le langage significatif ne pourrait s’installer que sur cette base sémiotique et expressive. La voix est en effet un geste corporel expressif qu’on peut considérer comme une condition d’émergence du langage comme forme symbolique au sens que lui a donné Cassirer (voir Visetti, Lassegue, Rosenthal, http://formes-symboliques.org/article.php3?id_article=280).
…
b) D’autres linguistes, comme Anne Lacheret et Dominique LeGallois, montrent que la syntaxe du langage n’est pas seulement logique : il y a une syntaxe affective, une prosodie porteuse de schémas émotionnels, dont témoigne la voix. Ils montrent que les modes expressifs et émotionnels du langage sont déterminants pour la production des formes langagières.[7] On a eu tort selon eux de privilégier une approche uniquement formelle et logico-syntaxique du langage alors qu’on peut s’interesser à la « prosodie sémantique », notion relativement récente (datant des années 90) proche de celle de « syntaxe affective » de Bally. Lacheret et LeGallois reviennent aux travaux pionniers de Fonagy sur la « vive voix », perfectionnent son schéma sur le double codage de la communication, et le rapprochent de la notion de « syntaxe affective ». Cela les conduit à redonner une place centrale au sujet expressif, dans une grammaire inscrite elle-même dans un processus plus global où corps et voix se conjuguent au service de l’expressivité. La voix est donc porteuse d’une activité sémiotique proto-symbolique.
…
c) Des travaux de psychologues et musicologues vont également dans le sens d’une communication expressive préverbale qui est la matrice du langage.
…
…
On trouve une trace de la dynamique d’expression d’un corps vivant en étudiant la scène des premiers échanges vocaux des nourrissons. Michel Imberty[8] et Maya Gratier[9] ont étudié le fonctionnement préverbal de bébés entre six semaines et trois mois, qui témoigne d’interactions sémiotiques humaines précoces. De nombreux travaux montrent que des vocalisations de bébés (à partir de six semaines) qui ne sont ni des pleurs ni des appels liés à des besoins vitaux ni des bruits végétatifs liés à des états physiologiques, ont précisément une structure et un contour mélodiques qui sont le vecteur de leur communication avec la personne qui en prend soin, le plus souvent la mère dans nos cultures occidentales. Des formes sonores se communiquent dans l’échange de sons alternés, et conduisent à mettre en évidence des schèmes dynamiques expressifs, proches de ceux qui sont présents dans les œuvres musicales (Michel Imberty).
…
…
L’échange vocal peut dès lors être considéré comme une « sémiôsis préverbale », voire comme une première « narration » sans paroles, une histoire « non (encore) racontée » pour reprendre une expression de Paul Ricoeur dans Temps et Récit [10] : une histoire qui en appelle à un futur récit, une histoire en quelque sorte « virtuelle ».
…
…
La voix chantonnée qui circule entre mère et nourrisson configure donc un premier espace de communication qu’on pourrait appeler un espace « transitionnel » au sens de Winnicott, puisqu’il n’est à personne en particulier mais bien entre eux, n’étant ni dehors ni dedans, ce qui permet sans doute à l’enfant de constituer un espace qui deviendra « extérieur » et de différencier moi et non-moi. Cet espace virtuel est déjà symbolique si l’on prend « symbole » au sens d’un objet quelconque qui serait la trace d’une alliance, ou manifesterait un partage[11]. Sauf que dans ce cas, le partage et l’échange sont à venir, attendus par ceux qui appellent l’enfant au langage. Cet espace, celui de l’ « entre nous », préfigure le caractère public du langage, et la dimension collective de la culture.
…
…
Or cet espace transitionnel est la condition de l’opéra, qui en est une forme codifiée et socialisée
…
…
Mais cet « entre nous », qui dispose l’échange vocal à apparaître sur une scène qui puisse le matérialiser, est inséparable des corps émetteurs de sons, capables de vocalité. On se demandera si l’opéra ne rejoue donc pas incessamment une scène d’accès au langage public, puisqu’il nous fait entendre, en-deçà du texte, les rythmes, le souffle, les timbres _ voilà _ d’une voix expressive, pré-symbolique, précédant tout message parlé <dont elle serait la condition ou la matrice>.
…
…
Le dispositif mère-nourrisson n’est d’ailleurs lui-même pas séparé de la socialité, puisqu’il y a d’autres modes d’élevage des enfants, où ce dialogue singulier mère-enfant est moins sollicité ou privilégié que dans l’éducation européenne depuis quelques siècles. Ce colloque singulier est donc lui-même un dispositif culturel. Le dispositif de l’opéra est également un dispositif particulier socio-culturel et socio-historique très sophistiqué, apparemment artificiel (qui aurait l’idée de chanter au lieu de parler ?). Mais ce dispositif hautement symbolique manifeste très clairement les dimensions passionnelles et sémiotiques qui soutiennent tous nos dialogues quand ils ne sont pas de pure description ou d’information, mais sont de réelles interactions où agir et pâtir sont mobilisés parce que des corps s’entr’expriment. En ce sens, l’opéra exhibe la dimension passionnelle des actes de parole _ voilà. Dimension passionnelle dont la condition ontologique est un corps expressif.
…
…
La dimension expressive de la voix est en effet inséparable d’un corps vivant, d’un organisme expressif, ce qui éclaire la dimension souvent troublante de la voix que le genre de l’opéra va porter à un degré d’intensité extrême.
…
…
La voix part d’un souffle qui fait vivre et vibrer le corps organique, et va vers d’autres corps grâce à un espace aérien qui transporte ses vibrations. A ce titre, la voix est de ce monde, ce monde terrestre avec ses lois naturelles : le souffle doit se sonoriser à travers un larynx et des massifs osseux qui font le masque ou la persona, par où le son résonne. Il lui faut aussi s’appuyer sur le diaphragme et les viscères, ce qui relie la voix aux poussées vitales, instinctuelles, voire sexuelles, du vivant. Présente dans la parole, la voix fait paraître cet élément énergétique et viscéral qui fait, en termes freudiens, sa pulsionnalité. L’élément pulsionnel ou libidinal vient ainsi doubler le message sémantique de nos propositions ordinaires, mais aussi des dialogues de la partition d’opéra. Or l’opéra, à travers la codification extrême de ses formes, fait entendre plus facilement que dans la vie ordinaire cette dimension pulsionnelle non dite, sous-jacente aux paroles et à la mise en scène. On écoute un chanteur dont on ne comprend souvent ni la langue ni le message significatif qui habituellement masque sa dimension expressive. C’est également le cas chaque fois que les notes de la partition sont trop aigües pour que le chanteur puisse suffisamment articuler son texte : le spectateur n’entend plus que les voyelles, la signification se perd, mais pas l’expression. La voix communique donc quelque chose comme un « contenu formel » [12] adhérent à son être de rythme, de timbre, d’intonation, un contenu sans référence déterminée. En ce sens, la voix n’est pas comme un signe, un tenant-lieu d’autre chose ; elle n’est pas non plus une simple doublure affective de la parole ; elle est comme une pensée à part entière, parfois inconnue de soi, une pensée du corps expressif, capable de se prolonger en jugements sur le monde et en catégorisations, pensée qui peut venir contredire ou démentir le message officiel porté par le texte. La voix porte par exemple une pensée qui commençait à dire « non » dans des mouvements corporels de recracher ou de repousser, dans le rejet ou le vomissement, dont le chant est comme la forme transfigurée. L’oralité est bien la base primitive du jugement, et la vocalité en est la forme pertinente, que l’opéra pousse à un degré extrême.
…
…
Cette vocalité devient ainsi la matière seconde pour différentes formes esthétiques : le chant lyrique, mais aussi l’art oratoire ou l’art de la déclamation théâtrale. L’opéra trouve dans la vocalité une origine commune avec d’autres arts, ce qui lui donne avec eux un air de famille. Ce qui spécifie le travail de la voix à l’opéra est double. Développée et comme hypertrophiée de manière aussi monstrueuse que le ferait quelque bodybuilding, de façon à pouvoir être entendue malgré le jeu d’instruments d’orchestre de plus en plus nombreux, de Monteverdi à Verdi et Wagner (de façon à « passer par-dessus l’orchestre »), la voix à l’opéra est paradoxale : elle est marquée singulièrement par le timbre et le tempérament de l’interprète, et elle est pourtant suffisamment dépersonnalisée pour devenir la voix d’une famille de personnages dont la parenté est culturelle autant que psychologique. Pensons à Callas chantant Desdémone, Norma, Médée ou Tosca.
…
…
L’opéra conjugue donc deux dispositions très différentes, qu’il unit harmonieusement : une disposition pulsionnelle et expressive qui fait entendre l’appel fondamental de la voix humaine, de manière souvent déchirante et troublante, et un dispositif culturel fait d’intrigues et de scénarios ancestraux où des personnages mythiques luttent pour le pouvoir politique, la possession amoureuse, la vie et la mort.
…
…
– On peut être tenté à juste titre de recourir aux instruments de pensée de la théorie psychanalytique pour éclairer la puissance séductrice de l’opéra.
…
…
Le mythe oedipien mis en avant par Freud, en premier lieu, dans sa composante indissolublement familiale et politique, la lutte amoureuse étant inséparable de la lutte pour le pouvoir. Or les intrigues de l’opéra jouent très fréquemment sur le double registre du drame politique et familial. Mais aussi la théorie lacanienne des objets « a », dont la voix est un des exemples les plus déroutants[13]. La voix est en effet un objet insaisissable, fuyant et affolant, propre à figurer l’inconscient dans son évanescence et son pouvoir inconnu. Lacan donne plusieurs listes des objets « a », objets inséparables d’un corps tels que le sein, le pénis, les excréments. Ces objets, en rapport avec des orifices du corps (là où le corps entre en contact avec une extériorité), sont des vecteurs de la communication dedans-dehors, ils sont porteurs d’un échange ou d’une interaction avec des personnages primitifs comme Mère et Père. Les psychanalystes, M. Poizat[14], J-M. Vives[15] et S. Zizek soulignent que les objets « a », et en particulier la voix, sont conducteurs d’une jouissance qui ne peut être maîtrisée, et qui apparaît donc comme excès La théorie des objets « a » prolonge donc la théorie freudienne des pulsions. Ricoeur souligne que la pulsion, chez Freud, est prise dans une dynamique de représentation qui rapproche la théorie de la pulsion de la théorie spinoziste du conatus ou de la théorie leibnizienne de la monade expressive [16]. Dans toutes ces théories, on cherche à unir _ voilà _ un élément énergétique et un élément représentatif. Les objets « a » et en particulier la voix, servent la dynamique corporelle expressive qui conduit au langage. La pulsion venant à se représenter dans l’élément vocal prend forme à travers les systèmes symboliques propres à une culture donnée. La voix, apparemment immatérielle car faite de souffle, sort du corps et unit auditeurs et émetteurs. Elle s’effectue à partir des deux extrêmes du silence et du cri inarticulé. Quand elle est entendue à l’opéra, elle frôle souvent ces deux extrêmes, s’approche du cri et côtoie le silence _ oui. L’amateur d’opéra la recueille comme un miracle, réchappée de ces deux écueils, tout en restant vulnérable et capable de se casser. Une expiration mal sonorisée montre à tout un chacun ce que c’est qu’expirer, et c’est sans doute pourquoi la mort est si présente à l’opéra, l’intrigue venant représenter visiblement ce qui se joue matériellement ou sensiblement dans la voix entendue et sa proximité à l’extinction ou la cassure. Ce pourquoi Orphée, premier opéra (1607), est aussi un opéra emblématique, où il est question d’arracher une voix à la mort en se servant des pouvoirs de la mélodie : la plainte d’Orphée est devenue célèbre à travers le lamento de Gluck Que faro senza Eurydice ? http://www.youtube.com/watch?v=taa2bB_iH4s.
…
…
II L’opéra, un genre réflexif ?
…
…
La méditation de Stanley Cavell sur l’opéra nous entraîne plus loin que ne le fait la psychanalyse tout en travaillant et prolongeant des intuitions voisines, comme si elle donnait ou dévoilait le soubassement métaphysique d’une théorie psychanalytique qui n’en veut rien savoir. S. Cavell souligne que le dispositif de l’opéra, sorte de dispositif de transcendance, produit un divorce entre voix et corps, la voix étant en quelque sorte « désincarnée » (disembodied) dans le corps du chanteur, et par là entre deux mondes, le monde terrestre et le monde de l’au-delà auquel nous aspirons et auquel s’adressent les personnages qui se lamentent. L’opéra travaille, sur le mode tragique, la condition corporelle et mortelle de notre existence :
…
« le chant, et, je suppose, l’air d’opéra, exprime le sentiment d’être pressé ou écartelé entre deux mondes, l’un où l’on est vu, le monde à peu près familier des philosophes, et l’autre depuis lequel on vous entend, auxquel on délivre ou abandonne son esprit, <..>, et qui s’évanouit quand cesse le souffle du chant.[17] <..> « Mais il n’y a pas de langage de cet autre monde, il nécessite une compréhension sans signification »[18]
…
…
Orfeo de Monteverdi le montre bien : il n’y a pas moyen de ramener Eurydice à la vie, dans notre monde terrestre. Une figure fantomale d’Eurydice suit Orphée qui a enjambé les deux mondes, mais elle est évanouissante comme un songe, et disparaît dès qu’on veut la saisir. Cavell souligne le silence terrible _ oui _ d’Eurydice qui ne donne aucun signe d’existence à Orphée. Lui fait-elle ainsi « ressentir son absence, qu’il ne peut supporter », comme le suggère Cavell ?[19] La leçon de l’opéra pourrait être plus terrible encore : les morts ne reviennent pas, nous avons à vivre avec et malgré leur absence _ voilà. L’opéra en ce sens ne cesse de nous rappeler notre condition finie et mortelle.
…
…
Cavell voit dans l’opéra un dispositif qui montre notre destinée de solitude métaphysique et de « séparation » (separateness), dans laquelle s’enracine la réflexivité : Orphée expose au grand jour
…
«le monde de la séparation d’avec soi-même, dans lequel la division de soi dans la parole est exprimée comme la séparation d’avec quelqu’un qui représente pour soi la continuation du monde <..>. Le caractère atroce ou absolu de cette séparation semble emprunter à la fois à la séparation propre à l’enfance (le niveau du narcissisme primitif, où le cri, que Wagner voit comme l’origine du chant- est encore audible) et à une séparation des possibles représentée par la perte de celui qui est revenu du domaine de la lumière, en qui des espoirs d’intelligibilité ont été placés, et s’effondrent. »[20]
…
…
A la séparation propre à l’enfance qui doit se séparer du continent maternel et rejoindre le monde symbolique de la parole et des significations partagées qu’on retrouve dans les intrigues de l’opéra, viennent faire écho les voix déchirantes de Desdémone, Violetta, Tosca ou Mimi, qui se plaignent de l’abandon, de l’injustice ou de la mort qui vient. L’opéra transfigure ces situations douloureuses induites par la mort et l’impuissance, les transformant, l’espace d’un chant, en moments _ un peu développés _ de bonheur et de jouissance. Transfiguration qui atteste des pouvoirs de la musique. Comme le magicien _ Prospero _ de la Tempête nous fait oublier notre condition pendant l’espace de la représentation. Cavell souligne d’ailleurs la filiation entre drame Shakespearien et opéra classique.
…
…
Plus étrange encore, la voix d’opéra extériorise une dimension réflexive souvent associée à l’intériorité, donnant à l’opéra la fonction de montrer la pensée en acte. Cavell note
…
« le nombre de fois qu’un personnage wagnerien – à travers le Ring, par exemple- est décrit dans les indications scéniques de Wagner comme « absorbé dans une sombre méditation » ou « comme s’il se réveillait d’une profonde rêverie » (ce que je considère indiquer des pensées rêveuses sous la traduction). Wotan décrit cela à Brunhild de manière plus fataliste : « Ce qui gît dans mon sein sans être rapporté/Cela doit pour toujours demeurer un non-dit ;/C’est à moi que je parle, quand je te le conte. » (La Walkyrie, acte II, scène 2. Cette traduction à l’ancienne mode s’écarte assez joliment de la langue commune dans son effort pour préserver le fait que Wotan parle à sa fille en une inaudible réflexion extérieure »).
…
…
On peut appeler cette dimension « chant narcissique », ou encore « structure auto-réflexive » du chant d’opéra, ce qui permet de faire du chant lyrique « une figure de la pensée ». Cavell va jusqu’à comparer cette direction du narcissime lyrique avec la preuve cartésienne de l’existence qu’on trouve dans le Cogito : « un retour vers le soi qui se préserve lui-même tout en admettant la disparition du reste de la création ». Non sans provocation, Cavell propose Carmen chantant la seguedilla [21] comme figure correspondant à cette dimension réflexive et narcissique du chant lyrique :
…
« L’annonce la plus précise dans l’opéra – celle qui vaut comme défi le plus approprié – du fait de la pensée comme narcissisme, de son exposition, séduisante ou comme séduction, est la « séguédille » de Carmen, chantée et dansée sous les yeux brûlants de la possessivité et des conditions de Don José. José : « Je t’avais pourtant dit de ne pas me parler » ; Carmen : « Je ne te parle pas…, je chante pour moi-même, Et je pense…qu’il n’est pas interdit de penser ».
…
…
Cavell suggère que la seguedille de Bizet fait partie de la reconnaissance par l’opéra de ses propres pouvoirs et des pouvoirs du chant ; elle n’est pas un simple artefact localisé du personnage de cette femme (Carmen) dans cette structure [22].
…
…
Certes Carmen est aussi, comme personnage, une affirmation de la vie terrestre, laquelle ne vaut d’être vécue que dans la dimension de la liberté d’un désir qui défie les lois, au risque de la mort. Dans la Habanera, Carmen parle de son cœur « libre comme l’air ». A l’acte II, scène 4, elle se moque de Don José qui veut revenir à sa caserne : il n’est pas question d’arrêter de chanter et de danser. La vie continue « là-bas, là-bas dans la montagne », avec « le ciel ouvert, la vie errante, la liberté » [23]. Son chant exprime par là son cogito, son affirmation d’existence dans cette forme de vie, et le jugement qu’elle porte sur le monde. L’exposant comme pensante, son chant « l’expose au pouvoir de ceux qui ne veulent pas qu’elle pense, c’est-à-dire qui ne veulent pas de preuve autonome de son existence. » [24]. Cavell rapproche cette dangereuse affirmation de soi du désir masculin de savoir (et ne pas savoir) ce que les femmes savent, du désir de capter ce savoir et de s’en emparer pour aboutir à une certitude de soi. « Carmen est l’interprète de ce savoir ». Elle déclare à la face du monde qu’elle pense, qu’elle existe ainsi, dans cette liberté, dans une solitude métaphysique inséparable d’un narcissisme séducteur. Elle incarne l’exigence de reconnaissance qui caractérise la voix _ oui. Au risque qu’on la fasse taire à jamais.
…
…
En même temps que la dimension narcissique et autoréflexive du chant d’opéra, Cavell met l’accent sur le développement de l’agency intellectuelle qui s’appuie sur l’oralité dans son aspect primitif. Il fonde sa confiance en ces possibilités de développement de l’oralité vers la pensée et le jugement sur le célèbre texte de Freud, La Négation. S’il est vrai que les plus anciennes motions pulsionnelles sont les motions orales, la polarité du jugement (bon/mauvais) correspond aux deux grands groupes de pulsions, celles qui relient _ Eros _ et celles qui délient _ Thanatos. L’affirmation ou l’admission est le substitut de l’implication, et la négation ou le rejet est le successeur de l’expulsion. « La base orale, primitive, du jugement équivaut à un jugement sur le monde, à son affirmation ou à sa négation dans chaque énoncé ou exclamation ».
…
…
Alors, conclut S. Cavell, « nous paraissons avoir un indice des raisons pour lesquelles l’opéra s’accorde aux moments de séparation, comme si c’était le traumatisme fondateur de l’expérience humaine » .[25](p. 208). La séparation n’est pas seulement une caractéristique du tragique de notre condition déchirée entre corps et esprit, entre moi et l’autre, ou entre ici-bas imparfait et frustrant, et quelque monde supérieur auquel nous aspirerions et que le chant susciterait l’espace d’un instant. Elle est aussi la condition de la pensée, d’une évaluation qui est inséparable de l’affirmation. Cavell propose donc que nous concevions la voix dans l’opéra comme Kant le faisait du jugement esthétique, qui prétend à l’universalité à partir d’un plaisir sans concept : la voix d’opéra doit être entendue « comme un jugement sur le monde fondé sur (ou suscité par) une souffrance sans concept » [26] :
…
« On ne peut exiger de vous que vous preniez les événements aussi fort et aussi loin que le font Desdemone, Aïda, la Léonore de Verdi, Carmen, Brunhild, la Maréchale et Mélisande. Mais vous pouvez être irrésistiblement conduit à écouter et à comprendre, au-delà de toute explication ».
…
…
Si l’opéra est une machine qui exhibe l’oralité primitive de nos jugements sur le monde, il reste qu’elle met en scène cette oralité à travers des personnages et des intrigues _ oui _ qui dessinent les rapports humains fondamentaux tels qu’envisagés dans notre culture. Du sémiotique au sémantique, en passant par le jugement primitif sur le monde, l’opéra joue sur tous les tableaux de l’expression.
…
…
III Opéra et transmission des formes de vie
…
…
On a montré que l’art lyrique qui s’exprime dans l’opéra relève à la fois de l’universel et du particulier : en même temps qu’il est un art sophistiqué et relevant d’une culture très particulière, il met en forme des dispositions universelles à l’expression et au langage, que la philosophie ne cesse de travailler. Le nouveau Cogito porté par le chant d’opéra fait de l’opéra un genre qui continue la philosophie… avec d’autres moyens. Qu’importe alors si le genre opératique est considéré par certains comme clos, parce qu’il ne travaillerait plus que sur son propre « répertoire ». Il faut précisément s’interroger sur ce lien fort à un héritage (l’opéra comme art de l’interprétation de l’héritage ?), au lieu de faire de l’opéra un « monument funéraire », « a wonderful mortuary » comme semble le faire Carolyn Abbate dans A history of opera [27]. Et si l’opéra, de nos jours, avait précisément cette fonction de rappeler quelque chose des manières de vivre de nos ancêtres, leurs idéaux, leurs normes, interrogeant ainsi les difficultés à transmettre un héritage, mais aussi la difficulté à hériter de nos ancêtres ? S’il jouait le rôle d’un rituel commun, dans une société qui revendique l’incroyance et dénie ce caractère d’organisateur collectif des émotions ?
…
…
L’opéra semble jouer dans notre culture le rôle d’agent de transmission des mythes et de leurs émotions associées _ voilà _, celles de la passion amoureuse et politique, celle des ardeurs, folies et drames familiaux. Le spectacle d’opéra actualise publiquement ces virtualités passionnelles transmises par les récits collectifs, faisant office de catharsis tragique en un temps de disparition de la tragédie antique. En ce sens, la méditation Cavellienne de l’opéra vient prolonger les explications psychanalytiques. En effet, on peut penser que le mythe oedipien mis au grand jour par Freud est un des mythes fondateurs de notre culture, en ce qu’il réunit la lutte pour le pouvoir, l’appropriation d’une femme capable d’enfanter et le meurtre symbolique des figures parentales. L’opéra ne cesse de transmettre ou de travailler les légendes et les mythes légués par nos ancêtres, les faisant passer et repasser par la conversation sociale. Phèdre, Médée, Electre, Hamlet, Don Giovanni, Carmen, Macbeth, Brunhilde, les personnages mythiques viennent sur une scène d’opéra rejouer leur destin funeste et interroger les stuctures qui président à ces destins, mais aussi les complicités ou les lâchetés qui ont facilité les catastrophes.
…
…
Les personnages reviennent d’âge en âge, réactualisés _ oui _, leurs voix « désincarnées » dans les corps de nouveaux chanteurs [28]. Les personnages sont des repères _ oui _ dans la transmission des valeurs et des normes, ils permettent d’identifier les rapports au monde et à autrui qui font les formes de vie, ils balisent notre espace en demandant à chacun la reconnaissance de cette forme de vie. Desdémone ou Tosca, Médée, La Comtesse ou la Mareschale, témoignent par exemple d’une souffrance liée indissolublement à l’existence humaine et à la condition faite aux femmes dans notre culture. Leurs voix font entendre la réponse qu’elles ont choisi de donner ou n’ont pu que donner à cette condition : Carmen n’est pas Mimi ni Desdémone, trop douces et résignées, mais elle est parente de Médée et se bat jusqu’à la fin, continuant à faire entendre sa voix. Comme la souffrance d’autrui m’impose de la reconnaître, la voix ne peut pas ne pas être entendue : la surdité même de Jason à la voix déchirante de la Médée de Cherubini (http://www.youtube.com/watch?v=E5YsWZTlg8c) témoigne qu’une voix s’est élevée. C’est pourquoi Cavell dit que l’opéra témoigne de la capacité humaine à élever la voix _ et la donner à entendre, en chant _ dans le drame de l’existence. Le lamento lui-même est la forme musicale qui convient le mieux à cette expression. Lasciatemi morire, chante Arianna chez Monteverdi.