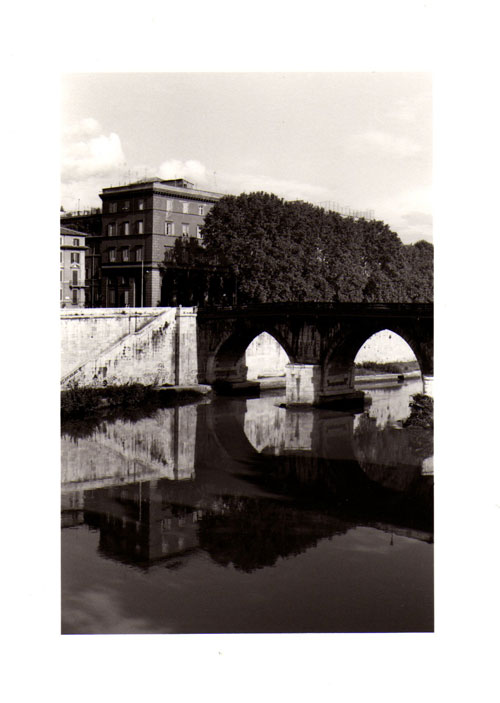Un essai d’analyse des raisons essentielles et circonstancielles qui ont conduit René de Ceccatty à ce choix d’objet d’écriture du portrait du « Soldat indien » déchu, et des moyens mis en oeuvre pour la réalisation factuelle et sensible de cet objectif quasi a-romanesque…
03fév
Pour répondre aux tâches d’élucidation de la poiétique de René de Ceccatty en son « Soldat indien« ,
que me suis fixées hier, en mon article « Un certain goût de l’ailleurs, mais un refus du romanesque et l’horreur de l’oubli d’un passé qui n’a pas dit son dernier mot : un cadre de recherche pour l’analyse de la poiétique de René de Ceccatty en la succession de ses récits autobiographiques« ,
…
c’est-à-dire les raisons du choix de ce portrait des aventures surtout militaires en Inde, entre le 9 septembre 1757 _ le débarquement du vaisseau « Duc de Bourgogne« à Pondichéry, et l’arrivée en Inde de Léopold Pavans de Ceccatty (Quingey, 24 février 1724 – Salins-les-Bains, 3 février 1784)… _ et 1771 _ le rembarquement pour la France de Léopold, son épouse créole Marie-Jeanne Lenoir (Pondichéry, 28 octobre ou 2 décembre 1741 – fictivement Salins-les-Bains, 1835), et leurs deux filles Jeanne (Pondichéry, 30 décembre 1759 – 1838) et Marie-Anne (6 février 1764 – après 1794, où elle se marie), le Canadien Louis Legardeur de Repentigny ayant été nommé, plutôt que Léopold, gouverneur de Pondichéry dès juillet 1769, et Léopold, nommé, lui, commandant par intérim de la forteresse de Karikal ; mais « les combats terminés, il n’a plus de raisons de rester en Inde, puisque c’est un soldat« , conclut, page 47, le chapitre intitulé « Pondichéry et Madras« : Léopold forcément obéit et rentre en France, avec son épouse et leurs deux filles, toutes les trois nées en Inde… _, de l’ancêtre Léopold Pavans de Ceccatty ;
…
mais aussi, et bien plus encore, le difficile retour (et ré-acclimatation et survivance) de cette famille en quelque sorte « rapatriée » _ pardon de cet anachronisme… _ dans le Jura natal du pater familias Léopold Pavans de Ceccatty, « soldat déchu » d’une guerre très lointaine finalement perdue _ sur ordre du roi, le gouverneur général de l’Inde française et chef des armées Thomas-Arthur de Lally-Tollendal l’a, lui, cette perte, payée de sa tête, tranchée en Place de Grève, à Paris, le 9 mai 1766 ; « Léopold, qui était toujours en service aux Indes en 1766, cinq ans après la chute de Pondichéry et trois ans après le Traité de Paris qui scellait la perte des Indes, mais maintenait _ cependant _ Pondichéry sous l’autorité de la France, échappa donc à l’ordalie _ voilà. Il espéra un temps récupérer le gouvernement de Pondichéry, encore éphémèrement française, mais c’est _ en juillet 1769 _ le Canadien Louis Legardeur de Repentigny qui fut nommé à sa place. Et on céda à Léopold le commandement de la forteresse de Karikal. Mon pauvre ancêtre« , lit-on page 30 _, récompensé malgré tout, in fine, à son retour en France, en 1771 _ faute d’archives retrouvées les mentionnant, le détail et les dates précises de ce retour en France font défaut, manquent _, donc, par son installation en un assez bel hôtel particulier à Salins-les-Bains, où Léopold et sa famille désormais résideront ;
…
et cela, je veux dire ce portrait rétrospectif du parcours de défaite du soldat déchu, est ici recomposé, tant bien que mal, dans un probable but de servir aussi d’exemple quasi atavique _ destinal… _ des échecs in fine d’installation dans les colonies d’Afrique du Nord (Algérie et Tunisie) des générations immédiatement proches _ parents, grands-parents, arrière-grands-parents : les Pavans de Ceccatty, du Jura, à Sfax, en Tunisie, dès 1903 ; les Durand de l’Albigeois, au Telagh, en Algérie, dès 1884 ; et Michel Antony, de Moncale, près de Calvi, en Corse, garde-forestier, au Telagh, avant 1896 ; avant d’être nommé en Tunisie, à Hammam Lif, puis Béja, etc. _, de l’auteur-narrateur du récit, René de Ceccatty, né à Tunis le 27 décembre 1951, et « rapatrié » en France, à Montpellier, à l’âge de 6 ans et demi _ l’avion de ce pseudo « retour en France » du natif de Tunis, avait atterri à Marignane le 28 juin 1958 (la date nous est donnée à la page 42 d' »Enfance, dernier chapitre« )…
…
En même temps, qu’il répond à _ et fait fi de _ l’infra légende familiale, transmise, mais avec bien peu de gloriole, d’un ancêtre qui aurait été gouverneur de l’île de la Réunion. C’est d’ailleurs sur cela que s’ouvre, page 7, l’Avant-Propos au livre, par ces mots-ci :
…
« Sur la foi de légendes familiales, je croyais que j’avais, nous avions, mon frère, mes cousins et moi, un ancêtre qui avait été, au XVIIIe siècle, gouverneur de l’île de Bourbon, l’actuelle île de la Réunion. (…) Sans que jamais personne, durant les deux siècles, bientôt trois, qui nous séparent de sa vie, n’ait eu la volonté et la patience d’enquêter. Un récent voyage dans cette île m’ayant séduit, car j’y voyais des caractéristiques géographiques qui m’évoquaient l’Enfer, le Purgatoire et le Paradis de la Divine Comédie que j’étais en train de traduire, j’avais été conforter dans cette idée _ d’aller y regarder enfin d’un peu plus près : dans les archives et les livres d’histoire… Or, ayant entrepris le récit de ma vie, dans mes deux livres précédents _ « Enfance, dernier chapitre« , en 2017, et « Mes Années japonaises« , en 2019 _, j’ai eu l’idée de remonter dans le passé, pour comprendre _ voilà le fin mot du projet de ce nouveau volet rétrospectif des « récits de sa vie« , de René de Ceccatty… _ la logique ou l’illogisme de l’installation de mes grands-parents dans les colonies nord-africaines. N’y avait-il pas une fatalité _ voilà… _ dans ces départs, ces défaites, ces exils, ces confrontations avec d’autres langues, d’autres cultures, d’autres modes de vie ? » _ et bien sûr il me sera absolument nécessaire de revenir bientôt à ce foyer incandescent de la question…
…
…
Se pose ainsi la question, puissante, mais peu visible, et en arrière-fond permanent de ce projet d’écriture du « Soldat indien« , des colonisations et décolonisations.
…
Ainsi, voici ce que je me permets de relever de la très parlante page conclusive, page 15, de lce décidément très riche Avant-Propos de l’auteur à son livre :
…
« Quant aux colonisations et décolonisations, on ne sait que trop qu’il est difficile d’en faire l’histoire sans désavouer des choix politiques anciens _ dès le XVIe siècle, pour la France, avant même les politiques clairement assumées de Colbert, Bugeaud et Jules Ferry… Ce n’est _ assez clairement _ qu’une suite d’abus, d’erreurs, de désaveux, d’oublis. Les réhabilitations, les compensations, les actes de contrition sont pour la plupart hypocrites, dérisoires, vains. Oublier _ en esquivant de se pencher sur ce passé-là _ est assurément une volonté de falsification et de réécriture _ négationniste, de fait, en ses résultats _ de l’histoire, et trop rappeler _ tels de mécaniques clichés _ est également ambigu. On se contente de demi-mesures, le plus souvent, et d’accommodements _ ambivalents, confus, et générateurs de plus encore de confusion et de détournement de sens _ avec le passé.
…
De cet accommodement _ voilà _, je n’ai pas voulu. Je n’ai pas voulu romancer _ c’est dit _ une histoire à partir de traces si rares, tant dans des papiers familiaux que dans des registres d’état-civil conservés aux Archives d’Outremer à Aix-en-Provence. L’hôtel familial acquis par Léopold à Salins-les-Bains, à son retour _ en 1771 _ a été transformé en gîte de luxe, l’Aristoloche, nom dérisoire qui _ en effet _ dit tout.
…
Ni éclat, ni silence, tel a été mon choix.
Beaucoup de dates, beaucoup de noms, qui jalonnent cette promenade dans le passé et lui donnent une allure, sinon une garantie d’objectivité.
…
Les êtres qui vivent _ d’une vie vraie _ dans mon imagination _ c’est-à-dire ce que je nomme l’imageance de l’écrivain profondément honnête et profondément soucieux de justesse en son travail et ses modalités _ sont ceux dont je ne connais _ mais vraiment, et en vérité _ rien d’autre que ce que quelques artistes _ écrivains, peintres, musiciens _ m’ont permis _ par les figurations vivantes et honnêtes qu’ils ont esquissées, tracées, fixées un peu, en les compositions de quelques œuvres qui demeurent et nous sont accessibles _ de connaître _ et en vérité, et vraiment, il faut y insister. Car il faut bien essayer, et le plus honnêtement et rigoureusement possible, de pallier, du mieux qu’il nous est possible, et si cela n’excède pas cet ordre du possible, les manques de traces et documents des archives quand celles-ci font défaut, les taches aveugles qui persistent dans nos efforts de figuration… Et de fait, quelques transpositions d’œuvres d’art, et à condition que celles-ci, déjà, aient été le plus honnête qu’il leur était possible d’être, peuvent nous y aider… Anjâli est _ ici _ le seul nom inventé _ pour l’ayah imaginée (à partir de l’ayah figurée dans la conversation piece de Johann Zoffany Colonel Blair with his Family and an Indian Ayah présente sur le bandeau du livre…) ramenée des Indes par Léopold et sa famille… _, les autres _ sans aucune exception _ désignant des personnages _ ou personnes ayant réellement vécu _ de l’Histoire et de la mienne« , page 15,
au final explicite de la dernière page de l’Avant-Propos.
…
…
…
Mon second objectif, maintenant, est d’essayer d’éclairer en détails toute la finesse de la palette lumineuse des modalités _ disons littéraires, mais ce mot est trop étroit… _ de reconstitution _ pas proprement (ni sèchement) historique, ni éperdument romanesque, non plus _, de ce double portrait, à double versant, l’aller, en les colonies d’Inde, puis le retour, au Jura, à Salins-les-Bains, de Léopold et sa famille, en évitant, en le récit ainsi réalisé, les ficelles et artifices de mauvais goût (en vue de simplificatrices mensongères identifications des lecteurs aux personnages ainsi portraiturés) de l’excès d’incarnation du pur et dur romanesque… ;
de même que des maladresses d’anachronismes qui seraient abusifs…
…
…
Ainsi, l’usage de descriptions détaillées, et très légèrement commentées, d’images de scènes peintes (de « conversation pieces« ) heureusement transposées dans le Jura de 1773 _ Johann Zoffany (Francfort, 13 mars 1733 – Strand-on-the-Green, 11 novembre 1810) et Nicolas-Bernard Lépicié (Paris, 16 juin 1735 – Paris, 15 septembre 1784) ; voire, mais quelques années plus tard, et pour de sombres paysages, cette fois, Gustave Courbet (Ornans, 10 juin 1819 – La-Tour-de-Peilz, 31 décembre 1877), le peintre admirable des résurgences de la Loue…) ici, après le Jožef Tominc (Gorizia, 6 juillet 1790 – Gradišče nad Prvačino, 24 avril 1866) du passionnant et fascinant « L’Hôte invisible » de René de Ceccatty, en 2007… _ et habilement intégrées dans l’intrigue narrative du récit, sont-elles, alors lumineusement belles et éclairantes, en effet.
…
…
C’est donc sur ces objectifs de figuration la plus « authentique » possible _ avec ce mot et cette idée d’idéal que chérissait tant, et d’abord et surtout en les vies même, la mère de René de Ceccatty _ du passé, et ces moyens littéraires les plus honnêtes et justes-là que met en œuvre René de Ceccatty en son récit, que je veux concentrer ici mon attention…
…
…
Et le narrateur-auteur consacre en effet, au passage, au fil de son récit, et comme il aime tant le faire, de passionnantes remarques de très léger commentaire, toujours juste et incisif et éclairant, à cet effort sien de trouver divers moyens, et qui soient les meilleurs et les plus honnêtes et rigoureux possible, y compris de descriptions d’ordre pictural, à ses essais de figuration-saisie par son écriture de « formes » fugaces, particulièrement intenses, en leurs éclats et leurs éclairs, à destination d’une aide aux représentations-incorporations des figures présentées, par les lecteurs-récepteurs les plus éveillés possible de son livre…
Un peu à la Brecht.
…
…
Et c’est peut-être même là l’objet principiel et principal, fondamental, de ce livre-ci _ même si ce n’est pas tout à fait nouveau dans le travail de figuration-écriture de René de Ceccatty ; je pense ici à ces assez nombreuses parenthèses et incises de lumineuse auto-réflexion sur sa dynamique d’écriture, tout au long, par exemple, des 432 pages de ce chef d’œuvre si riche qu’est Enfance, dernier chapitre _ :
…
cet effort de saisie-figuration _ de la part de l’auteur, à son écritoire, en son cahier acheté à Mégrine, ici ; mais aussi de la part de son lecteur, en sa lecture… _ du jeu ultra-rapide et saisissant, pour qui les reçoit, de forces et formes mentales extrêmement furtives, fuyantes, à peine entr’aperçues, mais si intenses et fascinantes, si puissamment prégnantes pour qui ne les fuit pas, mais désire les affronter vraiment, s’y confronter en vérité, les recevoir vraiment, à l’image de ces images quasi hors de saisie (et ressouvenir) des rêves de la nuit, dont ne demeure, au réveil, que la déception d’une aveuglante queue de comète enfuie et maintenant disparue…
…
Ce qui ne manque pas de m’évoquer le si beau poème de John Donne, que je n’ai pas oublié :
…
…
…
Et je commence donc par revenir, à nouveau, sur cette ouverture capitale et clé, à la page 12 de l’Avant-propos à ce « Soldat indien » :
…
« L’histoire de Léopold et le rapport _ décisif, exemplaire _ que j’entretiens avec elle sont des formes _ mais quasi informes : a-figuratives, et a fortiori a-romanesques ; telles des taches aveugles, des blancs _ d’effacement _ tant de l’Histoire générale, que de l’histoire familiale, et peut-être aussi de l’histoire personnelle de René de Ceccatty (mais, bien sûr, pas que de lui !) : cf la citation magnifique de Scott Fitzgerald (dans « La Fêlure« ) sur laquelle s’est penché et a glosé Gilles Deleuze, dans un de ses appendices à « Logique du sens« : « Toute vie est bien entendu un processus de démolition« … _ accepté, mais aussi de lutte _ protestataire _ contre l’oubli _ voilà. J’ai voulu, à ma manière, résister _ voilà ! _ à la profanation. Voilà la raison pour laquelle j’ai mis en regard _ voilà : mettre en regard, en regards réciproques ; c’est mieux que simplement relier ou mettre en connexion ; les regards qui regardent vraiment sont actifs… _ la profanation des tombes du cimetière de Mégrine , aux bords du lac de Tunis, et cette résurrection _ par le récit de ce « Soldat indien« … _ d’une figure mineure du passé _ historique de l’Histoire des Indes françaises : la figure de Léopold Pavans de Ceccatty, capitaine du régiment de Lorraine ; une figure souvent présente, mais sans que son nom soit nommé ; simplement sa fonction au sein de l’armée des Indes… Cette figure, je n’ai pas voulu, comme on aurait été en droit de s’y attendre de la part d’un écrivain, lui donner une forme biographique, ni une forme romanesque _ les figures devant, en effet, prendre au moins quelque forme, pour pouvoir être fixées, saisies et conservées au moins un moment, et retrouvées, en la mémoire, ou en une œuvre un peu stabilisée ; mais laquelle, ou lesquelles formes ? Et comment ? Par quels moyens ?.. De quels instruments qui soient le mieux adéquats possibles dispose donc, en sa palette, un écrivain tel que René de Ceccatty ?.. Nous allons donc découvrir, au fil de son récit, les moyens que celui-ci s’est trouvé, a inventés ou fait siens, et réunis, pour ce projet propre, assortis, au passage, mais sans lourdeur, de quelques précieux commentaires sur ce travail de figuration de ces fulgurantes formes furtives fascinantes, si difficiles à saisir et figurer, j’y insiste...
J’ai voulu l’aridité d’un récit qui ne cache ni ses manques _ de références historiques et biographiques factuelles _ ni ses difficultés _ d’écriture la plus adéquate possible à ce projet-ci _ à faire renaître _ à la représentation intriguée du lecteur _ un homme obscur« _ un homme sans qualités suffisamment distinctives pour nous lecteurs d’aujourd’hui ; mais simplement à sa place, en sa fonction, au sein d’opérations militaires.
…
(…) Comme cela m’est arrivé plusieurs fois dans d’autres livres _ tel, par exemple, « L’Hôte invisible« … _, j’ai eu surtout _ et c’est à relever _ recours à des œuvres picturales.
…
Ici pour imaginer les derniers jours de Marie-Jeanne Lenoir, la veuve _ en 1784 : elle survit à son mari _ de Léopold, et de ses deux de filles _ toutes les trois nées en Inde, en 1741, 1759 et 1764, et transplantées en France, dans le Jura, à Salins-les-Bains, en 1771… Trois tableaux m’ont _ ainsi _ servi de fils conducteurs : une œuvre de Johann Zoffany, Colonel Blair with his Family and an Indian Ayah. Johann Zoffany est célèbre pour ses conversation pieces, tableaux de famille dans un intérieur. (…) La deuxième œuvre est celle de Nicolas-Bernard Lépicié, autre contemporain, vivant dans le Jura, lui aussi auteur de conversation pieces, comme le Portrait de la Famille Leroy. Enfin, la troisième est de Gustave Courbet qui vivait dans la même région _ le Jura, avec ses cluses et ses résurgences étranges de rivières _ que Léopold. Il s’agit du Ruisseau Noir dans la Vallée de la Loue.
…
Ces tableaux m’ont aidé _ à une première figuration, pour soi _, ainsi _ aussi _ que de nombreuses estampes indiennes collectionnées par Abraham Porcher des Oulches que Léopold avait probablement croisé à Karikal.
…
La rêverie finale _ en 1835 _ sur le tableau qu’auraient fait ensemble _ en 1773, à Salins-les Bains : soit déjà là deux fictions… _ Nicolas-Bernard Lépicié et Johann Zoffany, et sur la mort _ très peu après, en 1835 _ de Marie-Jeanne, et plus tard _ à Dampierre, près de Saumur _ d’Anjali, l’ahah ramenée des Indes _ un personnage d’ayah inventé, par comparaison avec la conversation piece de Johann Zoffaly comportant « an Indian Ayah« … _ est la seule partie _ purement _ imaginaire de ce livre qui ne se veut pas romanesque, car son sujet _ nous y voilà ! _, loin d’être l’incarnation d’un passé qui a laissé peu de traces, est au contraire l’effacement de figures _ voilà ! un effacement à combattre et donner à regarder… _ vouées _ cela réclamant peut-être un surplus d’explication _ à l’échec et à l’oubli.
…
Notre mémoire familiale _ sujette à plusieurs tragiques ruptures successives (Alphonse, Valbert, Bernard), très volontaires et assumées, de transmission de cette mémoire familiale des Pavans de Ceccatty, et donc appuyée sur de fortes volontés d’oubli de ce passé familial ; de refus de s’y rapporter et de le cultiver… ; et en cela René de Ceccatty a bien conscience de, par ce travail présent, briser même un tabou… _, elle-même se chargea _ en effet : d’abord par Valbert, puis par son fils Bernard _ de se désintéresser de celui _ Léopold, donc : le soldat vaincu et déchu… _ auquel pourtant tant de personnes à travers les siècles durent _ génétiquement au moins _ leur existence« _ ainsi que la perpétuation et persistance encore aujourd’hui simplement de leur nom : Pavans de Ceccatty.
…
…
Pour l’auteur, dès la page 19, l’effort de retenir et fixer un peu ces formes puissantes mais terriblement évanescentes et fuyantes, est semblable à l’effort fait « à chaque aube ou au cœur de la nuit, quand réveillé par un rêve, je tente de fixer ces visions nocturnes, tout en sachant que, pour les mémoriser, je les simplifie et les déforme _ cf ici les analyses freudiennes des processus du travail du rêve, et des efforts, ensuite, pour tenter d’interpréter ce que l’on a pu en retenir… _, en espérant en tirer un récit compatible avec l’idée même de narration (personnages, lieux, actions, dialogues), mais je sais bien que c’est alors une illusion qui se substitue à une autre illusion.
…
(…) Mais je feins de reconstituer la forme de ce fantôme, comme si j’étais capable d’y voir encore une figure reproductible, et je tente de la décrire, alors que si je ressens une émotion, c’est précisément celle de voir disparaître la forme _ voilà ! _, et d’accepter que le passé soit mort ;
tout comme, lorsque je rêve de maman, de mes grands-mères, l’une ou l’autre avec une certaine équité, je sais, je sais avec une si douloureuse assurance qu’elles sont mortes et ne me visitent dans mon sommeil que pour me le redire et m’inciter à souffrir de leur mort, mais non de leur effacement.
Elles ne sont _ certainement _ pas effacées.
…
De même cette résurrection de la colline de Kagurazaka vient me redire que ces sons, ces sensations ne se sont pas effacés, mais que ces jours-là sont morts _ c’est-à-dire passés, remplacés par bien d’autres depuis ; et c’est bien là une des fonctions principales de l’oubli…. D’une mort toutefois différente de celle que l’on croit, dans les moments les plus sombres de la réflexion sur ce que l’on a écrit, avoir provoqué en figeant, ligne après ligne sur la page, le trésor furtif _ voilà ! _ de la mémoire ou du rêve. Cette mort-là, que l’on peut qualifier de traîtresse (car il n’est pas de littérature qui ne soit, ne fût-ce que par l’acte de publication, suspecte de trahison ou du moins d’imperfection, et donc d’infidélité et d’échec), n’est donc pas irrémédiable. C’est une demi-mort.
…
Et voilà que reviennent à un semblant de vie _ voilà ! _, dans un éclair (impossible à mesurer, inquantifiable donc et peut-être immatériel, intemporel, cela même qui, tout en exprimant le temps, y échappe), ces signes de l’entrée dans la nuit« , page 21.
…
…
Et en conséquence de ces divers processus-là, ceci, page 23 :
…
« Au va-et-vient capricieux et inéluctable de ma mémoire _ involontaire et malicieusement anarchique _, je dois me soumettre, me résigner : j’en ai la preuve chaque nuit, au cœur de la nuit ou au petit matin, parfois quelques minutes seulement après m’être endormi, comme si la bête dans la jungle du rêve m’attendait tapie pour envahir mon cerveau et le paralyser à sa manière aussi efficacement qu’une rupture d’anévrisme« …
…
…
Au chapitre « Le Soldat déchu« , aux pages 63 à 66,
René de Ceccatty précise les quelques moyens qu’il a utilisés pour se figurer _ et nous donner à nous représenter, nous lecteurs, à notre tour _ le « destin militaire« , aux Indes, de 1757 à 1771, de son ancêtre Léopold :
…
« Barry Lyndon de Thackeray, La Conquête du Paradis de Judith Gautier et Voyage à l’île de France de Bernardin de Saint-Pierre, voilà ce qui, ajoutés aux Fragments sur l’Inde de Voltaire, aux pièces du procès de Lally-Tollendal et aux témoignages de Bussy, d’Anne -Antoine d’Aché, du chevalier de Soupire avec qui Léopold s’était embarqué, le 30 décembre 1756 pour l’Inde, voilà ce qui me donne une idée _ un peu mieux figurée _ du triste destin d’un militaire qui de dix-sept à quarante-sept ans a combattu dans des guerres de succession qui ne le concernaient pas _ mais qu’en est-il donc des militaires de carrière ? _, et pour l’honneur d’une France à laquelle sa Franche-Comté natale n’avait été rattachée que par l’arbitraire des traités de paix _ en l’occurrence celui de Nimègue, en 1678 _ avec l’Espagne et l’Autriche et la Pologne et l’Angleterre et la Russie.
…
Pauvre fils des comtes de Venise, ballotté sur l’Océan indien, se mariant à une créole des Indes orientales où il avait été envoyé avec son régiment de Lorraine, dans son joli uniforme à collerette rouge sur une étoffe blanche garnie de bleu.
…
Mais des dix années indiennes _ de 1761 à 1771 _ qui ont suivi la chute de Pondichéry _ le 16 janvier 1761 _, et des treize franc-comtoises à Salins-les Bains _ de 1771 au 3 février 1784 _, de ces vingt-trois années-là de loin les plus romanesques (dont Marie-Jeanne Lenoir aurait pu être la mélancolique narratrice déchirée par l’éloignement de l’Inde _ lumineuse _ dans le _ sombre, noir _ paysage franc-comtois qui inspirerait Gustave Courbet) aucune archive ne conserve les traces.
…
Balzac, Stendhal, Leopardi, à l’aide !
Est-ce-à-dire que Marie-Jeanne la créole et Léopold le soldat déchu, l’anonyme des pamphlets, deviendraient, ces deux ombres hantant à Salins-les-Bains l’hôtel particulier qui leur revint, plus proches _ et telle est en effet la formidable puissance de vérité des vertus de présence de l’imageance magique des Arts ! quand ils sont authentiques… _ de moi que _ malgré ce cahier d’écolier tunisien sur lequel j’écris _ mon enfance dont je visite hâtivement _ à Mégrine, au mois d’avril 2019 _ la dévastation : terrain vague et boueux près du « café Hollywood », cimetière profané ?« , page 66…
…
Anticipant peut-être alors cette phrase de la page 122 :
…
« Jeanne écoutant à la porte de Nicolas et Johann est plus vivante _ mais oui ! _ que moi-même à mes propres yeux _ voilà ! et c’est là une manifestation de la phénoménologie vécue et assumée, incorporée en quelque sorte en le regard sur lui-même et le réel, de René de Ceccatty… _, cherchant le sommeil dans la villa bleue » _ de Mégrine avant juin 1958…
…
Et cette autre, aussi, des pages 122-123 :
…
« La vision, elle réelle _ encore que l’éloignement de cette expérience dans le temps (car un an _ entre avril 2019, du voyage à Tunis et Mégrine, et avril 2020, de l’écriture de cette page _ est beaucoup pour un événement aussi ténu) la rende irréelle, imperceptible à tout le moins _ de la dévastation du jardin de la villa bleue (…) avait, non seulement du fait de sa dévastation, mais aussi de l’affreux étirement du temps, moins de réalité _ et voilà l’élément fondamentalement décisif de cette phénoménologie incorporée de René de Ceccatty _ que cette Anjâli _ fictionnelle _ plus mûre que son âge ne devrait le permettre, petite Indienne enlevée à sa terre et aux siens, que Léopold, pauvre militaire raté, réduit à ce rôle de rentier pensionné, géniteur amer, que sa femme Marie-Jeanne, multipliant là-bas et ici ses grossesses, que Jeanne et Marie-Anne sacrifiant leurs souvenirs _ de la lumière d’Inde _ à leur vie future de femmes mariées aux frères Girod, de noblesse récente, mais nantie« …
…
…
« Plus proches« , page 66 ; « plus vivante« , page 122 ; « moins de réalité« , page 124 :
…
soient des expressions qui nous parlent de la magique puissance de l’Art, quand il est à son meilleur _ et son authenticité la plus grande…
…
…
Et page 69 :
…
« L’oubli : ce qui nous menace tous. D’en être l’objet, bien sûr, mais aussi l’origine.
Je lutte, sans doute parfois artificiellement, contre lui. Lorsque je fouille dans les archives de mon pauvre aïeul Léopold, cherchant avec tant de mal des traces de sa carrière militaire dans les Mémoires sur Tally-Tollendal, Soupire, Bussy, dans les histoires de la guerre de Sept Ans, dans celles de la conquête des Indes et de la chute de Pondichéry ; quand je cherche son miroir chez Thackeray, Judith Gautier, Bernardin de Saint-Pierre, Voltaire, et peu à peu _ aussi _ (mais je résiste, je résiste) dans mes propres souvenirs _ aussi _, quêtant des équivalents _ voilà ! et forcément : peut-on en faire totalement l’impasse ?.. _ de son séjour indien dans mes propres expériences orientales, dans mes lectures, de ses voyages en mer dans mes propres voyages, de sa soumission aux ordres militaires dans ma propre conception d’une discipline professionnelle et dans mon refus obstiné de l’exercice du pouvoir« …
…
Avec cette réponse-ci, dès l’ouverture du chapitre suivant, à la page 70 :
…
« Oui, je lutte contre son oubli, mais je refuse de faire de lui, de ce que je glane de sa vie, une marionnette romanesque.
…
Et pourtant j’aimerais faire revivre _ voilà : par la magie de l’écriture vraie… _ Marie-Jeanne, la créole des Indes arrivant au Jura, avec ses deux filles, Jeanne et Marie-Anne, et leurs habitudes indiennes, se retrouvant dans le climat hostile de la Franche-Comté et entre les étroits murs de l’hôtel de Salins-les-Bains, vieil hospice médiéval, acquis par Léopold et sans doute rénové à la hâte. (…) Comment étaient-ils tous passés du golfe du Bengale à l’ennui des vallonnements du Jura ? (…) Pauvre Léopold, ombre du héros anonyme qu’il avait été à Madras, à Pondichéry, à Karikal…«
…
…
Et c’est en effet cette idée de faire appel à des comparaisons avec des tableaux _ de Zoffany, Lépicié, et indirectement Courbet _ décrits, qui va faire démarrer la partie imaginée du roman :
…
« Le roman peut commencer« , lit-on, page 82, en conclusion du chapitre « L’Ayah« …
…
…
Et : « Rien n’est plus enivrant pour un romancier que l’invention d’un peintre. Balzac, Henry James le savaient. Zola, Stendhal eux-mêmes et, au Japon, Sôseki« , lit-on, page 85.
« La musique est l’absolu de l’expression du sentiment et la transfiguration de la conscience du temps. La peinture est l’idéal de la description : lumière, regard, organisation de l’espace intérieur et de l’espace extérieur« .
…
…
Page 125, René de Ceccatty, au décisif chapitre intitulé « La seule réalité possible« , poursuit et développe son idée de l’étrange puissance magique de l’Art, quand il est à son meilleur,
dont j’ai relevé plus haut des exemples, aux pages 66 : « Plus proches« , 122 : « plus vivante« , et 124 : « moins de réalité » :
…
« Pour moi, le passage fortuit _ purement fictionnel, à Salins-les-Bains en 1773, auprès de la famille de Léopold Pavans de Ceccatty _ des deux peintres _ Johann Zoffany et Nicolas-Bernard Lépicié _ est la seule réalité possible _ à l’exclusion, donc, de tout transmission génétique ! _ qui m’unisse _ voilà _ à elles, à eux. Et quand elle se marient _ Jeanne et Marie-Anne, en 1782 et 1794 _ aux deux frères de Miserey _ Charles-Armand Girod de Miserey _ et de Rennes _ Charles-Gabriel-Léonard Girod de Miserey _, je les abandonne, elles ne me sont plus rien.
…
Quand Jeanne oublie Nicolas, oublie la toile roulée au grenier, oublie qu’elle a écouté à la porte des deux amis murmurant avant de s’endormir, elle ne m’est plus rien. (…)
…
Et cela m’amuse, parce que pense à Marguerite Duras, je pense à Sigalon à Rome dans les années 1835 _ sur Sigalon à Rome, et Stendhal, et Michel-Ange, cf l’admirable « Objet d’amour« de René de Ceccaty, en 2015 ; et mon plus qu’enthousiaste article du 24 mai 2016 : « René de Ceccatty, ou d’éperdues enquêtes autour de « dignes objets d’amour » : Michel-Ange (via Stendhal et Sigalon), Leopardi, Pasolini, lui-même…« … _, parce que je suis familier du monde de la peinture. (…)
…
Et c’est ce qui fait que la réalité est là, dans un tableau même imaginaire, plus que _ voilà ! voilà ce que sont les divers degrés de réalité qui nous parlent et qui nous concernent vraiment ! _ dans des archives, plus que dans le sang (à supposer que le même sang coule dans mes veines que dans celles de Marie-Jeanne Lenoir.
Et qu’elle est surtout là, dans ce cahier tunisien acheté à Mégrine, près de la gare de Sidi Rezig _ ou est alors en train de s’écrire, voilà !, en avril 2020, ce beau « Soldat indien« …
…
Et je me rappelle le ton que prenait naturellement maman, pour prononcer ce nom de Sidi Rezig, un ton à la fois ironique et parodique où pointait une forme de désespoir et de désabusement _ oui _, comme lorsqu’elle évoquait sa première affectation à Foum Tataouine, comme institutrice avant le retour de papa de New-York« , page 126.
…
…
Au chapitre « Les Ruines« , aux pages 127-130, René de Ceccatty revient sur l’expérience de son nouveau retour sur les lieux _ dévastés _ de la Mégrine de son enfance , ce 12 avril 2019, et fait à nouveau le lien entre cette expérience-là et le travail qu’il va réaliser _ et aura réalisé, par la recherche et l’écriture, en 2020-2021 _ sur le destin indien et post-indien de son ancêtre Léopold…
…
…
Pages 129-130 :
…
« Le cahier d’écolier _ acheté près de la gare de Sidi Rezig ce 12 avril-là _ était le seul objet qui me procurait une sensation d’appartenance non à un pays, ni à une fonction, ni à une identité, mais à un rôle _ voilà : à tenir, endosser ; le rôle « tenant« et faisant sien celui qui se trouve l’endosser. Appartenir à un rôle : voilà de quoi donner profondément à méditer.
…
Or ce n’était pas ce cahier qui rendrait _ vraiment, en quelque sorte _ ma présence dans les ruines (que mon frère _ Jean Pavans _ trouverait, quand je lui en montrerais les photographies, si pauvres et désolées qu’il ne comprenait pas que je n’aie pas voulu en détruire le souvenir, comme une part sinon honteuse ou indigne, du moins affligeante, de notre passé, de notre origine qui traduisait toute l’implacable déchéance des générations depuis deux siècles, déchéance accrue par la déshérence _ de ces lieux _ successive à la colonisation et à la décolonisation : cet abandon, cette misère, cette absence impersonnelle, cela ne ressemblait à rien _ sauf que c’était peut-être précisément ce rien qu’il importait de révéler, de ne pas esquiver, effacer, oublier, fuir… _) :
tout au plus ce cahier m’offrirait-il l’illusion _ voilà… _ de consolider _ par le constat de fait dont il allait témoigner noir sur blanc _ cette furtive expérience d’un séjour si pauvre, si décevant qu’il fallait que le remplisse d’un autre passé que le mien, celui d’une famille imaginaire _ fantasmée, donc, pour l’essentiel… _ même si les archives d’état-civil peuvent témoigner du lien sinon sanguin, car une fois encore qui sait ?, du moins légal, qui m’unit à Léopold et à ses femmes créoles, comme aux quelques noms qui, avant et après lui, sont à des variantes près de prénoms et d’orthographe le mien et celui de mon frère et de mes cousins. Et à vouloir chercher des points communs, on perd toute personnalité » _ mais ces « points communs« -là, même trouvés et avérés, dissolvent-ils nécessairement pour autant toute singularité un peu personnelle ? Étouffent-ils la moindre liberté de sujet de la personne ?.. Voilà aussi une question que l’on peut se poser.
…
…
Qu’est-ce donc qu’un atavisme ? Et quelle est sa portée, en plus de sa teneur ?
…
N’y a-t-il donc rien du tout à en tirer ?..
…
Qu’en dirait le moine Dôgen ?
…
…
Ce jeudi 3 février 2022, Titus Curiosus – Francis Lippa