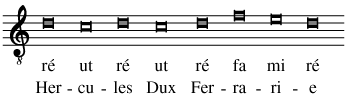Je reviens ce dimanche matin 11 octobre
sur la situation de Maurice Ravel, en 1901 et 1902, au sein de la famille Gaudin (domiciliée au 41 rue Gambetta, à Saint-Jean-de-Luz),
eu égard, à deux très importants événements familiaux, à Saint-Jean-de-Luz :
…
d’une part, eu égard au mariage, à Saint-Jean-de-Luz, le 28 septembre 1901, de sa cousine Magdeleine Hiriart (Saint-Jean-de-Luz, 11 mars 1875 – Saint-Jean-de-Luz, 19 juin 1968) avec Charles Gaudin (Saint-Jean-de-Luz, 19 novembre 1875 – Bimbo, 13 septembre 1910) _ l’aîné des enfants d’Edmond Gaudin (Saint-Jean-de-Luz, 17 novembre 1844 – Saint-Jean-de-Luz, 28 décembre 1920) et Annette Bibal (Saint-Jean-de-Luz, 28 avril 1845 – Saint-Jean-de-Luz, 21 novembre 1936) _ ;
…
et, d’autre part, eu égard au décès, à Saint-Jean-de-Luz, au 41 rue Gambetta, le 17 décembre 1902, de sa chère grand-tante et marraine _ et demi-sœur de sa grand-mère Sabine Delouart (Ciboure, 11 mars 1809 – Ciboure, 22 décembre 1874) _, Gachucha Billac (Ciboure, 15 mai 1824 – Saint-Jean-de-Luz, 17 décembre 1902) :
la gouvernante, au foyer des Gaudin-Bibal, rue Gambetta, des enfants Gaudin : Charles (né le 19 novembre 1875), Pierre (né le 7 février 1878), Marie (née le 3 mars 1879), Jane (née le 16 octobre 1880), Pascal (né le 31 janvier 1883) et Louis (né le 23 février 1886, et décédé le 2 novembre 1899).
…
…
Bien sûr, notre recherche pâtit énormément ici de l’effective minceur de la correspondance privée à ce jour disponible de Maurice Ravel : entre le 2 août 1901 et le 16 mai 1903, sont en effet seulement accessibles trois lettres de Maurice Ravel à son amie luzienne Jane Gaudin : les lettres des 2 août 1901, 16 octobre 1902 _ une lettre importante ! _ et 30 novembre 1902, numérotées 26 (page 78), 35 (page 82) et 37 (page 83) de la correspondance disponible, à ce jour du moins, de Maurice Ravel, telle qu’a pu la rassembler Manuel Cornejo en son admirable (et indispensable) Correspondance de Maurice Ravel, aux Éditions Le Passeur.
…
…
Dans quels tiroirs (ou coffres) demeure donc cachée cette si précieuse correspondance privée de Maurice Ravel à ses amis luziens Gaudin (et Courteault) ?
…
…
Dans quelle mesure faut-il suivre le témoignage (de toute bonne foi) rapportant qu’un lot important de ces inestimables lettres aurait été, de rage (sic), brûlé _ et il n’y a pas très longtemps _, par un des héritiers ?
C’est assez difficile à croire !
…
…
Alors qu’un autre de ces lots de lettres de Maurice Ravel a bel et bien été, lui,
suite à un prêt (pour une exposition),
non rendu à la famille…
…
…
Bien sûr, Manuel Cornejo porte la plus grande attention au devenir de la moindre correspondance de Maurice Ravel…
…
…
Et il faudra bien tenter de faire un jour l’historique du devenir de cette correspondance si importante _ quant à la connaissance des liens à la fois familiaux et amicaux du compositeur à Ciboure et Saint-Jean-de-Luz… _ de Maurice Ravel avec ses amis Gaudin et Courteault…
…
…
Bref,
les dates
du 28 septembre 1901, pour le mariage de la cousine Magdeleine Hiriart avec Charles Gaudin, le fils aîné des Gaudin-Bibal-Dupous,
et du 17 décembre 1902, pour le décès de la grand-tante Gachucha Billac,
marquant des événements si importants pour Maurice Ravel
ainsi que pour sa mère née Marie Delouart
n’ont jusqu’ici pas laissées de traces accessibles à nous dans ce qu’a pu écrire Maurice Ravel…
…
…
Maurice Ravel ainsi que sa mère sont-ils demeurés, ces deux fois-là _ en septembre 1901 et décembre 1902 _, à Paris,
sans se rendre, en ces deux circonstances, importantes familialement, à Saint-Jean-de-Luz ?..
…
…
Il est vraiment dommage que nous disposions jusqu’ici de si peu de données documentaires si peu que ce soit tangibles, en dehors de quelques témoignages oraux assez tardifs,
de l’enfance-adolescence-jeunesse de Maurice Ravel avant 1900.
…
…
Cependant, la venue, très jeune, et probablement à plusieurs reprises, de Maurice Ravel auprès de sa grand-tante Gachucha Billac, chez les Gaudin, rue Gambetta, à Saint-Jean-de-Luz,
a donné lieu à diverses anecdotes tout à fait intéressantes ;
…
dont celle de Gachucha s’amusant à comparer le jeu de Maurice _ à quel âge ? _ au piano, au sauts nerveux d’un chat sur les touches de l’instrument…
…
…
J’ai retenu aussi le fait _ assez significatif ! _ que m’a rapporté Madame Maylen Lenoir
que chez les Gaudin, lors des repas de Maurice enfant au 41 de la rue Gambetta,
c’était plutôt la vaisselle ébréchée qui était servie au petit-neveu de la domestique-gouvernante Gachucha Billac…
…
…
Mais la situation sociale de Maurice Ravel a sans conteste bien changé dans la maison Gaudin, à partir du mariage de sa cousine Magdeleine Hiriart, le 28 septembre 1901,
avec le fils aîné de la maison, Charles Gaudin…
…
Maurice Ravel devenant dès lors un cousin par alliance de l’aîné de la fratrie _ nés entre 1875 et 1886 _ des Gaudin !
…
…
Ce qui ne fait que réactiver l’étonnement que ne manquent pas de susciter
le silence de la volubile et affable Magdeleine Hiriart-Gaudin en son vieil âge sur ce cousinage familial sien avec Maurice Ravel ;
…
et plus encore le refus _ à diverses reprises réitéré _ d’endosser un tel cousinage effectif
de la part d’Edmond Gaudin (Saint-Jean-de-Luz, 30 mai 1903 – Saint-Jean-de-Luz, 28 décembre 1988),
le fils de Magdeleine (1875 – 1968)
et père de Maylen (née en 1942).
…
…
Cf aussi l’importante note 3 au bas de la page 1291, de la part de Manuel Cornejo en son édition de la Correspondance de Maurice Ravel,
dans laquelle est établie la place d’Edmond Gaudin parmi les tous premiers témoins luziens des troubles neurologiques de Maurice Ravel, lors d’un séjour de celui-ci à Saint-Jean-de-Luz (et tout le pays basque), en août-septembre 1932 :
…
« En août-septembre 1932, les premières atteintes du mal du compositeur se manifestèrent aux yeux de ses proches, avant son accident de taxi parisien du 8 octobre 1932 :
lors d’une corrida à Saint-Sébastien où Edmond Gaudin emmena Ravel, ce dernier, cherchant machinalement quelque chose dans ses poches, fut incapable d’exprimer oralement qu’il souhaitait fumer ; ce n’est que quand Edmond Gaudin sortit des cigarettes et que Ravel s’empara de l’une d’elles, que l’on comprit ce qu’il souhaitait ;
une autre fois, s’amusant à faire des ricochets dans l’eau avec des cailloux, Ravel en envoya un malencontreusement au visage de son amie Marie Gaudin ;
beaucoup plus inquiétant, car il aurait pu y laisser la vie, un autre jour, Ravel, excellent nageur et n’hésitant pas à nager loin dans l’Océan, fut incapable de revenir sur le rivage et avoua à ses sauveteurs « Je ne sais plus nager ». Cette dernière anecdote a été narrée notamment par Léon Leyritz dans le film Maurice Ravel. L’homme et les sortilèges« …
…
…
Demeure donc un mystère dans cette dénégation soutenue par Edmond Gaudin de son cousinage effectif avec Maurice Ravel.
…
…
Voici donc cet article du 28 mai 2019
Les blancs questionnants de la mémoire familiale des cousins luziens de Maurice Ravel : pour continuer à progresser dans la recherche…
auquel je désire apporter ce jour quelques corrections (d’ignorances d’alors) et précisions (nouvelles).
…
…
…
…
Continue, bien sûr, de me travailler _ et en attendant que je joigne la petite-fille de Magdeleine Hiriart-Gaudin (rencontrée désormais à diverses reprises, à son domicile, à Saint-Jean-de-Luz) _
la question de l’ignorance _ a priori assez étonnante ! _ de la part des présents enfants Gaudin
de leur parenté on ne peut plus effective _ via les Hiriart et les Etcheverry (et d’abord via Magdelaine Hiriart-Gaudin : chaînon crucial de la descendance luzienne des Delouart cibouriens !) _ avec Maurice Ravel.
…
Peut-être est-ce en partie dû, aussi, au fait de la force de rayonnement, au sein de leur famille, de l’amitié de Maurice Ravel avec Marie (1879 – 1976) et Jane Gaudin (1880 – 1979) ;
et leur correspondance connue.
…
Qui aurait pensé aller chercher quelque cousinage que ce soit
du côté des Hiriart ?..
_ sauf à lire avec la plus vigilante attention l’intégralité, et dans les plus petits détails, de la correspondance publiée !
…
Et, qui plus est avec le petit-neveu de la domestique-gouvernante des enfants Gaudin, Gachucha Billac ?..
…
…
Ce cousinage Hiriart-Ravel échappait-il déjà aux belle-sœurs Gaudin, Marie et Jane, de Magdeleine ?
C’est bien peu vraisemblable. Magdeleine Hiriart-Gaudin, épouse de leur frère aîné Charles, était bel et bien leur belle-sœur.
…
…
Mais quelle position occupait la belle-sœur Magdeleine
_ veuve, en septembre 1910, de Charles Gaudin, l’aîné (1875 – 1910) de la fratrie des sept enfants d’Edmond Gaudin (1844 – 1920) et son épouse Annette Bibal-Gaudin (1845 – 1936)… _
au sein de la configuration familiale des Gaudin ? Cela reste à creuser…
…
…
Et je suis donc curieux d’en apprendre un peu plus sur les liens ayant pu exister,
tout au long de leurs vies durant _ bien au-delà des dates, de septembre 1910 et novembre 1914, des lettres de condoléances alors échangées, au moment des décès de Charles Gaudin, puis de ses frères Pierre et Pascal Gaudin _
entre Maurice Ravel
et Magdeleine Hiriart-Gaudin (nés à quatre jours, au mois de mars 1875, et quelques centaines de mètres d’intervalle ! un peu plus que la largeur du port de Saint-Jean-de-Luz – Ciboure…)
_ Maurice (Ciboure, 7 mars 1875 – Paris, 28 décembre 1937) et Magdeleine (Saint-Jean-de-Luz, 11 mars 1875 – 15 juin 1968) _ ;
ainsi qu’avec Edmond, le fils de Magdeleine et Charles Gaudin (qui leur était né, à Saint-Jean-de-Luz, le 30 mai 1903 _ et décèdera le 28 décembre 1988 _)…
…
Nulle correspondance entre Maurice Ravel et Edmond Gaudin n’étant accessible jusqu’ici, semble-t-il _ en effet…
…
En remontant plus haut dans la galaxie familiale,
il faut dire que le père de Magdeleine Hiriart, Dominique Hiriart (né à Saint-Jean-de-Luz le 28 janvier 1849),
était très jeune (un an et onze mois !) lors du décès de sa mère, née Marie Etcheverry (et fille de la seconde Marie Delouart), le 28 décembre 1850, à Saint-Jean-de-Luz.
De même, aussi, qu’au moment du décès, à Saint-Jean-de-Luz, de son père, Jean-Baptiste Hiriart, le 24 septembre 1859 : 10 ans et 8 mois.
…
Le principal lien de Dominique Hiriart avec la mémoire familiale (maternelle) des Etcheverry
était cependant représenté par la tante maternelle de Dominique,
en la personne de la sœur cadette de sa mère, je veux dire la seconde Marie Etcheverry (épouse Dargaignaratz), qui décèdera, à Saint-Jean-de-Luz, le 20 novembre 1900 :
Dominique Hiriart avait alors presque 51 ans. Et sa fille Magdeleine (née à Saint-Jean-de-Luz le 11 mars 1875), avait 25 ans.
Puis, la fille de cette seconde Marie Etcheverry et de Bernard Dargaignaratz : Marie-Clotilde Dargaignaratz, épouse _ le 22 novembre 1905 _ de l’urrugnar Martin Zozaya ; elle décèdera à Urrugne le 26 février 1943…
…
…
Qu’a donc connu Magdeleine Hiriart-Gaudin de l’histoire familiale cibourienne des Etcheverry-Delouart ?
Et qu’en a-t-elle narré ?
…
…
Au moins est-il à retenir que Magdeleine et Maurice connaissaient parfaitement, eux, leur propre cousinage ! Ce n’est pas rien _ il faut le souligner !
…
…
Même si en sa vieillesse Magdeleine (qui décède le 15 juin 1968) demeura, semble-t-il _ ce que me confie Madame Maylen Gaudin – Lenoir _ muette sur le sujet de ce cousinage
_ elle qui était d’un tempérament plutôt volubile, se souvient sa petite-fille _,
avec ses petits enfants, Charles-Paul et Maylen…
Cela aussi est à creuser…
…
…
La cousine Clotilde (née à Saint-Jean-de-Luz le 6 mars 1860) avait, elle, 40 ans au décès de sa mère, Marie Etcheverry-Dargaignaratz, le 20 novembre 1900, à Saint-Jean-de-Luz.
…
Je relève toutefois qu’au mariage de Dominique Hiriart et Marianne Imatz, le 3 juin 1874, à Saint-Jean-de-Luz,
en l’absence des deux parents Marie Etcheverry et Jean-Baptiste Hiriart, déjà décédés, du marié,
celui-ci est assisté de sa tante maternelle, Marie Etcheverry, veuve Dargaignaratz (Saint-Jean-de-Luz, 20 novembre 1824 – Saint-Jean-de-Luz, 30 novembre 1900)…
C’est tout à fait intéressant.
Celle-ci demeura donc proche _ voilà ! _ de la famille de son neveu Dominique Hiriart.
…
…
Et en relisant mes articles précédents, ainsi que la documentation afférente,
je découvre ceci,
concernant le mariage à Ciboure, le 20 août 1890, de Pierre Paul Bernard Goyenague avec sa cousine Nicolasse Goyenague :
…
que figure parmi les quatre témoins de ce mariage, à Ciboure,
Dominique Hiriart :
…
« Dominique Hiriart, commerçant _ il n’est plus dit « menuisier« , et pas encore, non plus, « administrateur de la succursale de Saint-Jean-de-Luz de la Caisse d’Epargne de Bayonne« … _, âgé de 41 ans _ il est né en effet le 28 janvier 1849 à Saint-Jean-de-Luz _, domicilié à Saint-Jean-de-Luz« .
…
…
Les liens de cousinages
entre les descendants cibouriens et aussi luziens de Gratien Delouart et de ses quatre enfants (les trois Marie Delouart _ épouses Billac, Etcheverry et Goyenague _ et leur frère Jean Delouart),
demeuraient donc très vivants !
…
Comment Marie Delouart-Ravel aurait-elle pu complètement s’en exclure ?.. Question rétrospectivement importante.
…
…
De même, encore, que la fille de Marie Etcheverry-Dargaignaratz, Clotilde Dargaignaratz-Zozaya,
demeura proche de la famille de son cousin Dominique Hiriart :
…
proche de son épouse Marianne Imatz-Hiriart,
proche de sa fille Magdeleine Hiriart-Gaudin,
et proche de son petit-fils Edmond Gaudin,
…
auquel elle offrit un de ses pianos _ peut-être à l’occasion du mariage de celui-ci, en 1935 ;
non, elle le laissa en héritage à son épouse et lui, lors de son décès, en 1943,
à bien entendre le témoignage de la petite-fille d’Edmond Gaudin, Madame Maylen Lenoir…
…
…
Qu’a-t-il donc pu se transmettre,
via cette seconde Marie Etcheverry (épouse Dargaignaratz ; et luzienne),
puis via sa fille Clotilde (épouse Zozaya),
de la mémoire cibourienne de la famille Delouart ?
…
C’était là une excellente question !
…
…
Pour quelles raisons, déjà,
la seconde Marie Delouart et son mari Jean Etcheverry (fils naturel de Jeanne Curutchet), tous deux cibouriens,
se marièrent-ils à Saint-Jean-de-Luz (le 17 août 1814) et s’y installèrent-ils,
à la différence du reste de la maisonnée cibourienne des Delouart ?..
Étaient-ils donc fâchés avec le reste de la famille Delouart ?..
Nous l’ignorons, à ce jour.
…
…
Et quels liens entretinrent, ou pas, les deux Marie Etcheverry luziennes (nées, à Saint-Jean-de-Luz, en 1817 et 1824)
avec leurs cousins germains cibouriens, issus, eux aussi, des Delouart :
…
Sabine Delouart (née à Ciboure en 1809, le 11 mars 1809),
Gachucha Billac (née à Ciboure en 1819 _ j’ignore la date et le lieu de son décès : probablement avant 1916 : Maurice Ravel parlant d’elle alors au passé, en une lettre (du 20 septembre 1916, à propos du goût immodéré de la chère tante Gachuch pour les melons…) à Marie Gaudin : voilà, là des erreurs et ignorances à rectifier : Gachucha Billac est née à Ciboure le 15 mai 1824 ; et décédée à Saint-Jean-de-Luz le 17 décembre 1902 _),
Simon Goyenague (né à Ciboure en 1821, le 22 novembre 1821 ; il décèdera à Ciboure le 18 novembre 1890),
Jacques Goyenague (né à Ciboure en 1822, le 16 octobre 1822 ; il décèdera à Ciboure le 22 novembre 1886)
et Marie Goyenague (née à Ciboure en 1827, le 28 juillet 1827, et épouse en 1850, le 17 juillet 1850, à Ciboure, de Martin Passicot _ né en 1824, le 24 octobre 1824, à Ciboure : non, à Urrugne… ; peu après la naissance de leur premier enfant, Jean-Martin Passicot, à Ciboure, le 17 mai 1851, Martin Passicot, son épouse Marie Goyenague, et leur bébé Jean-Martin Passicot, prirent l’été 1851, un bateau à Pasajes pour aller s’installer en Argentine, où le couple allait avoir dix autres enfants… _),
Sabine Delouart (née à Ciboure en 1825, le 24 juin 1825, et épouse, en 1852, le 12 août 1852, à Ciboure, de Bernard Cerciat _ né à Ciboure, le 18 octobre 1824 ; et disparu en mer le 9 mars 1868 _),
Marie Delouart (née à Ciboure en 1827, le 30 juin 1827, et épouse, en 1853, le 13 novembre 1861, à Ciboure, de Guilhen Etchepare _ né en 1826, le 8 juillet 1826, à Ciboure ; il décèdera à Ciboure le 22 mai 1872 _)
et Jean Delouart (né à Ciboure en 1833 _ sans plus de précision _ ; il décèdera à Ciboure le 26 novembre 1888) ?..
…
…
A la génération suivante, les cousins cibouriens seront, entre autres,
Marie Delouart (née à Ciboure en 1840, le 24 mars 1840 ; elle décèdera à Paris le 5 janvier 1917 ; et épouse, à Paris, le 3 avril 1873, de Joseph-Pierre Ravel _ né à 1832, le 19 septembre 1832, à Versoix, en Suisse ; il décèdera à Paris le 13 octobre 1908 _),
Paul Goyenague (né à Ciboure en 1859, le 19 août 1854 ; il décèdera à Ciboure le 6 mars 1929) et son épouse (en 1890, le 20 août 1890, à Ciboure), et aussi cousine, Nicolasse Goyenague (née à Ciboure en 1864, le 11 juillet 1864 ; elle décèdera à Ciboure le 1er juin 1945),
11 enfants Passicot (nés de 1851, pour l’aîné, Jean-Martin, né à Ciboure, le 17 mai 1851, et 1855, pour le second, Juan Tomas, né à Buenos Aires, le 30 mars 1855, à 1873, pour le onzième et dernier, Francisco, né à Las Lomas de Zamora, en Argentine, le 15 juin 1873 ; et tous ayant vécu en Argentine),
Jean-Baptiste Cerciat (né à Ciboure en 1854, le 20 septembre 1854 ; il décèdera à Ciboure le 26 novembre 1914),
Jean Cerciat (né à Ciboure en 1859, le 10 avril 1859 ; il décèdera très probablement à Nouméa, après 1912, où lui étaient nés trois enfants, Elise Cerciat, le 30 juillet 1894, Raymond Cerciat, le 24 janvier 1897, et André Cerciat, le 3 avril 1899),
et peut-être quelques autres Cerciat,
ainsi que peut-être quelques Etchepare,
parmi ceux que j’ai à ce jour repérés…
…
…
Voilà quelques questions que je me pose
sur ces cousinages cibouro-luziens de Maurice Ravel.
…
A suivre…
…
…
Je joindrai prochainement _ et rencontrerai à son domicile luzien, et à plusieurs reprises _ la _ très aimable _ petite-fille de Magdeleine Hiriart-Gaudin, Madame Maylen Lenoir…
…
Qui m’a écrit, par retour de courriel, le mercredi 29 mai 2019 _ je ne l’avais pas encore rencontrée _, ceci,
d’assez extraordinaire pour le chercheur que je suis :
…
« Vous m’apprenez beaucoup de choses sur ma famille ; j’ignorais absolument ces liens familiaux avec Maurice Ravel ; et j’en suis d’ailleurs très étonnée !
En effet mon père, Edmond Gaudin, nous avait toujours dit qu’il _ Ravel _ appelait ma grand-mère _ Magdeleine Hiriart-Gaudin _ « cousine » parce qu’l l’aimait bien !! C’était une forme amicale…
Je serai ravie de vous rencontrer lors d’un de vos prochains voyages à Saint-Jean-de-Luz, je suis curieuse de savoir comment vous avez pu trouver toutes ces informations.
Encore merci, Recevez, cher Monsieur, mes meilleures salutations« …
…
…
Et nous nous sommes effectivement rencontrés une première fois le vendredi 12 juillet suivant, et assez longuement, afin de nous faire découvrir, l’un l’autre, de premiers passionnants documents ;
et deux autres fois encore…
…
…
Ce mardi 28 mai 2019, Titus Curiosus – Francis Lippa
…
…
Dont acte.
…
…
Ce dimanche 11 octobre 2020, Titus Curiosus – Francis Lippa
news and informations automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travelautomotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel