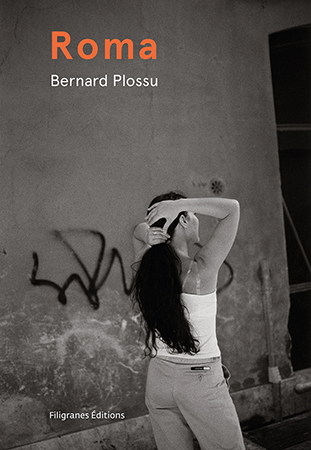Et maintenant,
passés les trois « volets » de mon « introduction« au « Lièvre de Patagonie » de Claude Lanzmann _ tels un seuil « obligé« vers quelque « saint des saints« … _,
voici la « clé« , à mes yeux, de cet immense « Lièvre de Patagonie » !.. :
…
le « débusquage » _ le mot « débusquer » revient plusieurs fois dans le livre ! _ par Claude Lanzmann,
…
en son effort de « rétrospection« , en ce livre-ci, du tissage complexe et riche
d’abord _ comme de règle pour tout un chacun « se cherchant« , touffu et « opaque« ; et, a fortiori, pour « un homme des mûrissements longs« , page 249… _
de sa vie et de son œuvre _ au tout premier chef duquel se situe l’aventure, quasi hors-temps, même si ce fut douze ans durant, du film « Shoah » :
…
cf l’expression, si parlante, de la page 545 : « Le temps un jour, et dans des circonstances dont je ne saurai rien _ de parfaitement clair… _ a pour moi _ devenant alors ainsi véritablement « auteur« … _ interrompu son cours. Cette suspension du temps a été d’une rigueur implacable pendant les douze années de la réalisation _ assez rarement pareil mot est d’emploi aussi juste qu’ici ! _ de « Shoah« _ cette « réalisation » étant aussi rien moins, proprement, qu’une « incarnation » !.. Ou, dit autrement, le temps n’a jamais _ alors _ cessé de ne pas passer _ du moins pour le « génie » au « travail de l’œuvre » (et « travail de la vérité« , cette expression-ci se trouvant page 504) qui investissait totalement l’artiste créateur… Claude Lanzmann précisant : « Comment pourrait-on, s’il s’écoulait _ ce temps, comme à l’habitude des opérations non créatrices, mécaniques _, travailler douze ans à produire une œuvre ? Cette formulation, « le temps n’a jamais cessé de ne pas passer », indique à la fois l’écoulement inexorable de ce qu’Emmanuel Kant appelait _ en sa « Critique de la raison pure« … _ « le sens interne » ; et son interruption _ dans l’activité productrice et créatrice, passionnante, du « génie » : cf du même Emmanuel Kant, cette fois la « Critique de la faculté de juger« .
…
Et bien qu’il _ le temps, donc : physique, biologique, social ! _ se soit _ depuis l’achèvement de « Shoah« , en 1985 _ remis très lentement _ comment l’artiste « auteur » « vrai » pourrait-il se résoudre à quitter jamais vraiment le presque hors-temps de l’activité créatrice (ou poiesis) ?.. _, convalescent _ dit alors joliment et par anti-phrase Claude Lanzmann _ à passer _ s’égrener « ordinairement« … _, j’ai toujours le plus grand mal à m’en persuader« :
…
à part les deux ans de rédaction vraiment « à fond« de ce « Lièvre de Patagonie » (page 14 : « j’en avais le désir, mais, après l’effort colossal de la réalisation de« Shoah« , je n’étais pas _ immédiatement _ sûr de m’attaquer à un travail de si grande ampleur, de le vouloir vraiment« : et c’est une condition vraiment nécessaire, pour qu’il y ait « œuvre« , que la force de cet « élan« …),
…
notre analyse devra aussi s’attacher d’un peu près à l’ »esquisse« , absolument magnifique, aux pages 341-342, très précisément, d’une autre « œuvre« en projet de Claude Lanzmann : son film « nord-coréen« , à tourner à Pyong-Giang (!), qui conclut le récit des deux très beaux chapitres XIII et XIV :
je vais tâcher d’y revenir ici-même : et c’est même un éclairage capital, à mes yeux, sur l’œuvre (et sur la poïétique même !) de Claude Lanzmann !
…
voici la « clé« , donc, à mes yeux, de cet immense « Lièvre de Patagonie » !.. :
le « débusquage » par Claude Lanzmann,
je reprends le fil et l’élan de ma phrase,
de comment le « placement » « dans l’imminence de la fulguration » de la « vérité » du « témoignage«
…
_ du « témoignage« « vrai« comme « loi » et « mandat » (impératif ! « l’impératif catégorique de la recherche et de la transmission de la vérité« , dit-il très précisément, page 453) de tout l’œuvre : pas moins ! _
…
permet et autorise la « survenue« , enfin, de cette « joie sauvage« (« bondissante« !) de l’ »incarnation » réussie de l’ »être vrais ensemble« ,
qui constitue la plus précieuse moisson de la vie d’ »auteur » et de l’œuvre de Claude Lanzmann ;
…
soit une affaire de « rencontres » merveilleusement bien « accueillies« , remarquées _ on peut ne pas même seulement s’en apercevoir et les « relever« !.. _ ainsi que, ensuite, « conduites« , « menées » ;
…
selon une « méthode » lentement, patiemment, opiniâtrement _ « je suis ainsi fait : il est difficile de me faire renoncer« , affirme-t-il page 307 _ avec délicatesse,
et beaucoup de courage aussi,
« élaborée » de bric et de broc au travers de pas mal de vrais dangers affrontés ;
…
quasi « une folie douce » (l’expression, corrigée, en effet, en « une folie, une folie pas douce« , se trouve page 505) :
…
sa « méthode d’enquête » (« à fond » : afin d’ »entrer dans les raisons et déraisons, dans les mensonges et les silences de ceux que je veux peindre ou que j’interroge« ),
…
Claude Lanzmann la spécifie même ainsi, page 285
_ c’est à propos d’articles rédigés en 1958 et 1959 : sur le « Curé d’Uruffe« , le premier (pour France-Dimanche : il en rédige
_ « je décidai que je ne pouvais pas en rester là et que j’allai écrire un autre texte, libre de toute contrainte, pour « Les Temps modernes », revue qui par ailleurs avait donné au fait divers un statut et une dignité ne le cédant en rien à ceux de la littérature ou de la philosophie. Sartre et le Castor dévoraient dans les journaux ce qui avait trait aux passions humaines, lisaient des romans policiers ; et la revue ne recula jamais devant la publication du récit des pires déviances, lorsque nous les jugions dévoilantes« , page 282 _ ;
…
il en rédige, donc, dans la foulée une version plus élaborée, « Le Curé d’Uruffe et la raison d’Eglise« , pour le numéro 146 des « Temps modernes« , au mois d’avril 1958 : « j’étais formidablement fier de ce long texte, qui fut d’emblée reconnu par ceux qui le lurent ; et qui est resté comme une balise inoubliée dans leur mémoire, j’en ai souvent des échos », page 283),
et sur « la fuite (du Tibet) du dalaï-lama« , le second, « pour « Elle », cette fois« , page 285 ; « l’article, fort long, parut dans le numéro 696 de « Elle », daté du 27 avril 1959« , page 260 _
…
Claude Lanzmann le spécifie même, donc, ainsi, et ce n’est pas qu’un oxymore :
…
« J’ai travaillé à ces articles ou à mes films de la même façon : enquêter à fond,
me mettre _ = ma subjectivité _ entre parenthèses, m’oublier entièrement,
entrer _ « vraiment« : par un tel « décentrage » de soi !.. _ dans les raisons et déraisons _ objectives, par là ! _, dans les mensonges et les silences _ facteurs d’ajout d’« opacité« : à dissiper !.. _ de ceux que je veux peindre ou que j’interroge, jusqu’à atteindre un état d’hypervigilance _ oui ! il le faut ! c’est le sas obligé vers le « dévoilement de la vérité« recherché ! _ hallucinée
…
_ le terme, c’est à relever, revient, lui aussi (après « débusquer« ), à diverses reprises :
d’abord, page 494 : « j’étais dans un état second, halluciné » (il faut cette puissance-là de « dévoilement de la vérité« !)
« subjugué par la vérité qui se révélait à moi« alors… :
…
c’est lors de la toute première interrogation, en Pologne et à Treblinka, celle « du paysan en chemise rougeâtre, à la bedaine spectaculaire et heureuse, inoubliable pour ceux qui ont vu « Shoah« » (page 493), celle de Czeslaw Borowi ;
…
ainsi que page 503 : « l’hallucination vraie dont j’étais la proie gagnait aussi les protagonistes« de « Shoah« , tel un Henrik Gawkowski, après un Abraham Bomba… : c’est toujours à Treblinka, mais cette fois au moment du tournage avec le chauffeur de locomotive, Henrik Gawkowski : « de même que Bomba, dans les miroirs du salon de coiffure d’Israël _ lors du tournage de sa séquence _, allait se revoir coupant les cheveux des femmes à l’intérieur d’une chambre à gaz de Treblinka,
de même Henrik Gawkowski,
qui a peut-être effectivement transporté, dans un des wagons qu’il amenait jusqu’à la gare, Bomba, sa femme et son bébé,
hallucine lui aussi complètement lorsque, penché de tout son buste à la fenêtre de sa locomotive, il regarde sous l’œil de la caméra les cinquante wagons imaginaires _ le jour du tournage, n’était présente que la locomotive _ qu’il conduit _ on notera aussi au passage la métonymie _ à la mort _ ainsi « revue« , « réincarnée« , ce jour-là ! Il n’y a en effet aucun wagon, rien d’autre que la locomotive : louer un train entier eût été impossible, d’un coût exorbitant et inutile. C’est Henrik, son corps accablé de remords, ses yeux fous, la réitération du geste mimant l’égorgement, son visage hagard et concentré de détresse, qui donnent vie _ voilà _ et réalité _ = « vraie« ; non menteuse ! _ au train fantôme _ de ce jour de tournage-là (« le premier tour de manivelle eut lieu six mois plus tard à Treblinka, autour du 15 juillet » 1978 … _ page 502), sans les cinquante wagons d’alors (« de juillet 1942 à août 1943, pendant toute la durée de l’activité du camp de Treblinka, alors que 600 000 Juifs y étaient assassinés« , page 491), ni, a fortiori, leur chargement de « pièces à traiter« ! _ ; qui le font exister pour chacun des témoins _ devant les divers écrans, ensuite : au cinéma ; et maintenant grâce au DVD_ de cette scène stupéfiante« ;
…
ou page 504-505 : « et chaque fois qu’il m’arrive de revoir les séquences tournées là-bas _ à « la gare de Sobibor » comme à « celle de Treblinka« … _, je me dis que c’est la même urgence hallucinée _ voilà ! _ qui me pousse, pour comprendre et faire comprendre _ les deux volontés intimement unies et mêlées : en faisant écouter, regarder et ressentir par ce que le film a pu saisir de ces « réincarnations« -là des divers « témoins« des actions on ne peut plus matérielles et « effectives« de l’extermination, alors, les « revivant » en la difficulté même de leur récit en ces circonstances « hallucinées« -là _ à l’étrange démarche d’arpenteur que j’effectue, traversant les voies, en compagnie _ à Sobibor, cette fois-là _ de Piwonski, l’aiguilleur de 1942.
…
Je me vois et m’entends lui dire : « Donc ici c’est encore la vie. Je fais un seul pas et je suis du côté de la mort ». Disant cela, je fais en effet le pas _ rien ne pouvant remplacer cela, alors et là-bas ! en lieu et temps !!! _ ; je saute le pas ; et il m’approuve. Vingt mètres plus loin, je monte sur un talus herbeux ; il m’informe de sa voix un peu sentencieuse de colonel communiste : « Ici, vous vous trouvez sur la rampe où étaient déchargées les victimes destinées à l’extermination. » Bordant cette rampe sur toute sa longueur, deux rails d’acier bleui, imperméable au passage du temps. Je demande : « Et ce sont les mêmes rails ? _ Da, da », me répond-il
…
_ ce n’était donc pas rien que « le XIXe siècle qui existait là-bas« (en Pologne) et qu’« on pouvait« , ainsi, « toucher« : « Permanence et défiguration des lieux se jouxtaient, se combattaient, s’engrossaient l’une l’autre, analyse magnifiquement Claude Lanzmann à la page 494, ciselant la présence _ oui ! à qui apprend à la « percevoir« … _ de ce qui subsistait d’hier d’une façon peut-être encore plus aiguë et déchirante » : les années 40 aussi.
…
Il fait très beau _ je reprends la citation du passage à Sobibor, avec Jan Piwonski, page 505 _, une beauté du jour qui me désarçonne et me plonge dans le désarroi. J’interroge : « Et il y avait des beaux jours comme aujourd’hui, j’imagine ? _ avec un peu de difficulté toutefois… Il murmure : « Il y avait des jours encore bien plus beaux qu’aujourd’hui. »« …
…
Et c’est immédiatement en suivant ce passage-là, et en conclusion (en quelque sorte « synthétique ») de sa conversation de ce jour-là, à Sobibor, avec Jan Piwonski, qu’intervient, page 505, l’expression « une folie pas douce« :
…
« Je pense, on peut penser, que la folie, une folie pas douce, m’avait saisi : sur chacun des lieux de mort _ industrielle, de masse, de la dite « Solution finale« … _, j’ai voulu refaire
…
_ à seule et unique fin, absolument déterminée (= implacable !), d’« incarnation » « vraie » de cette « perception« de « présence« !.. sous la garantie conjointe de vérité ! et des paroles, et des gestes du corps, entièrement « ré-investi«
(en tous ses sens « habités« , ce corps du « témoin« qui parle et qui « revit« , par une « vision« « vraie » de ce qui avait pu être éprouvé, en même temps que violemment nié, refoulé et anesthésié ! : cf les mots terribles d’Abraham Bomba, page 452 : « Oh, vous savez, « ressentir » là-bas… C’était très dur de ressentir quoi que ce soit : imaginez : travailler jour et nuit parmi les morts, les cadavres ; vos sentiments disparaissaient ; vous étiez mort au sentiment ; mort à tout« (…) face à l’incommensurabilité de l’extermination de masse d’alors et au quotidien)
des « témoins« survivants retrouvés et rencontrés,
en une « reviviscence« , « ravivée«
(« ces souvenirs, précieux comme de l’or et du sang, que je ravivais« en permettant, par la seule écoute exigeante de leur récit, comme une torrentielle « résurgence« : page 496)
de ce qui avait été alors accompli ! _
…
une folie pas douce, m’avait saisi : sur chacun des lieux de mort
j’ai voulu refaire, par conséquent,
et chaque fois : à Treblinka, à Sobibor, à Chelmno, etc…
le dernier chemin« des annihilés… ;
jusqu’au « noir« , définitivement invisible, à quiconque et à toute image, de leur asphyxie,
car « le fait est _ indépassable ! incontournable ! irréfractable ! _ que les gens mouraient dans le noir« , page 486 ;
…
à Auschwitz aussi :
« descendant avec Chapuis caméra au poing les degrés des salles souterraines des grands crématoires II et III de Birkenau, incapable de marcher droit parmi les blocs ruinés recouverts de neige, nous cassant tous les deux la gueule en protégeant l’appareil autant que nous le pouvions ; mais il était bon de se casser la gueule ; il était juste de souffrir , d’avoir par moins vingt degrés, à réchauffer le moteur de la caméra pour pouvoir continuer, absurdement, à faire de longs panoramiques gauche droite et droite gauche, reliant ce qui restait du vestiaire, nommé dans le récit de Filip Müller _ cf aussi son livre « Trois ans dans une chambre à gaz d’Auschwitz« , aux Éditions Stock _ « centre international d’informations », à l’immense chambre à gaz, et vice versa« , page 505 toujours… _
…
« J’ai travaillé
_ je reprends maintenant le fil de ma citation après cette incise sur le terme d’« hallucination« … _
à ces articles ou à mes films de la même façon :
enquêter à fond,
me mettre entre parenthèses, m’oublier entièrement,
entrer _ voilà l’objectif ! _ dans les raisons et déraisons, dans les mensonges et les silences de ceux _ = d’autres que soi _ que je veux peindre ou que j’interroge,
jusqu’à atteindre _ afin de pénétrer enfin, si peu que ce soit, le mystère, « opaque« , à l’abord, de leur « vérité » de personne, en son absolue « estrangeté« … _un état d’hypervigilance hallucinée
et précise,
qui est pour moi la formule même de l’imaginaire _ actif et fécond : pour connaître et comprendre « vraiment« , en en « démêlant« les divers « composants« , le réel (= « la chose même« …) de la personne ;
…
à rebours de l’autre imaginaire (« la folle du logis« de Malebranche, la « maîtresse d’erreur et de fausseté« de Pascal) qui, par ses « feintes« n’aspire, lui, qu’à divertir, tromper et fuir ce « réel« « irréfractable » !..
…
C’est la seule loi _ le terme est décisif ! c’est une règle absolument impérative de l’esthétique de vérité (et son « mandat« !) de Claude Lanzmann _ qui me permette de dévoiler leur vérité _ s’il le faut (et il le faut parfois ! dans le cas des « tricheurs » !..) de la débusquer _, de les rendre vivants et présents à jamais _ = « ceux« -là mêmes « que je veux peindre ou que j’interroge« : voilà l’enjeu ! il est magnifiquement élevé !
Il ne s’agit pas de se laisser prendre et « séduire« , tromper, par de simples apparences (et tous les « faux-semblants« qu’on voudra : et il n’en manque certes pas ! ils sont légion…).
…
Sur ce point, Claude Lanzmann est, d’ailleurs, on ne peut plus parfaitement dans le droit fil
et de sa mère, Pauline (dite aussi Paulette) : cf « sa tranchante intelligence qui débusquait _ voilà ! _ les compromis, les faux-semblants, le mensonge à soi« (ou aux autres), page 134 _,
et de sa sœur, Évelyne : d’une part, « elle ne trichait pas, ignorait le compromis, était en proie au démon de l’absolu« , page 166 ;
d’autre part, elle pourtant si belle (« avec son œil de peintre, Serge Rezvani, qui fut son mari, portait un jugement très sûr et admiratif sur la beauté et l’expressivité du visage, sur le corps absolument parfait de sa femme« , page 168), et « alors qu’elle avait autour d’elle une véritable cour d’hommes beaux et attirants (…), ma sœur se sentait bien avec les hommes laids, ils la rassuraient ;
…
l’amour étant à ses yeux autre chose que le double mirage des belles apparences,
d’abord amour de l’âme« , page 178 ; peut-être parce qu’« elle vivait contradictoirement sa _ propre _ beauté ; évidente sous le regard des autres, problématique pour elle : elle ne s’en éprouvait pas propriétaire ; elle ne se tint jamais pour une « belle de souche » _ elle s’était fait « refaire« le nez
…
(cf page 169 : « René Simon avait résolu que ma sœur, avec son corps idéal, devait faire carrière au cinéma ; mais que son nez d’intellectuelle juive était un obstacle dirimant. Il fut franchi. Elle n’eut de cesse, contre l’avis de son mari _ Serge Rezvani _ que de se livrer à la chirurgie esthétique, victime elle aussi du problème ontologique que le nez _ « l’énorme nez juif de ma mère« , page 91 : un peu trop spectaculairement sémite _ de Pauline posa à toute sa progéniture. Se refaire le nez était une mode naissante et fiévreuse à l’époque, une aventure libératrice (…) Le maître chirurgien alors était si couru par les dames qu’il donna éponymement son nom à la chose : on disait « le nez Claoué », qui n’était pas toujours une réussite absolue. Juliette Greco eut un nez Claoué ; Evelyne Rey _ ce fut le nom de scène que ma sœur se choisit _ eut le sien, ravissant en vérité. Je ne le découvris que plus tard, me trouvant la plupart du temps en Allemagne, à Tübingen puis à Berlin, pendant les années de sa vie avec Serge » _ au final de la décennie quarante) _ ;
…
elle ne se tint jamais pour une « belle de souche » ; et c’était la source constante d’une incertitude, d’une interrogation inquiète à laquelle il n’y aurait jamais de réponse avérée. Une belle femme n’est rien d’autre qu’une laide déguisée, a écrit quelque part Sartre ; et ce n’est pas pour rien qu’elle lisait et relisait sans fin « Belle du Seigneur« d’Albert Cohen, dont le matérialisme féroce l’enchantait« , pages 178-179.
Fin de l’incise sur l’atavisme familial de la féroce allergie aux « faux-semblants« ;
et retour à la décisive « loi« lanzmannienne du « dévoiler la vérité« …
…
C’est ma loi en tout cas _ la chose est capitale ! et Claude Lanzmann l’assume jusqu’au bout !
Je me tiens pour un voyant ;
et j’ai _ même _ recommandé à ceux qui font profession d’écrire sur le cinéma d’intégrer le concept de « voyance » à leur arsenal critique«
_ nous voici ici très proches de ce que, pour ma part, et en suivant la leçon de Marie-José Mondzain dans son fondamental « Homo spectator« , je me suis autorisé à nommer la faculté d’« imageance« .
De Marie-José Mondzain, sur le même sujet, consulter aussi la participation à un tout récent recueil d’articles : « La Bataille de l’imaginaire« …
…
Je précise maintenant ici tout de suite ce que j’entends par cette expression _ clé de mon analyse ici _ de
« placement » « dans l’imminence de la fulguration » de la « vérité » du « témoignage« :
…
advenant, la dite « vérité » du « témoignage« , dans l’expérience « véritablement » partagée elle-même,
d’une façon ou bien consentie,
et même heureusement mutuellement désirée, en pleine confiance
…
_ l’exemple sans doute le plus achevé d’une telle « pleine confiance » étant celui, magnifique, des « dialogues«
_ tout à la fois « partage« , « confrontation » et « échange« ,
comme cela s’avèrera bien davantage, cependant, avec le plus mutique Simon Srebnik, page 455 : « Quand Bomba, dans sa cabane, me parlait de Treblinka, j’entendais pleinement tout ce qu’il me disait ; l’idée de confronter son récit au lieu ne m’effleurait pas ; il le faisait revivre _ voilà ! _ par sa parole » ;
tandis que « les bribes que je recueillais avec Srebnik étaient les souvenirs fragmentés d’un monde éclaté, à la fois dans la réalité _ de Chelmno, cette fois (différent de Treblinka)_ et par la terreur qu’il lui _ âgé de treize ans et demi seulement alors _ avait inspirée« , page 454… _
l’exemple achevé et magnifique des « dialogues »
de Claude Lanzmann avec Abraham Bomba,
…
d’abord lors des « deux journées cruciales » _ oui ! en 1977 _ dans sa « cabane de vacances dans les montagnes de l’État de New-York« , du côté d’Albany _ « cruciales, non seulement par ce qu’il m’apprenait, que j’ignorais, que tous ignoraient, et qui faisait de lui un témoin unique ;
mais encore parce qu’elles me livrèrent la clé de ce qui devait être ma posture _ d’écoute et d’enquête : voilà ! un apport éminemment capital ! _ face aux protagonistes juifs de mon film.
…
Dans son mauvais anglais rocailleux, Bomba le coiffeur était un orateur magnifique ; et je crois qu’il me parla, pendant ces quarante-huit heures, comme s’il n’avait jamais parlé devant personne, comme s’il le faisait pour la première fois. Jamais quelqu’un d’autre ne l’avait écouté _ oui ! _ en lui témoignant une aussi fraternelle et sourcilleuse attention _ un point capital ! _, qui le contraignit, par tous les détails avec lesquels je lui demandais _ « en guetteur implacable et émerveillé » (tout à la fois, selon l’expression magnifique de la page 385) que Claude Lanzmann apprenait toujours mieux à être… _ de fouiller _ une opération difficile _ sa mémoire, à se réimmerger _ un terme décisif ! _ de plus en plus profondément dans les indescriptibles _ certes _ moments qu’il avait passés à l’intérieur de la chambre à gaz.
…
Je compris qu’afin d’être capable de le filmer, lui et ses pareils, je devais à l’avance tout savoir sur eux ; ou du moins en savoir le plus possible, on ne sait jamais tout.
Car obtenir semblable reviviscence _ encore un concept absolument fondamental ! la clé même de « Shoah » ! _ requérait _ comme condition sine qua nonde l’« incarnation » de l’expérience traumatisante (à quel incommensurable degré !..) passée _ que je pusse leur apporter à tout instant mon aide ; aide (…) signifiant d’abord la possession de la connaissance nécessaire pour oser interroger ou interrompre ou remettre dans le droit-fil _ infiniment délicat et déterminé, tout à la fois, c’est un travail à deux _, pour poser les bonnes questions à leur heure _ le timing de l’échange que requiert la « menée » de la production du « témoignage« (de l’indescriptible : « l’administration _ industrielle _ de la mort« ! ici…) est lui aussi capital ; et requiert une « hypervigilance« , en effet, et « hyper hallucinée« et « hyper précise » ! des deux !..
…
Entre Bomba et moi, lorsque je le quittai, l’une d’elles en tout cas était résolue : la question de confiance : il savait pouvoir compter sur moi et à qui il parlerait« , pages 447-448 _ ;
…
comme, ensuite _ « deux ans plus tard« , « à l’automne 1979« , page 448 _, lors des séances de tournage en Israël _ avec le récit à filmer de « la coupe des cheveux des femmes juives à l’intérieur de la chambre à gaz (de Treblinka), point d’orgue du pire » et « raison essentielle de notre commune entreprise« de filmage, page 449 _, pour la poursuite et l’achèvement, au tournage, de ces « entretiens » avec Abraham Bomba :
…
« Au fur et à mesure de l’avancée du tournage _ « je le filmai face à la Méditerranée, sur la belle terrasse d’un appartement de Jaffa que m’avait prêté Théo Klein« , page 449 _, je sentais Bomba gagné par une nervosité à laquelle répondait ma propre anxiété. Nous savions, lui et moi, que le plus difficile était devant nous ; qu’il nous faudrait bientôt en venir à la coupe des cheveux des femmes juives à l’intérieur de la chambre à gaz, point d’orgue _ peut-être _ du pire, raison essentielle de notre commune entreprise.
A plusieurs reprises, à la fin des journées précédentes, il m’avait pris à part : « Cela va être très difficile ; je ne sais pas si je pourrais le faire », m’avertissait-il. Je voulais l’aider, m’aider moi-même ; il n’était pas question de continuer à le faire parler sur la terrasse, face à la mer bleue _ edénique, idyllique.
…
C’est moi qui eus l’idée du salon de coiffure. Bomba n’était plus coiffeur, il était retraité, et sa retraite était le motif majeur de sa « montée » en Israël, de son aliyah. Mais ma proposition lui agréa ; il se chargea de trouver lui-même le salon« , page 450 ; « il choisit une vraie boutique de coiffeur pour hommes, avec un patron entouré de plusieurs garçons qui officiaient sans un mot ; et des clients qui entraient librement, non prévenus de ce qui se passait à l’intérieur« ; « C’est Abraham aussi qui choisit son client, un ami à lui, de Czestochowa probablement, à qui il coupa les cheveux, maniant presque sans interruption les ciseaux pendant toute la durée de la séquence, c’est-à-dire au moins vingt minutes. Ou plutôt à qui il fit semblant de couper les cheveux : l’eût-il fait vraiment, son « patient » eût terminé pratiquement tondu.«
…
« Pourquoi le salon de coiffure ? Les mêmes gestes, pensais-je, pourraient être le support, la béquille des sentiments ; lui faciliteraient peut-être le travail de parole_ de « témoignage » : le « travail de vérité » au cœur ardent, « fulgurant« , même, du« travail de l’œuvre » de (et qu’est) « Shoah« … _ et de monstration qu’il aurait à accomplir devant la caméra. Bien sûr, ce n’étaient pas les mêmes gestes ; un salon de coiffure n’est pas une chambre à gaz ; faire semblant de couper les cheveux d’un homme seul n’a rien à voir avec le récit que j’avais entendu dans la montagne américaine : nues , affolées par les coups de fouet des gardes ukrainiens, les femmes juives pénétraient par fournées de soixante-dix, dans la chambre à gaz où les attendaient dix-sept coiffeurs professionnels qui les faisaient asseoir sur des bancs de bois disposés à cet effet ; et les dépouillaient de leur chevelure entière en quatre coups de ciseaux. »
…
Quand, durant le tournage, je demande à Abraham de refaire les gestes d’alors, il empoigne, ciseaux brandis, la tête de son ami, son faux client, et montre comment il procédait et à quelle vitesse, faisant le tour de son crâne : « On coupait comme ça, ici… là… et là… ce côté… ce côté, and it was all finished. » Deux minutes par femme, pas plus.
…
« Sans les ciseaux, la scène eût été cent fois moins évocatrice, cent fois moins forte.
Mais peut-être même n’aurait-elle même pas avoir eu lieu : les ciseaux lui permettent d’incarner _ en son corps, en ses gestes, en ses moindres sensations : une« reviviscence« … _ son récit _ de « témoignage » de ce qui de fait advenait là, dans la chambre à gaz de Treblinka _ ; et de le poursuivre, de reprendre souffle et force, tant ce qu’il a à dire est impossible et épuisant« , page 451 ;
avec le moment « impossible » de l’arrivée dans cette chambre à gaz de Treblinka « des femmes de ma ville natale, que je connaissais qui me connaissais« , dit Bomba.
…
Car « il y a deux moments dans cette longue séquence : au commencement de son récit, Abraham adopte un ton neutre, objectif, détaché ; comme si tout ce qu’il doit raconter ne le concernait pas ; comme si l’horreur aller pouvoir s’engendrer sans son implication, harmonieusement presque« , page 451 ; musicalement sans « point d’orgue« … « Mes questions ne lui permettent pas de continuer comme il voudrait ; elles sont d’abord topographiques ; réclament des précisions d’espace et de temps. (…) Ces questions permettent la recréation _ voilà _ la plus exacte possible des lieux et de la situation ; mais elles m’autorisent aussi à oser aborder _ émotionnellement _l’interrogatoire le plus difficile, qui ouvre le deuxième moment de la séquence :
…
« Qu’avez-vous éprouvé la première fois _ voilà l’objet précis de la question _ que vous avez vu déferler dans la chambre à gaz toutes ces femmes nues et ces enfants, nus également ? » Abraham esquive, répond à côté ;
la conversation se poursuit par d’autres précisions sur la coupe de cheveux, destinée à leurrer les femmes aux derniers instants de leur vie, en leur faisant croire, à cause de l’utilisation de ciseaux et de peignes et non d’une tondeuse _ jusqu’où peut aller la technique de la manœuvre de tromperie ! _, qu’il s’agit d’une coupe normale, comme la pratiquent les coiffeurs pour hommes.
…
A cet instant, quelque chose sur le visage de Bomba, dans le timbre de sa voix, dans les silences qui espaçaient ses paroles …
_ données subtiles auxquelles l’« addiction » au théâtre de Claude Lanzmann l’avait très précisément sensibilisé, au moment de son mariage avec la magnifique comédienne Judith Magre, la décennie des années soixante ; cf pages 383 à 385 :
…
« j’étais devenu tellement sensible que le plus infinitésimal écart _ un concept leibnizien ! _ dans un mouvement du corps, dans la hauteur d’un timbre _ le registre du musical est spécialement ultra-sensible _, prenait pour moi une importance démesurée, me changeant, tout à la fois _ et la nuance est d’une vérité magnifique ! _ à mon insu et au comble de la lucidité, en guetteur implacable et émerveillé » : une expression magnifique de justesse ! Avec ce commentaire, alors, page 385 : » C’est l’addiction même. J’aimais acteurs et actrices, l’univers du théâtre qui m’était chaque jour offert. On s’était tellement habitué à ma présence dans le sillage de Judith, à mes commentaires et à mes réflexions, qu’un échange, une forme d’entraide amicale s’instauraient _ même _ parfois entre les metteurs en scène et moi » ; avec, encore, cette remarque rétrospectivement prémonitoire, si j’ose l’expression : « J’apprenais peut-être les balbutiements d’un métier que j’exercerais plus tard, autrement, bien ailleurs…« ,page 385, donc ; fin de l’incise
…
A cet instant, quelque chose sur le visage de Bomba, dans le timbre de sa voix, dans les silences _ musicaux, eux aussi _ qui espaçaient ses paroles,
m’alerta. Une tension visible, palpable montait dans la pièce _ de ce salon de coiffure _ ; j’ignorais quoi, quand, je n’en étais pas sûr ; mais j’eus le sentiment qu’un événement essentiel allait, pouvait se produire.
…
J’étais placé juste derrière le caméraman et je pouvais lire sur le compteur de la caméra combien de minutes de pellicule vierge restaient dans le magasin : cinq minutes. C’est beaucoup, c’est peu ; j’obéis _ alors _ à une intuition _ de « génie » (poïétique) d’« auteur« … _ brutale ; je dis à voix basse à Chapuis : « On coupe; et on recharge immédiatement ». Avec la caméra 16 mm Aaton que j’utilisais, il faut changer de magasin toutes les onze minutes. Des magasins pleins étaient prêts ; le changement s’opéra en un éclair ; et la conversation se poursuivit comme s’il n’y avait eu aucune interruption ; Bomba ne s’en avisa pas.
…
Après un temps, je reposai _ revenant à la charge au service du « travail de la vérité« et de sa « monstration« … _ la question laissée sans réponse.
Celle-ci fut _ alors _ magnifique et bouleversante ; il ne biaisa pas _ cette fois _ :
…
« Oh, vous savez, « ressentir », là-bas… C’était très dur de ressentir quoi que ce soit : imaginez
_ c’est là tout l’enjeu de « représentation« , si difficile, de la « transmission » du« témoignage« ; la force (ou la faiblesse) d’« autorité« de celui-ci
à faire enfin, outre « vraiment« écouter, « vraiment« ressentir (à d’autres : nous, en l’occurrence, ici !) et enfin « vraiment« comprendre l’incrédibilité
trop extra-ordinaire de l’absolument insupportable qui était, de fait, advenu…
…
Ce à quoi a, de fait (« un secret » est le sous-titre de son livre) échoué Jan Karski, avec « Mon Témoignage devant le monde« , au moment même où se perpétrait au quotidien (de toutes ces années), en sa Pologne, la « Shoah » ;
…
ou encore, à sa première publication, en 1947, à Turin, à 2500 exemplaires seulement, le « témoignage« de Primo Levi, « Si c’est un homme » ;
…
ou encore ce que s’emploie à narrer le « génie« (« littéraire » aussi : récompensé du « Prix Nobel de Littérature 2002« …) du grand Imre Kertész au retour (d’Auschwitz, Buchenwald et Zeitz, « comme lui« …) du narrateur, de quinze ans (à son retour, l’été 45, à Budapest, « comme lui-même« , aussi…) d’« Être sans destin« , aux personnages de ses deux voisins juifs, Steiner et Fleischmann, demeurés eux à Budapest : mais « ils ne comprenaient pas trop« ; « et je parlais, en vain peut-être, et aussi un peu à tort et à travers« (pages 357), aux pages 348 à 359 de ce magnifique livre… : « je voyais qu’ils ne voulaient rien admettre _ de l’analyse de son « témoignage« … _, et ainsi, prenant mon sac et ma casquette, après quelques paroles, quelques gestes embarrassés, mouvements inachevés, au milieu d’une phrase inachevée, je suis parti« , page 359 d’« Être sans destin« … _,
…
imaginez,
travailler jour et nuit parmi les morts, les cadavres,
vos sentiments disparaissaient ; vous étiez mort au sentiment ; mort à tout ».
…
Puis il ajouta : « Je vais vous raconter quelque chose qui s’est produit pendant que je travaillais à la chambre à gaz quand sont arrivées des femmes de ma ville natale _ Cestochowa _ que je connaissais, qui me connaissaient ».
…
« A cet instant précis, ce mort au sentiment fut submergé par le sentiment, avec une violence telle qu’il ne put aller plus loin, faisant de la main un petit geste qui signifiait à la fois la futilité et l’impossibilité de continuer à raconter ; et aussi, ce qui est la même chose, l’impossibilité, la vanité de comprendre.
…
La scène est célèbre _ le dialogue se trouve aux pages 168-169 de la transcription sur papier seulement de « Shoah« (même si « un livre ? Quelle idée débile ! « Shoah » n’est pas un livre, c’est un film. C’est impossible que ce soit un livre« , répond abruptement Claude Lanzmann à la question de Jean-Michel Frodon : « Si vous aviez choisi de faire de « Shoah » un livre, ce serait une autre création, mais qui aurait amené d’autres choix« , à la page 118 du recueil d’articles « Le Cinéma et la Shoah« , paru en 2007 aux Éditions des Cahiers du Cinéma…) _ : Abraham efface d’un coin de serviette les larmes qui perlent à ses yeux, se mure dans le silence tout en continuant à tourner ciseaux en main autour de la tête de son ami ; et tandis qu’il tente de se ressourcer, parlant à ce dernier en yiddish d’une voix confidentielle _ il lui dit : « Ils mettaient ça dans des sacs et c’était expédié en Allemagne« ... _, s’instaure alors entre lui et moi le dialogue de deux suppliants, lui me pressant d’arrêter, moi l’exhortant fraternellement _ oui _ à poursuivre parce que je considère qu’il s’agit de notre tâche commune _ pour la mémoire (versus l’annihilation !) des exterminés _ de notre devoir _ envers eux _ partagé _ oui !
…
Tout ceci advint au moment où il n’y aurait plus eu de pellicule dans la caméra si je n’avais pas donné l’ordre de recharger. C’eût été une irréparable perte, car je n’aurais jamais pu demander _ certes : et c’est là un article puissant de la « loi« d’esthétique du « mandat« de l’« œuvre de vérité » du cinéma de Claude Lanzmann _ à Bomba, comme cela se peut dans une répétition de théâtre, de recommencer à pleurer _ l’« incarnation« , ici (de « témoignage« ), n’est pas « théâtrale« …
…
La caméra ne s’est pas arrêtée de tourner ; les larmes d’Abraham étaient pour moi _ comme « metteur en œuvre« de la « vérité » même de la « Shoah« (telle qu’elle est advenue) dans et par le film « Shoah » :
qu’on se souvienne des mots mêmes du « mandat » énoncé, « au début de l’année 1973« , par Alouf Haleken : « réaliser un film qui soit _ et « du point de vue des Juifs » : celui des annihilés eux-mêmes, à l’heure du plus noir de la chambre à gaz… _ qui soit la Shoah« , page 429 du « Lièvre de Patagonie« … _
…
les larmes d’Abraham étaient pour moi précieuses comme du sang, le sceau du vrai, l’incarnation même.
…
Certains ont voulu voir dans cette scène périlleuse la manifestation de je sais quel sadisme _ de ma part _, alors que je la tiens au contraire pour le paradigme de la pitié, qui ne consiste pas à se retirer sur la pointe des pieds face à la douleur, mais qui obéit d’abord à l’impératif catégorique de la recherche et de la transmission _ aussi ; ou « partage« , face aux comportements de mutisme et de censure des complices de l’annihilation… _ de la vérité _ objective.
…
Bomba m’étreignit longuement après le tournage ; et plus longuement encore après avoir vu le film : nous passâmes plusieurs jours à Paris ; il savait qu’il resterait _ par ce « témoignage« de vérité désormais visible et audible... _ comme un héros inoubliable« , pages 452-453…
…
Je reprends ici le fil de mon raisonnement interrompu par l’incise à propos du « partage« du « témoignage« , dans le « travail de la vérité« , dans l’exemple, en deux temps (dans les montagnes de l’État de New-York, en Israël) d’Abraham Bomba :
…
je précise maintenant ici tout de suite ce que j’entends par cette expression de
« Placement » « dans l’imminence de la fulguration » de la « vérité » du « témoignage« :
advenant, la dite « vérité« , dans l’expérience « véritablement » partagée elle-même
d’une façon ou bien consentie _ voilà où nous en sommes restés, avec l’exemple éloquent d’Abraham Bomba ; un parmi pas mal d’autres _ ;
…
ou bien d’une autre : dérobée
_ dans l’exception des « témoignages » arrachés par un dispositif de ruse (avec la « paluche » ; cf tout le chapitre XIX), aux bourreaux nazis _ qui constitue une autre version, un peu plus paradoxale, certes (car « piégée« !.. via le dispositif de la « paluche« ), de cet « être vrais ensemble« , encore, par lequel et sur lequel Claude Lanzmann conclut, page 546, tout le livre !
…
Ici, on peut se reporter à l’exemple de « l’ »être vrais ensemble« arraché par la ruse à l’Unterscharführer SS Suchomel
_ « à la fin mars 1976« , « à Braunau am Inn, la ville natale d’un certain Adolf Hitler !« , page 471 ; « je louais des chambres à l’Hôtel Post : nous transformâmes l’une d’elle en studio d’enregistrement, punaisant au mur le plan de Treblinka, choisissant l’endroit où se tiendrait William _ Lubtchansky, le cameraman _, assez loin de celui que j’assignais à Suchomel afin qu’il ne soupçonnât rien« , page 472 _,
rapporté aux deux pages 472-473,
quand, chantant « par deux fois le chant de Treblinka que les Juifs du Sonderkommando devaient apprendre dès leur arrivée », « la dureté soudaine de ses yeux manifeste _ à tous, désormais _ qu’il est à cet instant entièrement ressaisi _ voilà la vérité (de l’homme Suchomel) qui se trouve alors « révélée » à l’image « saisie« , et pour jamais, par le film _ par son passé d’Unterscharführer SS ; et quel homme impitoyable il était lorsqu’il avait pouvoir de vie et de mort« … :
…
« ce fut une journée éprouvante et éreintante. J’étais horrifié par ce que j’apprenais ; je savais en même temps qu’il s’agissait d’un témoignage extraordinaire, car personne n’avait jamais décrit, avec un tel luxe de détails, généré par mes questions précises et d’allure purement techniques, dépourvues de toute connotation morale, le processus de la mise à mort dans le camp d’extermination de Treblinka« …
…
« Le même soir, dans un restaurant de Munich, William _ Lubtchansky, « mon chef opérateur » : lui « qui affina et approfondit mon éducation cinématographique« , a proclamé au passage, à propos du tournage de son premier film « Pourquoi Israël« , au début des années 70, Claude Lanzmann, page 427 _ et moi eûmes une dispute violente. Il était à bout, aussi sonné que moi par les risques encourus et les horreurs que nous avions entendues ; mais il n’avait pas supporté que j’invitasse Suchomel _ ainsi que son épouse _ à déjeuner _ le mari et sa femme « se goinfrèrent de canard et de crème fouettée, tandis que William, dont le père avait été gazé à Auschwitz, m’assassinait de son regard noir« , page 472… _ ; encore moins que je le payasse _ « en billets de 100 Deutsche Mark, prix de ses « douleurs »…« , page 473… Je comprenais William, il avait raison ; mais sans la discipline de fer que je me suis imposée, il n’y aurait pas eu un seul nazi dans le film. Ma froideur et mon calme étaient partie intégrante du dispositif de tromperie« _ au service de la manifestation de la vérité, par la « saisie« , au son et à l’image conjointement, le point est essentiel !, de tels « témoignages« de « vérité« ; et de pareille (fulgurante !) « incarnation« !..
…
« Placement » « dans l’imminence de la fulguration » de la « vérité » du « témoignage« , disais-je :
advenant, la dite « vérité« , dans l’expérience « véritablement » partagée elle-même,
d’une façon ou bien consentie ou bien dérobée,
…
dans l’expérience « véritablement » partagée du « témoignage » de quelqu’un
…
_ ou de quelque chose :
même si c’est, somme toute, un poil plus complexe, pour elle, la-dite chose, de se mettre à « parler«
(sauf médiation d’un « génie« tel que celui, poétique s’il en est, de La Fontaine en ses « Fables« :
« Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons :
Ce qu’ils disent s’adresse à tous tant que nous sommes » !..) ;
…
et de « s’adresser« à une personne qui se mette, elle, de son côté, « en partenaire« en quelque sorte, à enfin et « vraiment » l’« écouter« !..
…
Toutefois, je note tout de même ceci, page 506 : « le dernier jour du tournage en Pologne _ à Chelmno _, en décembre 1981 (…), nous étions trois, Chapuis _ le caméraman _, moi-même et Pavel, l’ingénieur du son, qui n’avait nulle voix humaine à enregistrer puisque je n’interviewais _ alors plus _ personne ; mais simplement le chant des forêts, du vent et des rivières ; j’aurais besoin de cela aussi« : voilà !..
…
Et encore, en suivant : « Avant Chelmno, nous étions restés quatre jours à Treblinka pour filmer encore et encore les pierres _ purement symboliques, commémoratives _ du camp ; et des locomotives trouant la nuit de leurs phares après avoir franchi le Bug sur le pont dont j’ai déjà parlé. Chapuis s’allongeait, caméra braquée, le long du ballast, presque au ras des roues ; et je lui enserrais le dos de mes bras pour qu’il ne bouge pas ni ne tombe. Pavel enregistrait su son Nagra le tonnerre du train« … _
…
« Placement » « dans l’imminence de la fulguration » de la « vérité » du « témoignage » de quelqu’un, donc,
ainsi que de quelque chose _ « le chant des forêts, du vent et des rivières » et « le tonnerre » « des locomotives » « après avoir franchi le Bug » : les moindres nuances d’expression sont éloquentes ! _, par conséquent…
…
« Placement » « dans l’imminence de la fulguration » de la « vérité » du « témoignage » de quelqu’un,
ainsi que de quelque chose, aussi, par conséquent,
qui, rompant avec le silence, le bavardage et le déni caractéristiques du mensonge, endémiques, si on les laisse faire, proliférer, gagner
…
_ dont il faut cependant distinguer le silence « vrai« , non trompeur, lui,
tel celui, atrocement traumatisé, d’un Dov Paisikovitch : « Sa jeunesse et son absolu mutisme avaient leur place éminente dans la tragédie que le film aurait à incarner« , car « le silence _ du mutisme qui ne peut pas être surmonté _ est aussi un mode authentique du langage« ; et pour le « témoignage » au film de Dov, Claude Lanzmann s’était « dit : « On ne parlera pas, on pêchera ensemble ; et je raconterai son histoire en voix off« … » Solution palliative que « Dov avait acceptée« ; mais qui ne put cependant pas être réalisée, parce que Dov « mourut malheureusement d’une crise cardiaque avant que je pusse tourner. J’eus beaucoup de regret. Et de peine« , page 441… _,
…
quelqu’un (et quelque chose) qui se mette, enfin, à parler « vrai«
grâce _ aussi ; et c’est crucial ! _ à quelqu’un d’autre qui,
rompant, de même, lui aussi _ est-ce donc si fréquent ? _, avec l’inattention, la distraction, la surdité, et aussi l’hypocrisie, la sournoiserie, la tromperie,
se mette, enfin, à écouter « vrai« , de même ;
suscitant, aussi, par là un mode « vrai » de la parole de l’ »interlocuteur » ; et de l’ »interlocution » elle-même
…
et cela, l’un par _ et avec ! la condition est exigeante, rare ; mais aussi rédhibitoire ! _ l’autre ! ces « interlocuteurs« …
…
celui « écoutant » ainsi, suscitant, très sûrement, en effet, « l’élan » _ minimum _de « confiance » _ cf l’expression, à propos du lien avec Abraham Bomba, page 448 :« était résolue la question de confiance« … _,
…
« l’élan » de « confiance« , enfin, donc, de la « confidence«
…
_ « confiance« et « confidence« : mots de la même famille ! et, surtout, ici, peut-être une qualité idiosyncrasique de quelques uns des Lanzmann-Grobermann,
…
notamment
la mère de Claude, Pauline (ou Paulette : cf aux pages 134 : « De ma mère, tous mes amis
_ « les provinciaux qui furent admis en khâgne à Louis-le-Grand à la rentrée suivante, celle de 1946« et pour lesquels « ma mère devint « La Mère », être générique, Alma Mater, non pas la mienne seule » : « elle les aimait comme des fils, autrement et plus que les siens propres, puisqu’elle entretenait avec sa descendance, on l’a vu _ Claude Lanzmann dit même à propos de son rapport à sa mère, page 93 : « la question de l’amour filial fut lancinante tout au long de notre vie » ; « c’était abandon contra abandon, inépuisable réserve de conversations, serments et tentatives de paix ultérieurs« … _, une relation spectaculairement dépourvue d’indulgence. A la suite de _ Jean _ Cau _ le meilleur copain d’hypokhâgne et khâgne de Claude à Louis-le-Grand _, tous l’appelèrent « La Mère »… _
…
n’étaient sensibles qu’à la curiosité formidable qu’elle avait de la vie et des amours de chacun, à la façon dont elle attirait, attisait leurs confidences à tous avec une géniale avidité. Elle les fascinait par sa tranchante intelligence qui débusquait les compromis, les faux-semblants, le mensonge à soi ; par sa culture (…), son humour, sa vitalité« ;
…
ainsi que 149 : « Monny _ de Boully : son nouveau compagnon et mari _ et Paulette_ qui « tint, donc chaque samedi un véritable salon littéraire« , recevant, dans le « petit appartement de deux pièces de la rue Alexandre-Cabanel, encombré de tableaux, de livres, d’objets précieux« (page 130) « Éluard, Aragon, Cocteau, Ponge, d’autres encore« (page 147), tel que le philosophe et ami des Surréalistes, Ferdinand Alquié, dans les années qui ont suivi la Libération (page 148) _ savaient mettre les gens en confiance et avaient tous les deux _ par leur charme puissant _ le don de susciter les confidences les plus intimes« ;
…
sur la puissance du « charme« de Paulette (et de Monny), ceci, page 165, à propos des circonstances de la « rencontre« de Claude avec Judith Magre, en 1946 :
…
« Une âme bien née _ on notera l’expression _, si elle avait la chance de croiser un jour Monny et Paulette, ne pouvait pas ne pas être ensorcelée _ rien moins ! _ et tomber immédiatement sous leur charme. Le foudroiement _ autre terme capital ! _en vérité fut réciproque ; ils se connurent par hasard au café de Flore _ Café de la Coupole, Café de Flore, Café Royal : une histoire de la « grande sociabilité« parisienne est aussi une histoire des cafés ! cf en partie là-dessus le très intéressant « Cafés de la mémoire » de la très remarquable Chantal Thomas… _ ; et s’enchantèrent _ oui : le chant des Muses est de la partie ! accompagnant le malicieux (et cruel aussi : d’une main, il donne ; de l’autre, armée de son rasoir, il tranche !) Kairos ! _ tant les uns des autres et les autres de l’une qu’après plusieurs heures de conversation Judith revint avec eux dîner rue Alexandre-Cabanel. Je me trouvais là, je fus présenté, couvert comme à l’accoutumée de lauriers _ d’Apollon _ et d’éloges, tandis que j’étais à mon tour et d’emblée foudroyé par cette merveilleuse liane de vingt ans, au corps mince et dur, à la voix profonde et riche de toutes les inflexions, par ce visage aux pommettes hautes, ce regard de feu, cette bouche rouge et sensuelle sous un nez puissant. elle ne s’appelait alors ni Judith, ni Magre : obéissant à un appel intérieur impérieux, elle avait fui sans un sou la province _ la Haute-Marne _ et ses parents industriels _ les Dupuis _, s’était inscrite au cours Simon où elle apprenait à devevenir la très grande actrice que l’on sait. Nous nous étreignîmes dans l’ascenseur » ; etc… « Nous vécûmes pendant près de six mois une passion torrentielle« , mais cela c’est une autre histoire que celle du « charme« si puissant de Pauline-Paulette Grobermann-Lanzmann-de Boully : page 165 ;
…
ce « charme« -là de sa mère _ enfuie du cercle familial des Lanzmann quand Claude n’avait pas encore neuf ans, « cela se passait en 1934« (page 81), Claude n’y accéda « vraiment« que « le jour _ « c’était une aube du printemps 1942« , page 77 _ où Monny tapota à la porte de la cour brivadoise« _ = de Brioude _, « cela faisait huit ans que nous ne vivions plus avec notre mère et plus de trois ans que nous ne l’avions pas revue_ les quelques lettres que nous avions échangées ne disaient rien d’important. Elle s’était estompée de ma mémoire, était devenue lointaine ; elle ne me manquait pas ; et s’il m’arrivait de penser à elle ou de l’imaginer, ce n’était pas sous la figure de la caresse et du gazouillis tendre que je l’évoquais, mais au contraire par tout ce qui, dans son être, démentait les représentations ordinaires de l’amour maternel, par tout ce qui, en elle et par elle avait fait honte à l’enfant conformiste que j’étais. Son bégaiement terrible, inexpugnable ; son énorme nez (…) que je percevais d’abord comme emblématiquement, spectaculairement juif ; ses colères qui faisaient rouler dans leurs orbites ses beaux grands yeux, mais qui étaient seules capables de dompter son bégaiement _ la fulmination chez elle désentravait la parole _ ; sa radicale absence de pitié (…).
…
Et soudain, en pleine guerre, au cœur des pires dangers, cette mère des hontes et des craintes se présentifiait _ voilà ! _ à moi tout autre, par l’amour _ sa puissance est extraordinaire _ que lui vouait un extraordinaire magicien _ Monny de Boully. Elle m’apparaissait _ pour la première fois, via le « magicien« amoureux et poète, Monny _comme une inconnue mystérieuse, auprès de laquelle, pendant les neuf années où elle s’évertua à la maternité, je serais passé sans la voir _ comme c’est la norme de ceux qui ne sont ni amoureux, ni devins, ni poètes : cf l’électrisant « Ion » de Platon… _, sans pressentir sa richesse, sans comprendre _ en ressentant « vraiment » : l’« expérience » de la sensation étant un sas absolument crucial et fondamental pour toute personne « vraiment« « humaine« … : d’où la « plaque tournante« capitale (et tellement sacrifiée, aujourd’hui !) de toute « éducation« de l’aesthesis !.. ; cf là-dessus « Le Partage du sensible« de Jacques Rancière… _ qui elle était vraiment« , pages 81-82…
…
« Contrairement à moi, mon père et Monny partageaient le même savoir : l’un aimait Paulette, l’autre l’avait aimée ; il l’aimait peut-être encore ; il ne cessa jamais tout à fait de l’aimer. Monny se montra éblouissant pendant toute la semaine qu’il passa à Brioude, logé dans la chambre _ à donner ou louer _ de M. Legendre. Mon père était subjugué par lui autant que moi-même. Il comprit que Monny apportait à ma mère tout un univers _ voilà : de culture, de poésie, de pensée ; et un « génie » aussi, pour s’y mouvoir avec brio !.. _ qu’il n’avait pas eu, lui, les moyens _ proprement poïétiques _ de lui donner« ;
…
aussi « quelque chose d’incroyablement fraternel, dû peut-être _ certes _ aux circonstances _ de la guerre et de l’Occupation (et de la « chasse aux Juifs« ) _ se noua(-t-il alors, dit Claude Lanzmann aux pages 82-83) entre nous trois (mon frère Jacques travaillait depuis peu comme valet de ferme chez des paysans) : Monny ne contait pas seulement la Gestapo, mais les jours et les nuits passés par ma mère dans un placard ; les déménagements, les fuites, l’entraide, les héros, les trahisons. Il incarnait Paris, la grande ville, la culture, la poésie et la pensée dans cette sous-préfecture endormie et alarmée tout à la fois« de Brioude
…
Brioude où Armand Lanzmann venait, lui (avec les siens), chercher, avec la santé (le bon air de Haute-Auvergne :
« mon père adorait cette région où ses poumons avaient été soignés à la fin du premier conflit mondial : engagé volontaire à l’âge de dix-sept ans, tandis que son propre père combattait en première ligne depuis août 1914, il avait été gazé à l’ypérite sur la Somme« , page 34), de la tranquillité (« nous quittâmes Paris, dès octobre 39, après la déclaration de guerre, pour regagner Brioude« , toujours page 34) ;
…
de même, je le remarque au passage, que les parents d’Armand Lanzmann, Itzhak (qui « avait changé son nom barbare en celui, plus policé et complètement gratuit, de Léon« , page 96) et Anna Lanzmann (« aux cheveux de bon pain« , tous deux, pour Claude _ l’expression se trouve page 103 _ pour lesquels « les diastases de l’assimilation étaient à l’œuvre« , cette expression se trouve, elle, à la page 92), étaient venus chercher en Normandie, à Groutel, aux environs d’Alençon, semblable paix :
…
« mon aïeul de Wilejka _ shtetl où il « avait vu le jour en 1874« : « shtetl à l’orthographe incertaine et changeante, aux environs de Minsk, en Biélorussie« (page 97) ; et devenu « M. Léon », de même que « ma grand-mère Anna (…) _ née Ratut, à Riga _était connue comme Mme Léon« (page 97), donc _ ;
…
mon aïeul de Wilejka, mû peut-être par une étrange prescience, avait coupé tout lien avec le monde juif et ses anciennes connaissances. Sauf un Joseph Katz, camarade de guerre et de la même origine biélorusse que lui, dont j’adorais l’accent et le visage, qui parut deux ou trois fois à Groutel, il
…
_ le bon « M. Léon« , donc : Claude l’adorait ! « Je l’ai connu longtemps et aimé aussi longtemps que je l’ai connu. Il ressemblait trait pour trait à Charlie Chaplin ; nous faisait rire, enfants, par toutes sortes de mimiques et grimaces empruntées à coup sûr à son illustre modèle. Mes rires étaient inextinguibles, et je ne pouvais les étouffer qu’en enfouissant mon visage dans les cheveux de mon aïeul, dont l’odeur de pain frais imprègne encore mes narines« , page 96 _
…
il ne vit, une fois installé là-bas, aucun Parisien, ses enfants et petits enfants exceptés. Lorsque Anna et lui voulaient se cacher de nous, ils se parlaient en une langue incompréhensible, rauque et gutturale avec des douceurs,langue du secret, de la honte peut-être. C’était le yiddish. Des énormes familles de douze ou treize enfants dont ils provenaient, nous ne connûmes jamais aucun membre, sinon une fois, à Paris, un rouquin anglais, boxeur professionnel de son état, qui me fut présenté comme le cousin Harry. Beaucoup ont dû périr dans la Shoah, mais pas tous. L’assimilation est aussi une destruction, un triomphe de l’oubli« , commente alors ce « trait« familial des Lanzmann, Claude, page 105.
…
Et pour ma part, je regrette un peu que Claude Lanzmann n’ait pas consacré un « tombeau« , en une page de ce « Lièvre de Patagonie« , à ses grands-parents maternels Lanzmann,
retirés depuis leur retraite (de leur commerce de mobilier ancien auprès de l’hôtel des ventes de la rue Drouot), en 1934, à Groutel (« hameau primitif d’une dizaine de fermes entre Le Mans et Alençon« , page 92 _ Groutel se trouve dans la Sarthe, mais tout près d’Alençon),
…
non plus, d’ailleurs qu’à son père Armand et à sa seconde « Manou« ,« la belle Hélène« _ une normande (de Caen), elle aussi _
…
un « tombeau« , tel que celui de la page 83, à sa mère, Monny et Evelyne…
…
Peut-être parce que ses rapports, avec ces Lanzmann-là, furent moins agités (remords compris), plus paisibles…
…
Pour conclure cette incise sur le « charme« puissant de Paulette (et de Monny ; formant un couple fusionnel : « il était ses yeux, ses mains, ses oreilles, son cœur, sa chair, son esprit ; il était elle. Jamais pareille fusion n’exista, j’en témoigne« , page 81),
voici, donc, cette superbe conclusion, page 83, du chapitre IV du « Lièvre de Patagonie« , en forme de « tombeau« (avec « stèle » gravée d’une inscription) :
…
« J’ai fait graver sans peur ce défi immortel sur la stèle qui surplombe la tombe de ma mère, au cimetière du Montparnasse.
…
Ils _ Monny et elle _ y sont enterrés côte à côte, auprès de ma sœur _ Évelyne Rey-Lanzmann _, qui disparut la première en se donnant la mort à l’âge de trente-six ans, le 18 novembre 1966. Deux ans plus tard, Monny fut terrassé par une crise cardiaque en traversant, au bras de ma mère, l’avenue des Champs-Élysées
…
_ Paulette, elle, a vécu jusqu’à l’âge de quatre-vingt-douze ans, en 1995 ; Claude cite, page 78, ce mot de condoléances reçu de Marthe Robert :
« Mon cher Claude, j’apprends la mort de Paulette par « Le Monde » d’aujourd’hui. Vous savez que je l’ai bien connue. A une certaine époque, j’allai très souvent la voir ; et je me plaisais beaucoup en sa compagnie. Surtout j’admirais sa beauté ; elle me semblait incarner toute la noblesse des antiques filles d’Israël« « …
…
Sur la même stèle, on peut donc lire aussi quatre vers d’un de ses poèmes _ il s’agit de Monny, « le Rimbaud serbe« … _, déchirant poème sur la mort et le néant impensables, impensable pensée :
…
« Passé, présent, avenir, où êtes-vous passés
Ici n’est nulle part
Là-haut jeter le harpon
Là-haut parmi les astres monotones« …
…
Fin de l’incise sur Pauline-Paulette, la mère de Claude, et son talent à susciter la « confiance » des « confidences » ;
place, maintenant, au « talent d’écoute« et « dialogue » d’Évelyne…
…
Évelyne : cf page 185 : « elle était curieuse de tout ; instaurait avec les gens un rapport de confiance ; savait les faire parler et révéler d’eux-mêmes le plus essentiel« …
…
La remarque ci-dessus s’applique plus particulièrement à un « travail« de reportage et d’« interviews« filmé, qu’à un moment difficile de sa carrière de comédienne au théâtre et à la télévision elle avait entrepris, pour une émission d’Éliane Victor, à la télévision, quatre mois avant sa mort.
…
Déjà, en 1960 : « La politique eut, en 1960, de dures conséquences sur la carrière et la vie de ma sœur : elle signa avec nous tous _ et contre mon avis car je prévoyais ce qui arriverait _ le Manifeste des 121, appelant les conscrits à refuser de servir en Algérie ; et les représailles ne tardèrent pas. Elle travaillait alors beaucoup _ comme comédienne_ à la télévision, télévision d’État, qui la sanctionna immédiatement en annulant tous ses engagements et en lui fermant ses portes pour plusieurs années. Elle avait trente ans » (page 180).
…
Et « en septembre 1965, pour la reprise des « Séquestrés«
_ « d’Altona« : pièce que Sartre avait écrite pour elle ! « Toutes les pièces de Sartre, on le sait, furent écrites pour des femmes ; et comme le dit joliment Cau, dans « Croquis de mémoire« : « Plutôt que d’offrir des fleurs, il leur offrait des pièces. » Mais « Les Séquestrés » furent la seule et unique pièce qu’il conçut pour Évelyne, avec laquelle il n’avait plus de relation amoureuse depuis plusieurs années« , pages 179-180.. _,
elle eut une crise de trac terrible : « elle tremblait de tout son corps ; tremblement qui culmina et explosa soudain en sanglots convulsifs, en hurlements coupés d’une longue plainte déchirante couvrant le bruit de la salle. (…) L’annonce d’un incident technique fut faite« . Mais « elle se reprit tout à coup, incompréhensiblement ; sécha ses yeux ; fut repoudrée et entra en scène. Elle joua très bien, la voix sèche et comme sans émotion ; je ne l’avais pas vue, dans les « Séquestrés« aussi bonne« , page 182.
…
Mais « cette crise terrifiante était annonciatrice d’une défaite existentielle dont elle tira sans faillir les conséquences _ soit la renonciation à se produire sur scène au théâtre ! Elle tomba malade aussitôt la fin des représentations« , page 183.
…
Alors « elle ne voulait plus entendre parler de théâtre, mais pensa _ nous le pensions tous _ qu’elle serait très capable de réaliser des films, et, d’abord, des reportages pour la télévision.
Elle était curieuse de tout ; instaurait avec les gens un rapport de confiance ; savait les faire parler et révéler d’eux-mêmes le plus essentiel.
Éliane Victor, qui dirigeait alors une célèbre émission de télévision, « Les Femmes aussi », et qui l’aimait beaucoup, lui confia la réalisation d’un film sur les femmes tunisiennes.
Elle partit en août, puis en septembre faire là-bas des repérages ; en octobre pour le tournage proprement dit ; et elle commença le montage de l’émission dès son retour.
Avec Beya, une des femmes tunisiennes qu’elle avait choisie comme héroÏne de son film, elle noua une relation de tendresse bouleversante et fut littéralement adoptée par toute une famille.
Elle avait le sentiment d’avoir découvert quelque chose de central, qui ne serait pas fugitif « , page 185…
Mais le 18 novembre 1966, elle se suicidait…
…
« »Beya ou ces femmes de Tunisie« , l’émission de télévision à laquelle Évelyne avec raison tenait tant, fut diffusée deux ans après son suicide, le 3 janvier 1968 ; elledurait cinquante minutes ; et fut unanimement saluée comme un comble d’intelligence et d’humanité. C’est Robert Morris qui tenait la caméra. Ma sœur, très belle, très jeune, svelte, la chevelure nattée, est à l’image en compagnie de Beya au tendre visage, pendant presque toute la durée du film« , page 189…
…
« confiance« et « confidence« : peut-être une qualité idiosyncrasique, donc, de quelques uns des Lanzmann-Grobermann,
telles Pauline-Paulette, la mère de Claude,
et Évelyne, sa sœur,
qui a « précédé« en quelque sorte Claude sur les « chemins » du « reportage« et de l’« entretien« cinématographiques… ;
…
auxquelles j’associerai, aussi, le très remarquable « don » pour l’« écoute » de Simone de Beauvoir :
…
ainsi, page 270, « sa façon unique et toujours pour moi bouleversante d’écouter, sérieuse, grave, ouverte, totalement confiante« ;
je cite tout le passage : « Pendant les douze années très difficiles _ de 1973-74 à 1984-85 _ qu’a duré la réalisation de « Shoah« , je venais vers elle chaque fois que je le pouvais ; j’avais besoin de lui parler ; de lui dire mes certitudes, mes doutes, mes angoisses, mes découragements. Je sortais toujours des soirées que nous passions ensemble, sinon rasséréné, du moins fortifié. Cela ne tenait pas tant à ce qu’elle savait et que nous pouvions partager _ comment eût-elle pu connaître toutes les horreurs que je découvrais ? C’est moi qui les lui apprenais _ qu’à sa façon unique et toujours pour moi bouleversante d’écouter, sérieuse, grave, ouverte, totalement confiante. L’écoute la transfigurait _ rien moins ! _, son visage se faisait humanité pure ; comme si sa capacité à se concentrer sur les problèmes de l’autre la délivrait de son souci, de sa propre angoisse et de la fatigue de vivre qui ne la quitta plus après la mort de Sartre » _ qui eut lieu le 15 avril 1980 ; Simone, elle, s’est éteinte le 14 avril 1986
…
(cf à la page 544 : « A l’aéroport international de Los Angeles, ceux qui m’accueillaient _ pour la remise de « la Torch of Liberty Award », « prévue et organisée depuis des mois » et « dont la date ne pouvait être changée » ; tandis que « les médecins m’avaient dit : « Elle sera encore là à votre retour »… _ avaient une mine consternée , un télégramme venait d’arriver, annonçant le décès du Castor« ; le lendemain, après « une nuit blanche, incapable de dormir« , je « repris l’avion, arrivai à Paris à l’aube pour prendre en mains aussitôt, comme je l’avais fait pour Sartre, l’organisation des obsèques du Castor. Elle ne se trouvait plus dans l’unité de soins intensifs, mais à la morgue de l’Hôpital Cochin« …).
…
mais aussi, page 251, à propos, cette fois, de la façon de s’écouter et d’échanger entre eux (ainsi que chacun d’eux avec un autre), de Simone et de Sartre, et de ce qu’eux-mêmes qualifiaient du principe pratique (duel ; et pas pluriel) : « chacun sa réception« :
…
« Nous étions tous les trois _ du temps de la « vie commune » de Simone et de Claude, de 1952 à 1959 ; et du « partage« de pas mal de moments avec Sartre _ très faciles à vivre. Elle comme lui _ et c’est aussi depuis longtemps ma conviction _ pensaient qu’on ne discute bien qu’avec ceux avec lesquels on est d’accord sur le fond. C’est pourquoi ils détestaient les mondanités et les grandes tablées françaises, privilégiant _ nous y voici _ la relation duelle… Être deux, se parler deux à deux était selon eux _ selon moi aussi, ils m’ont appris cela _ la seule façon de se comprendre, de s’entendre _ en commençant par « vraiment« s’écouter ! _, d’avancer, de réfléchir. La formule de cette relation était : « Chacun sa réception »« , pages 250-251. Je ne reprends pas le récit, déjà donné dans un de mes articles d’introduction (le tout premier, et vers la fin de l’article : « La joie sauvage de l’incarnation : l’”être vrais ensemble” de Claude Lanzmann _ présentation I« ) à ce « Lièvre de Patagonie« , de l’« application« quasi comique de cette « réception« séparée, lors des déjeuners au restaurant, lors d’un séjour de vacances d’« avant-printemps« à Saint-Tropez, en 1953..
…
Cependant, Simone était aussi sujette à des crises d’angoisse (« il s’agissait toujours d’une prise de conscience suraiguë, intolérable, de la fragilité du bonheur humain, du destin mortel de ce que les mortels appellent précisément « le bonheur », dont la nature est d’être toujours compromis. La seule pensée de la mort de Sartre, qu’il mourrait avant elle, ou encore qu’il y aurait une fin à notre relation d’amour, ce dont elle s’était pourtant dite certaine dès son début _ Claude et elle avaient dix-sept ans d’écart _, pouvait déclencher la plus violente crise« , page 278). Par exemple ainsi, toujours page 278 : « elle était habitée par la croyance compulsive que la narration des faits, ceux d’une journée, d’un dîner, d’une semaine, était toujours, à tout moment possible _ sans nulle « incompossibilité« , en quelque sorte. Il convenait de tout se dire, de tout se raconter _ selon quelles « focalisations » ?.. _, tout de suite, dans une précipitation haletante ; comme si se taire ou vouloir parler à son heure renvoyait au néant ce qui ne lui était pas rapporté sur-le-champ.
…
Il s’agissait véritablement d’un « rapport » inaugural _ à l’entame de toute retrouvaille _ et quasi militaire « d’activité » ; sa volonté de tout savoir ; ou sa crainte d’oublier ce qui restait à passer en revue interdisant _ aussi _ qu’on s’attardât sur tel ou tel événement saillant. Elle était si pressée _ sus et malheur aux tempi lents et aux « ralentendi » !.. _ d’aller au point suivant qu’à la lettre _ et c’est fâcheux ! _ elle n’entendait pas ce qu’on lui disait alors ; ou mélangeait tout _ jusqu’à des conséquences tragiques (telle, peut-être, celles, en 1990 _ « quatre ans à peine après la mort de Simone de Beauvoir« , quand « furent publiées en totalité par sa fille adoptive« « les lettres de celle-ci _ Simone _ à Sartre« et « sans masquer« le « nom de gens encore vivants« … _, du suicide de Josie Fanon ; cf aux pages 365-367…). Les relations, orales ou épistolaires, qu’elle faisait plus tard, à Sartre par exemple _ car comme dans le miroitement tropézien que j’ai évoqué _ dans l’épisode quasi comique des deux cafés contigus sur le port, et des « réceptions séparées« !.. _, le récit premier devenait toujours récit du récit du récit… _, témoignent de cette confusion, symptôme névrotique par excellence.
…
C’est plus tard, après notre séparation _ en 1959 _, quand la voyant deux soirées par semaine, je venais la chercher pour l’emmener au restaurant, que sa hâte avide dès les retrouvailles me fut souvent insupportable, parce que ayant des choses importantes ou difficiles à formuler, j’avais besoin d’installer entre nous mon propre temps _ absolument ! et musicalement… _ afin de pouvoir _ « vraiment »… _ lui parler _ = se faire « vraiment » entendre d’elle… _, ce à quoi je tenais plus que tout. Les scènes _ entre Simone et Claude _ naissaient toujours au début des rencontres _ par la faute de tempipas encore accordés _ ; j’étais incapable de l’exposé à la course et à froid qu’elle attendait ; je le lui disais ; elle se fermait, prenait son visage offensé et sa moue boudeuse ; seul le vin appariait nos temporalités _ la formule est assez délicieuse ! et le phénomène est parfaitement musical ! _ ; nous pouvions alors passer de longues heures heureuses, où, son angoisse dissipée, la merveilleuse capacité d’écoute _ la revoilà ! _ dont j’ai parlé se donnait libre carrière« , pages 277 à 279…
…
Fin, ici, de l’incise sur la capacité
_ de Pauline, d’Évelyne et de Simone (sans aller jusqu’à celle aussi, non négligeables, non plus, de Juliette Simont et de Sarah Streliski, auxquelles le « travail« de ce « récit de vie« de ce « Lièvre de Patagonie« a été « confié« , davantage que simplement donné à « transcrire« , à la frappe « à bon rythme« (sans « tuer l’élan« , page 14), sur le clavier d’un ordinateur; ou à celle de Dominique (page 14 aussi) _
d’écouter et converser pleinement !.. _
…
celui « écoutant » ainsi
suscitant, très sûrement, « l’élan » de « confiance« , enfin, de la « confidence«
de pareil « témoignage »
…
(cf sur cette situation, l’ami Montaigne, en son sublime essai d’ouverture du livre III des « Essais » : « De l’utile et de l’honnête« : « Un parler ouvert ouvre un autre parler et le tire hors, comme fait le vin _ le revoilà _ et l’amour« … ;
et pour une lecture experte et magnifique de cet essai majeur de notre immense bordelais , se reporter à l’indispensable « Montaigne _ Des règles pour l’esprit » de l’ami Bernard Sève)
…
je veux dire, dans le cas du « travail« ,
de longue haleine et de patience, autant que de tenace et implacable, sans faillir,détermination
de Claude Lanzmann,
…
la « vérité » du « témoignage«
comme « loi » et « mandat » de l’œuvre
…
le « placement » « dans l’imminence de la fulguration » de la « vérité » du « témoignage« ,
donc,
tel est le sujet de ma proposition principale,
autorise et permet, très effectivement, à l’auteur de l’œuvre, la « survenue« ,
ô combien peu probable, certes, au départ ; et, par là même, quasi « miraculeuse«
…
_ en tout cas pas « sur commande« !.. ; c’est bien plus complexe ; et surtout « innocent » !.. :
une « grâce » donnée ; et qu’il faut apprendre à, et délicatement, en s’en rendant presque « prêt » a priori, « recevoir« , « accueillir« ; presque « réceptionner« , au cas par cas, et en hôte bien humblement reconnaissant… _,
…
la « survenue » bondissante de cette « joie sauvage » de l’ »incarnation » réussie,
…
en tant que cette « incarnation » est bien _ et enfin ! après avoir été « entrevue« ,« désirée« , « espérée« … ; elle s’« annonçait« un peu déjà, en quelque sorte… _ ; et même bel et bien,
un « être vrais ensemble » :
…
l’ »être vrais ensemble«
de la rencontre « vraie » de certaines personnes, chaque fois singulières ;
…
de la rencontre « vraie » de certains lieux, chaque fois singuliers ;
…
la rencontre « vraie » de certains animaux, tels quelques lièvres, eux aussi assez particuliers :
…
des lièvres de Serbie
…
_ « dans les grandes forêts de Serbie« , selon l’expression de la toute dernière page, la page 546 ;
ou, d’abord : « nous nous dirigeons _ au présent _ vers le nord de la Yougoslavie« , à la page 256 _,
à moins que ce ne soit « les grandes forêts » de Bosnie, ou de Croatie, voire de Slovénie ; en l’ex-Yougoslavie, en tout cas :
…
cf l’indication, donnée deux pages auparavant (à la page 254), de l’itinéraire de « nos premières vacances d’été »
_ celles de Claude (Lanzmann) et de Simone (de Beauvoir) depuis qu’ils avaient entamé leurs sept ans (« nous vécûmes ensemble conjugalement, pendant sept ans, de 1952 à 1959« ) de « véritable vie commune« , page 250 _
brossé, cet itinéraire de vacances, à grands traits :
…
« nous avions prévu un voyage compliqué : les montagnes suisses d’abord, pour que je reprenne force et santé
_ après un stupide accident de ski (« je me laisse emporter sur le verglas ; je dévale à toute vitesse, sans savoir ni pouvoir tourner ; et c’est un sapin heurté de plein fouet qui arrête ma course en m’ouvrant le front. Je saigne considérablement« , page 253) aux précédentes (et premières, ensemble, Simone et Claude) vacances d’hiver, « deux semaines en décembre-janvier, au moment du plus grand froid, à la Petite Scheidegg (Kleine Scheidegg), un col battu des vents de l’Oberland bernois, à 2061 mètres d’altitude, au pied de la Jungfrau, vue sur les terribles faces nord
…
_ tiens : les voilà déjà ! cf l’expression de la page 429, à propos de « l’aventure« proposée de « Shoah« (« avec une gravité et une solennité que je ne lui connaissais pas« , par son « ami Alouf Hareven, directeur de département au ministère des Affaires étrangères israélien », la « conversation dut avoir lieu au début de l’année 1973« :
…
« Il ne s’agit pas de réaliser un film sur la Shoah, mais un film qui soit la Shoah. Nous pensons que toi seul es capable de le faire. Réfléchis. Nous connaissons toutes les difficultés _ certes ! _ que tu as rencontrées pour mener à bien « Pourquoi Israël « . Si tu acceptes, nous t’aiderons autant que nous le pourrons« …) :
…
« je me sentais au pied d’une terrifiante face nord, inexplorée, dont le sommet demeurait invisible, enténébré de nuages opaques« !! _
…
à la Petite Scheidegg, donc,
au pied de la Jungfrau, vue sur les terribles faces nord de l’Eiger et du Mönch« .
…
Fin de l’incise sur l’accident de ski bernois et le « défi« des « terribles faces nord« d’une vie non dépourvue de dangers affrontés, plus ou moins volens nolens, à l’unité, de divers ordres : « même si la Shoah est centrale dans « Pourquoi Israël« , je n’avais jamais envisagé de m’attaquer frontalement à pareil sujet« , toujours page 429…
…
Et retour à l’itinéraire « yougoslave« de l’été 1953
et la « rencontre« de Claude avec les tous premiers de ses lièvres (sauvages)« bondissants« … _
…
« nous avions prévu un voyage compliqué, les montagnes suisses d’abord, pour que je reprenne force et santé, donc,
…
une brève escale à Milan chez Hélène de Beauvoir, dite Poupette, la sœur du Castor, mariée à un attaché culturel, Lionel du Roulet, dont chacune des paroles était fardée d’une conscience seconde et légèrement pompeuse.
…
L’aventure se poursuivrait _ nous y voilà ! _ par Trieste, la Croatie, la côte dalmate, jusqu’à Dubrovnik, remontée par Sarajevo, toute la grande pleine serbe _ ou plutôt croate ? celle de la Slavonie, entre Vukovar et Ossijek et Zagreb ?.. _, Ljubljana, entrée en Italie à Tarvisio, Suisse derechef ; tout dépendrait du temps, le temps qu’il ferait et celui qui nous resterait. C’est moi qui conduisait la Simca Aronde… » pages 254-255. Fin de l’incise serbo-yougoslave ! Et retour aux autres lièvres bondissants (ou se glissant sous des barbelés) du livre… _
…
l’ »être vrais ensemble«
de la rencontre « vraie » de certains animaux, tels quelques lièvres :
…
des lièvres de Serbie, donc,
…
_ « nous nous dirigeons _ donc _ vers le nord de la Yougoslavie. Je conduis. Dans le faisceau des phares, de grands lièvres bondissent _ le récit est toujours au présent ! et nous, lecteurs, les voyons « bondir« , à notre tour, autour de notre faisceau de lecture… _ des deux rives de la route. Ils me semblent pulluler ; je ne veux pas les heurter ; je roule doucement, je slalome dangereusement pour les épargner. Je n’en tue que trois, et c’est un exploit. (…) J’aime les lièvres ; je les respecte ; ce sont des animaux nobles ; et j’ai appris par cœur le long conte pour enfants de Silvina Ocampo, la poétesse argentine, intitulé « La Liebre dorada« , « Le Lièvre doré« , qui vient en exergue de ce livre. »
…
Avec encore cette annotation, en suivant immédiatement :
« S’il y a une vérité de la métempsycose
…
_ est-ce la poésie et le fantastique que pratiquaient allègrement, à Buenos Aires, Silvina Ocampo (d’elle _ 1903-1993 _, sont présentement disponibles en français : « Faits divers de la terre et du ciel« ; et, avec Bioy « Ceux qui aiment haïssent« ), Adolfo Bioy (cf, de lui _ 1914-1999 _ « L’Invention de Morel« , « Le Journal de l’année du cochon » ou « Le Songe des héros« ) et Borges (de lui _ 1899-1986 _ avec Bioy, à deux donc, notamment « Les Chroniques de Bustos Domecq« ), qui ont pu, en quelque façon, donner un peu de cette inspiration, ici, à Claude Lanzmann ? A quelle occasion Claude Lanzmann rencontra-t-il donc « La Liebre dorada » de Silvina ?.. Je n’ai pas pensé lui poser la question… _
…
« S’il y a une vérité de la métempsycose
…
et si on me donnait le choix,
c’est, sans hésitation aucune, en lièvre _ « bondissant » !.. _ que je voudrais revivre« , poursuit-il sa rêverie à propos des lièvres, page 256 ;
…
avec encore ceci, onze lignes plus loin, et en forme de conclusion, page 257 : « A Auschwitz-Birkenau, on ne tue plus, même les animaux : toute chasse _ dont celle à des « hommes« ! _ est interdite. Nul ne tient le compte des lièvres. La seule chose sûre est qu’ils sont très nombreux _ l’espèce est bien connue pour sa prolificité…: elle est vivace ! _ ; et il me plaît de penser que beaucoup des miens _ qu’on avait voulu là « annihiler« , de mai 1940 au 27 janvier 1945 ; et avec leur progéniture _ ont choisi _ sic _, comme je le ferais _ re-sic _, de se réincarner _ et survivre ainsi et comme espèce et comme individus _ en eux« …
…
l’ »être vrais ensemble«
de
la rencontre « vraie » de certains animaux, tels quelques lièvres, je poursuis l’élan de ma phrase :
…
des populations « bondissantes« , donc, de lièvres « de Serbie« ,
…
mais aussi un lièvre « intelligent » de Silésie-Pologne
_ celui « au pelage couleur de terre« filmé à Auschwitz-Birkenau, « arrêté par un rang de barbelés du camp d’extermination de Birkenau » et présent, pour qui y fait assez attention, sur les images de « Shoah » : « deux plans rapides mais centraux pour moi« , indique Claude Lanzmann à la page 256 :
…
« on ne perçoit _ soi, spectateur subjectif :
la perception a toujours de fort complexes (et parfois même, sinon toujours, labyrinthiques) conditions : d’attention, de « focalisation« , de mémoire, de vocabulaire, de culture : de liaisons mentales (ou d’images mentales) à foisons, ou pas, maigrelettes et raréfiées ; de connexions cérébrales plus ou moins riches et plus moins rapides ; une phantasia en permanence en action, ou, a contrario, inhibée, ralentie, formatée, figée : endormie, anesthésiée, paralysée ; ou même carrément annihilée et détruite, aussi… ; ce que j’ai pu qualifier, en un article, à propos du très beau et majeur ! « Homo spectator » de Marie-José Mondzain, de « faculté d’imageance« … _
…
on ne perçoit ce que la caméra montre pourtant clairement _ objectivement, cette fois : sur la pellicule impressionnée _ qu’après un temps infinitésimal
_ un concept leibnizien, cet « infinitésimal« , lié (en leur « amont » : il les « conditionne« …) aux importantes (au quotidien !) « petites perceptions » d’où sourdra la perception consciente, évidente et massive, elle… ; cf les « Nouveaux Essais sur l’entendement humain« , par exemple ; ou « la Monadologie« , de Leibniz _
de latence _ l’œil de l’esprit ayant dû procéder à une opération de« focalisation » impromptue : s’attendait-il à « découvrir » parmi les barbelés d’Auschwitz un lièvre ? _ :
…
un lièvre au pelage couleur de terre est arrêté par un rang de barbelés du camp d’extermination de Birkenau«
pendant qu’on entend, défilant sur la bande son, la voix off du slovaque Rudolf Vrba :« une voix off
_ un des facteurs cruciaux de l’idiosyncrasie d’ »auteur de cinéma« de Claude Lanzmann : dans tout l’œuvre cinématographique de Claude Lanzmann, jamais une voix off n’intervient pour « commenter« , en surplomb, l’image ; et en « imposer une signification« qui soit fermée, totalisante (ou totalitaire), figée… ; c’est à un spectateur actif, d’esprit alerte et vif, d’opérer ses propres « connexions » attentives, vives, si possible « sagaces« ;
…
en relation avec ce que Claude Lanzmann appelle, page 509, « la construction du film«
« qui« seule, « étant donné le parti que j’avais pris d’une absence totale de commentaire« , pour « Shoah« , « est la clé et le moteur de son intelligibilité, qui permet au récit
…
_ non univoque, à plusieurs voix (« les hérauts (« du peuple tout entier« ), oublieux d’eux-mêmes, suprêmement conscients de ce que le devoir de transmission, requérait d’eux, s’exprimeraient naturellement au nom de tous« , se dit, page 442, l’auteur et maître d’œuvre de « Shoah » très tôt, en l’élaboration complexe, d’abord « opaque« , de ce « film immaîtrisable« , page 441),
polychoral, du film : comme toutes les œuvres vraiment majeures, désormais, depuis l’« Ulysse« de Joyce et « Le Bruit et la fureur« de Faulkner _
…
qui permet au récit, donc,
d’avancer et d’être compréhensible pour le spectateur _ tant soit peu attentif et « mobilisé« : en éveil, et pas endormi ; véritablement vigilant…
…
Il n’y a _ dans « Shoah« , ni en aucun des films de Claude Lanzmann _ aucune voix off pour indiquer ce qui va arriver, pour dire quoi penser, pour relier de l’extérieur les scènes entre elles. Ces facilités propres à ce qu’on appelle classiquement un documentaire ne sont pas autorisées dans « Shoah« , page 509… ;
…
la voix off « témoigne« seulement ;
ou bien « traduit« (d’une langue à une autre : et toutes les opérations de traduction ont été scrupuleusement conservées _ même les maladroites et contestables : par déontologie à l’égard des traducteurs (Barbara Janicka, Francine Kaufmann) et à l’égard de l’œuvre elle-même s’élaborant ainsi, peu à peu (cf par exemple, les significatives pages 500 à 502 : « même les meilleures, surtout les meilleures, cèdent à leurs craintes, à leurs émotions« : « elles gauchissent« et « édulcorent« ) _ au montage) ;
« accouche« aussi
…
(cf l’emploi du terme à la page 454 ; c’est à propos des difficultés du « témoignage« du « premier « revenant », Michael Podchlebnik« : avec lui, « le problème ne se posait pas ainsi«
…
_ = comme avec le mutique Simon Srebnik, pour lequel il fallut inventer un « commun langage : il me corrigeait, je le corrigeais. En un sens, j’en savais plus long que lui, car j’avais été partout _ à Chelmno _ en homme libre, tandis que lui marchait les chevilles entravées, souffrant de la faim, des coups, de l’humiliation, et de la peur de la mort à tout instant possible. Pourtant, le partage, la confrontation et l’échange, par le dessin, du savoir de chacun, furent une joie puissante et neuve : nous nous mîmes à parler ; je sus l’interroger ; il voulut raconter« , page 455 _ ;
…
avec Michael Podchlebnik, donc, « tout est dans son visage, son merveilleux visage de sourire et de larmes ; ce visage est le lieu même de la Shoah. Et chaque fois que je le revois sur l’écran, devinant ma main qui lui presse et lui masse l’épaule _ ainsi que Freud commença par procéder afin de faciliter l’expression de ses patients dans les tâtonnements de l’invention (magnifique !) de la psychanalyse _ pour l’aider à accoucher_ nous y voilà ! et c’est aussi la (magnifique encore !) méthode socratique ! cf les « dialogues » de Platon !.. _ le plus difficile des récits _ la découverte par lui de sa femme et de ses enfants parmi les cadavres à l’ouverture des portes de son premier camion à gaz _, instant où il passe soudain de son courageux sourire à de pudiques sanglots ; je ne peux que l’accompagner de mes propres pleurs. Héroïque et rigoureux Michael Podchlebnik, qui, dès sa première intervention dans le film, dit : « Il ne faut pas parler de cela » ; alors que Srebnik l’a précédé d’un « On ne peut pas se représenter cela ». Héroïque Podchlebnik qui ne raconte rien de sa fantastique évasion, car son histoire personnelle était selon lui sans importance. Rien non plus de la force et de la ruse qu’il sut mobiliser, des souffrances subies : il s’évada en effet dès le début de la première pétriode de l’extermination à Chelmno, et il lui fallut survivre en Pologne, sous les Allemands, pendant presque quatre années« , pages 454-455 ; sans autre commentaire de ma part… ;
…
mais aussi à la page 359 : « j’ai été véritablement un accoucheur« ; et c’était lors de son séjour ultra-clandestin à l’état-major de l’Armée de Libération Nationale de l’Algérie, au mois d’août 1961 :
…
« un chauffeur du FLN est venu me chercher à cinq heures du matin pour m’emmener de Tunis à Ghardimaou, à la frontière algérienne. C’est à Ghardimaou qu’était cantonné l’état-major de l’A.L.N. Le conducteur prenait un plaisir visible à me terrifier en roulant à toute allure sur des routes impossibles, pour m’épater, ou pour me tester, me tuer peut-être. Après quelques heures de voyage, nous arrivâmes enfin dans une grande cour de caserne ensoleillée où des hommes jeunes, vêtus en civil, déambulaient. Plusieurs m’ont aussitôt entouré, très aimables, parlant un très bon français« , page 357 ;
…
« J’ai passé environ une semaine à l’état-major
_ où se trouvaient, entre autres, le colonel Boumediene (« Je n’en revenais pas : le grand rouquin au transistor « en tournée d’inspection », c’était lui ; il n’avait pas jugé bon de se présenter, même si je l’avais vu le premier jour, puis midi et soir, à chaque repas, depuis mon retour de la montagne !« , page 360) ;
…
mais aussi « un jeune capitaine de l’ALN aux magnifiques yeux bleus, un de ceux qui m’avaient parlé le premier jour, m’a pris en charge ; il me racontait presque poétiquement son bouleversement et la beauté de l’aube à l’instant du premier coup de feu d’une embuscade dans le Sud algérien. Sachant que j’étais juif, il avait ajouté : « Après l’indépendance, nous devrons envoyer des missions en Israël » ; et comme je m’étonnais :« Oui, nous avons énormément à apprendre d’eux _ En quel domaine ? demandai-je. _ Oh, les kibboutzim, l’irrigation, l’afforestation, l’amélioration des sols ». Ce capitaine qui n’a pas cessé de me piloter pendant le reste de mon séjour s’appelait Abdelaziz Bouteflika. On sait qu’il est aujourd’hui président de la République algérienne« , page 359 _
…
« Tous venaient me parler avec une extrême franchise ; chacun me confiant des pensées intimes ou secrètes dont ils osaient à peine s’ouvrir à leurs camarades. J’ai été véritablement un accoucheur« …
…
Fin de l’incise sur le terme « accoucher« et le recueil des « confidences« auprès du bras armé du FLN…
Et retour aux fonctions de la voix off selon le cinéma de Claude Lanzmann…
…
la voix off _ donc, je reprends l’élan de ma phrase _
« témoigne« seulement, ou bien « traduit« , « accouche« aussi et surtout
dans le cas, pour quarante minutes (sur les 550 que dure le film « Shoah« ), de la voix de Claude Lanzmann lui-même :
…
« accouche« fraternellement les « revenants« (des chambres à gaz) ;
ou implacablement les « bourreaux« qui se vont se faire piéger par le dispositif de la « paluche«
…
_ « avec les bourreaux, il fallait apprendre à tromper les trompeurs ; c’était un devoir impérieux« , page 468 ;
…
et à l’avocat engagé pour se défendre au procès intenté par Heinz Schubert (« l’un des chefs des Einsatzgruppen », « condamné à mort gracié par McCloy, responsable de l’immense tuerie de Simferopol, en Crimée« , page 477 ; « les Schubert avaient appelé la police, lui avaient remis le sac et la paluche _ dont s’était débarrassé, dans la bagarre et la fuite, Claude Lanzmann, après la découverte par les Schubert du dispositif de piégeage _; pris un avocat ; et, sur les conseils de celui-ci, porté plainte« , page 483) ;
…
et à l’avocat engagé par Claude Lanzmann (« choisi au hasard dans un annuaire professionnel de Hambourg« , page 484) :
« je lui expliquai que je travaillais pour l’Histoire et la vérité ; que, moi-même Juif et réalisant un film sur l’extermination de mon peuple, je ne pouvais pas me passer du témoignage des nazis ; j’exposai combien j’avais été franc et honnête pendant des années ; et que seule leur lâcheté profonde m’avait contraint à utiliser à mon tour la tromperie et le subterfuge pour briser le mur épais de silence qui empoisonnait l’Allemagne « , page 484 ;
…
et de fait, lors de ce procès, « le procureur, un homme d’une droiture remarquable, me répondit que mes arguments l’avaient convaincu, et qu’il renonçait à me poursuivre. Plus encore, il m’annonça qu’après un laps de temps de quelques mois imposé par la loi, la paluche, le sac et les étoiles _ qui constituaient un camouflage _ me seraient restitués. Ce qui fut fait« , page 484 _ ;
…
ou encore, cette même voix off, « laisse parler« « torrentiellement« (en « une déferlante de paroles capitales », page 496) les « témoins« polonais des camps d’extermination : nul n’ayant jusqu’alors, ces années-là, pensé venir chercher, sur le « lieu du crime« (toujours page 496), à « vraiment » les « écouter« … _
…
une voix off _ donc _ parle sur cette première image _ du lièvre « au pelage marron« face aux barbelés du camp de Birkenau, en un lien (de pure concomitance) non surligné, souligné… _,
celle de Rudolf Vrba,
un des héros du film, héros sans pareil
puisqu’il réussit à s’évader de ce lieu maudit _ de Birkenau _, gorgé de cendres.
…
Mais le lièvre est intelligent ; et tandis que Vrba parle, on le voit affaisser son échine_ un geste crucial ; déjà emblématique… _, ployer ses hautes pattes
et se glisser sous les barbelés.
…
Lui aussi s’évade«
_ et va pouvoir continuer ses courses folles, ses gambades et cabrioles, dans les champs et la forêt ; ainsi que, comme tous ceux de son espèce (bien connue pour être prolifique), se reproduire _ ;
…
et de fait aujourd’hui « à Auschwitz-Birkenau (…) nul ne tient le compte
_ les comptabilités étant rarement, et cela depuis Galilée, Descartes, Adam Smith, et les autres, « innocentes« ;
…
cf la comptabilité exhaustive, elle, par « les statisticiens de l’Aktion Reinhardt« , des dépouilles prises sur les victimes juives « dans les trois camps de Treblinka, Belzec et Sobibor« , pages 497-498 :
…
« S’ils ne se sont pas souciés de tenir le compte exact du nombre de Juifs gazés là-bas » _ certains de ces chiffres, en effet, manquent… _, ces « statisticiens« -ci « ont par contre calculé au centime près les sommes _ en dollars, en drachmes, en florins, en francs, en devises de toutes sortes _ que les commandos, dont Suchomel avait la charge, trouvaient en décousant les manteaux, les vestes, les corsets des victimes, ou en faisant sauter les talons de leurs chaussures« _ même si « bien sûr une partie de cet argent échappait aux comptables du WVHA (Wirtschaftsverwaltunghauptamt, organisme administratif des affaires économiques de la SS) pour aller dans les poches des préposés à la mort, SS, Ukrainiens, Lettons ; ou bien encore être enfouie dans le sol par les membres juifs des sonderkommandos, afin de servir dans le cas improbable d’une évasion.
…
C’est cet argent que villageois et prostituées recevaient contre de la vodka, du porc ou du plaisir« .
…
Et « Henrik _ Gawkoswki, le magnifique « témoin« , chauffeur de la locomotive des convois de Treblinka _, dans les larmes, me confessa au cours de la nuit _ de sa première « confession« … _ avoir perdu au poker, jouant entre deux convois, 50 000 dollars, pactole alors fantastique. Il avait ajouté : « Bien mal acquis ne profite jamais ». Et « je le vis plus tard, quand je revins pour tourner, chanter de toute son âme et de toute la puissance de sa voix, dans la chorale de l’église » de Malkinia ;
…
cf aussi l’extraordinaire vénalité, congénitale peut-être, d’un Suchomel, « à la fin mars 1976« : « dans sa dernière lettre« avant le rendez-vous fixé à Braunau (et où il allait être filmé à son insu grâce à la mise au point, délicate et complexe, d’une « paluche« ), celui-ci spécifiait, le passage se trouve à la page 472 : « Cela me réjouit beaucoup que vous ne reveniez pas sur la somme promise de l’argent des douleurs (Schmerzensgeld). J’ai encore une prière : qu’il me soit versé en devises allemandes« ; et « quand nous eûmes terminé _ l’entretien à l’Hôtel Post de Braunau _, je comptai très lentement devant lui et Frau Suchomel les billets de 100 Deutsche Mark, prix de ses « douleurs ». Il était si content, si sûr de lui, et de moi désormais, qu’il me proposa de remettre ça une autre fois. Je dis oui, mais ne donnai pas suite ; ce fut lui qui me harcela par de nouvelles lettres : mon argent l’intéressait vraiment. A Treblinka, il était le chef des Goljuden (les « Juifs de l’or »), un commando chargé de récupérer l’argent et les bijoux cachés dans les vêtements ; ou d’extirper les dents en or des mâchoires de ceux qu’on venait de gazer« , page 473… Fin de l’incise sur la comptabilité des « dépouilles« prises sur les Juifs assassinés. Et retour aux lièvres ! _
…
et de fait aujourd’hui « à Auschwitz-Birkenau
nul ne tient le compte
des lièvres.
La seule chose sûre est qu’ils sont très nombreux« , page 256-257 ;
…
mais aussi, et encore,
Claude Lanzmann évoque un lièvre qui,
pour ne pas être trop « oublieux » de « la rumeur fantasque du monde« ,
savait se révéler particulièrement « capricieux » et « sagace » :
en Argentine ;
…
dans la « fantaisie« , tout le moins, du « génie » original de la poétesse Silvina Ocampo :
…
le lièvre « que la rumeur fantasque du monde qu’il gardait en mémoire, peuplée d’animaux préhistoriques, de temples semblables à des arbres secs, de guerres vaines et inopportunes«
_ maintenant c’est Silvina Ocampo, « la poétesse argentine« si merveilleuse qui se trouve être aussi l’épouse de mon cousin le, merveilleux lui aussi, écrivain argentin Adolfo Bioy Casares (et amis très proches, tous deux, de Borges) ;
c’est Silvina Ocampo qui s’exprime, dans l’« exergue de ce livre« (lit-on, page 256 toujours), page 11 du « Lièvre de Patagonie« _
…
le lièvre « que la rumeur fantasque du monde qu’il gardait en mémoire (…)
rendait plus capricieux _ en son « indomptable« liberté _ et plus sagace« que d’autres… ;
…
« indomptable« : un adjectif que Claude Lanzman utilise, lui aussi, page 100, pour qualifier sa propre mère, à propos de ce qu’il va jusqu’à qualifier de « la guerre entre mon père et ma mère
_ au début des années trente : cette mère qui, n’ayant « pas d’autre choix _ écrivit-elle alors _ que de partir« , « déserta« définitivement leur « maison de Vaucresson » un beau matin : « cela se passait en 1934« (Claude n’avait pas encore neuf ans ; page 81) _,
…
la guerre entre mon père et ma mère qui s’étaient rendus fous mutuellement. (…)
…
L’un avec l’autre
_ lesquels , plus tard, « elle, avec Monny _ de Boully (Belgrade, 1904 – Paris, 1968) : Claude Lanzmann parle, page 87, de leur « rencontre » et « foudroiement réciproque sur une rouge banquette de la Coupole, boulevard du Montparnasse » et de leur « amour fou« … _, lui, avec la belle Hélène _ « une belle, plantureuse et sensuelle Normande, originaire de Caen et pas juive du tout« , page 71 _, vécurent chacun à sa façon une relation passionnée et pacifique« … _,
…
de surprenantes périodes d’accalmie mises à part,
ce fut _ de « scène« « si violente« en « scène« « si violente« , ce début des années trente _ une tempête sans répit, une escalade de défis et de provocation ; mon père cherchant à asseoir son autorité sur une créature indomptable _ voilà l’adjectif ! _, à terrifier une femme qui n’avait peur de rien et qui crânerait jusqu’à sa mort« : en 1995.
…
Page 101, Claude Lanzmann apporte cette précision rétrospective sur le goût de la liberté de sa mère : « elle ne le trompait pas ; il fallait _ seulement… _ qu’elle sorte _ par dessous d’invisibles barbelés _ ; elle n’en pouvait plus ; le confinement du mariage et de la maternité l’étouffait« .
…
Et ce n’est sans doute pas pour rien qu’elle, Paulette, qui habitait depuis 1934 rue Myrha (« ma mère quitta le foyer _ de Vaucresson, en 1934 _ sans un sou et partit travailler en usine, où elle sertissait des boites de sardines. Elle vécut, jusqu’à sa rencontre avec Monny, dans un hôtel garni du XVIIIe arrondissement, rue Myrha, face au quartier de la Goutte d’Or« , page 81),
et qui était « en adoration devant tout ce qui avait trait à la culture« , page 148,
…
rencontra son nouveau compagnon, le poète apprécié des Surréalistes _ « il avait été mandé à Paris par André Breton et Louis Aragon qui, après avoir lu ses poèmes de jeunesse, voulurent absolument l’intégrer au surréalisme français« , page 87 _ et qui est« considéré aujourd’hui comme le Rimbaud serbe« , page 87 aussi,
Monny de Boully _ qui « incarnait Paris, la grande ville, la culture, la poésie et la pensée« , page 83 ; et « apportait à ma mère tout un univers dont elle avait un besoin vital« , page 82 : là est donc l’essentiel ! _
« sur une rouge banquette de la Coupole, boulevard du Montparnasse« , page 87 encore…
…
Fin de l’incise sur l’adjectif « indomptable » ; et retour au lièvre de Silvina Ocampo… _
…
le lièvre « que la rumeur fantasque du monde qu’il gardait en mémoire (…)
rendait plus capricieux
et plus sagace« ;
…
voici la suite de l’extrait, au tout début du conte telle qu’elle est donnée, dans une traduction d’Elisabeth Pagnoux, par Claude Lanzmann, dans « l’exergue« de la page 11 :
…
« Un jour il s’arrêta
_ ce lièvre qui mobilise le conte de Silvina Ocampo (raconté au petit Jacinto) ; et dont elle déclare, à la troisième phrase du conte, que « ce qui le distinguait des autres lièvres »,
« ce n’était pas son pelage », « pas plus que ses yeux de Tartare ou la forme capricieuse de ses oreilles.
C’était quelque chose qui allait bien au-delà de ce que nous, les hommes, appelons personnalité« .
…
Voici donc de quoi il s’agissait :
« Les innombrables transmigrations de son âme lui avaient appris _ c’est décisif _à se rendre invisible ou visible _ voilà une faculté cruciale _ dans les moments propices à la complicité de Dieu ou quelques anges audacieux.
…
Pendant cinq minutes, à midi, il faisait toujours une halte au même endroit dans la campagne.
…
Les oreilles dressées, il écoutait _ toujours _ quelque chose.
…
Le bruit assourdissant d’une cataracte qui fait fuir les oiseaux
et le crépitement d’un bois en feu qui effraie les animaux les plus téméraires
_ c’est dire ! _ n’auraient pas dilaté autant ses yeux.
…
Un jour, donc, il s’arrêta
comme à l’accoutumée à l’heure où le soleil donnant à pic empêche les arbres de faire de l’ombre,
et _ cette fois particulière-là _ il entendit les chiens aboyer ;
non pas un chien,
mais beaucoup de chiens _ une meute lancée ! _,
dans une course folle à travers la campagne _ pas à l’Est, ici, pas en Pologne (ou Biélorussie ou Ukraine) ; mais dans la Pampa ; ou en Patagonie.
…
D’un bond _ ce lièvre un peu « plus capricieux et plus sagace« car un peu moins oublieux des temps « préhistoriques« et de leurs « guerres vaines et inopportunes« : « les oreilles dressées, il écoutait quelque chose« … _
…
le lièvre traversa le chemin et se mit à courir.
…
Les chiens le prirent en chasse dans la plus grande confusion _ de la meute canine déchaînée…
…
« Où allons-nous ? » criait le lièvre d’une voix tremblante,
vive comme l’éclair.
…
« A la fin de ta vie », criaient les chiens d’une voix de chien (…) ».
L’extrait cité en exergue s’interrompant là…
…
D’où, sans doute, et enfin,
un peu plus tard, en 1995 _ c’est l’année de la mort de Paulette :
serait-il donc possible qu’elle, elle aussi _ « sagace« … _, toujours vive et « bondissante », coure ,« réincarnée« en lièvre ocampien, en « lièvre de Patagonie« , la campagne à l’autre bout de la planète ?.. _,
…
D’où, donc,
l’émerveillement de l’ »incarnation » patagonienne
de ce lièvre ocampien
sur « le dernier tronçon de route, non asphaltée, après le village d’El Calafate
_ « en remontant seul (…) la plaine immense de la Patagonie argentine vers la frontière du Chili et le fabuleux (lui-même !..) glacier du Perito Moreno« , page 192 _,
…
quand la Patagonie tout entière « s’incarna tout à coup, au crépuscule« , pour Claude Lanzmann, « dans le balayement de mes phares,
quand un lièvre _ bien effectif, lui ; et pas du tout rien que fantasmatique !.. _ haut sur pattes bondit comme une flêche
_ c’est un point décisif ! de ce processus de « présentification« intensive !.. :
…
celui-là même par lequel l’amour et le « génie » poétique de Monny de Boully, fit « découvrir » enfin à Claude sa propre mère
« auprès de laquelle« , sans cela (sans cette « présentification« -là !), « il serait passé sans la voir, sans pressentir sa richesse, sans comprendre qui elle était vraiment« , je rappelle jubilatoirement cette phrase magnifique de la page 82 ! _
…
quand un lièvre haut sur pattes bondit comme une flêche
…
et traversa la route devant moi.
…
Je venais de voir _ voir vraiment !!! croiser ; et rencontrer ! _ un lièvre patagon,
animal magique _ depuis la révélation du conte fantastique ocampien ?.. _ ;
…
et la Patagonie tout entière _ par la seule vertu de la rencontre de ce « bond« , de ce« surgissement » prodigieux ! de lièvre _ me transperçait soudain le cœur
de la certitude _ rien moins ! _
de notre commune présence«
…
_ « présence« les uns aux autres : c’est une relation, un rapport, un lien, une tension ! cette « co-présence » à l’autre comme à soi ; et à soi comme à un autre, dirait peut-être ici Ricoeur… :
…
le lièvre, plus (et mieux) « lièvre« , lui, alors, que jamais ;
la Patagonie, plus (et mieux) « Patagonie« elle-même, alors, que jamais
…
au delà des clichés touristiques courant :
courant mille fois trop vite, eux ; sans rien « arpenter« du tout !.. tant ils ne font, toujours, rien que tout « résumer« ! sans la vraie « maîtrise du temps« ; qui demande un « rien » plus de patience, lui… ; et de ténacité ; de force d’âme ;
…
cf l’expression, à propos du temps qu’a pris la réalisation de « Shoah« , page 234 :
…
« »Shoah » fut une interminable course de relais _ douze ans durant; sans savoir si le « travail« , lui, « l’œuvre« , elle, parviendrait à son terme ;
…
« pourtant je n’ai cédé à rien, ni à personne : ma seule règle a été l’exigence interne du film ; ce qu’il me commandait. J’ai été _ au final ; mais ce n’était pas du tout le plus probable _ le maître _ du moins face aux pressions des autres _ du temps ; et c’est sans doute là _ face à eux, comme adversaires, à commencer par les formidables forces d’inertie _ ce dont je suis le plus fier _ face à eux ! avec justesse ! bravo !!!
…
courant, et par « circuits« , les touristes comme _ et avec : ils font la paire ! _ les clichés,
courant, donc, les grandes avenues du monde :
…
cf la confession rétrospective de Claude à propos du premier voyage en Algérie de Simone et de lui-même, « au printemps 1954, en pleine passion amoureuse » _ page 345 _, il est vrai :
…
« Il m’a fallu des années pour me déprendre des stéréotypes, me faire au concret et à la complexité du monde« , conclut-il, en en résumant la leçon en effet rétrospective, l’analyse, page 347 :
…
c’est que « notre intérêt était _ alors _ coupablement folklorique : le Castor tenait absolument à ce que je vois, à Laghouat, les danses du ventre des Ouled Nails, prostituées qui portaient sur leur corps tout ce qu’elles avaient capitalisé au cours de leur vie, en bijoux et pièces d’or » _ page 346 _ ;
…
« nous étions le paradigme du touriste à l’état pur, et jusqu’au ridicule« _ page 348 _ ;
…
le touriste, le benêt (« Monsieur Homais« ) qui ne part un peu loin de son terrain, terrier ou territoire, que rechercher pleine (et circulaire) confirmation de ses clichés (d’exotisme de pacotille) simplificateurs de départ ! Lui, « touriste » tournant en rond telle une toupie qui s’excite un peu de sa vitesse, sur son vide, sa propre vacuité _ fort communément partagée ; mais il ne pourrait jamais le croire ! _ sans « arpenter« si peu que ce soit, de l’un peu moins connu, n’apprendra jamais rien ; lui ne « rencontrera« jamais, nulle part, nul « estrangement« ! ; car il n’est en rien dans l’ordre du « témoignage« ; et de la « vérité » !
…
le lièvre, plus (et mieux) « lièvre« , lui, alors, que jamais ;
la Patagonie, plus (et mieux) « Patagonie« elle-même, alors, que jamais
…
ainsi que soi, un peu plus (et mieux) « soi », ainsi, enfin, que d’habitude,
face au « bond« du liévre « lièvre » (« patagon« )
et face à l’« évidence« « poignante« , enfin, de la Patagonie « Patagonie« ;
…
voyageur autre que « touriste » qui les « rencontrait« ainsi, au sortir des centaines de kilomètres de plaine, vains, vides, en dépit de « quelques troupeaux« , trop placides probablement (non « bondissants » !.. eux…), « de lamas blancs« : il a fallu ce « bond »magique !, page 192,
…
ou, autre vocable proche, ce « surgissement« !
…
Les toutes dernières lignes du « Lièvre de Patagonie« , page 546, rappelant à nouveau l’« effraction« , dans la somnolence d’une trop longue route de plaine, de « l’animal mythique qui surgit _ voilà ! Hic Rhodus, hic saltus !.. _ dans le faisceau de mes phares après le village patagon d’El Calafate,
…
me poignardant littéralement le cœur de l’évidence _ absente, sinon ! _ que j’étais _ mais « vraiment » ! sinon, je n’aurais été qu’un des milliers de touristes « effleurant« de ma quasi non-présence ces lieux de tourisme de cartes postales, comme il en est tant ! _ en Patagonie ;
qu’à cet instant la Patagonie et moi étions vrais ensemble« , page 546…
…
…
Titus Curiosus, ce 21 août 2009


 voilà
voilà