Dialogue avec les morts, de Jean Clair,
qui paraît ce mois de mars aux Éditions Gallimard,
est un livre (de vérité ! _ par sa profonde probité ! _) rare à ce degré d’intensité (!!!)
de trouble… :
…
tant de son auteur l’écrivant,
que des lecteurs qui le découvrent _ et partagent !
et s’en enchantent !!! _,
…
au fil de ses chapitres,
dont voici les titres successifs :
…
l’âge de lait (pages 13 à 50),
l’âge de craie (pages 51 à 91),
les mots (pages 93 à 116),
la ville morte _ c’est Venise ! splendidement analysée : un labyrinthe (sans perspectives…) pour métamorphoses (carnavalesquement et très discrètement, à la fois…) secrètes !.. _ (pages 117 à 135),
Hypnos (pages 137 à 153),
l’âge de fer (pages 155 à 178),
la débâcle (pages 179 à 205),
l’âge de chair (pages 207 à 234),
Eros (pages 235 à 254) ;
et, enfin (pages 255 à 280) _ c’est le chapitre ultime du livre : le cinquième et dernier volume de l’autobiographie de Thomas Bernhard, porte (après L’Origine, La Cave, Le Souffle, Le Froid…) presque le même titre : Un Enfant, lui… _,
une enfance…
…
Il s’agit,
en l’aventure intensément troublante de cette écriture (de rare probité : celle à laquelle nous a accoutumés Jean Clair ! de livre en livre, comme de commissariat d’exposition en commissariat d’exposition…) en dialogue avec des voix désormais tues
…
_ mais lumineusement audibles à qui ose se rendre (et se tendre…) vers elles, et les recevoir (accueillir, écouter) : humblement « dialoguer« _ oui, voilà… _, enfin… ; si loin, mais en même temps si près, ces « voix« ombreuses-là, pour peu que l’on ait appris (et consenti) à devenir, silence fait autour (et muri…), enfin « véritablement« attentif à leur ténue et essentielle musique
qui, encore, s’adressant à nous, toujours, persiste… _
…
il s’agit, donc,
d’un face à face rétrospectif,
l’âge venu _ celui des rétrospections : « Je suis né le 20 octobre 1940. Ce jour-là, à Paris, pouvait-on lire dans les journaux, il n’y avait plus une seule patate à vendre _ ni, surtout, à pouvoir acheter et se mettre sous la dent… _ sur les marchés. C’était la débâcle. On m’envoya à la campagne« : en Mayenne, le pays d’origine de sa mère ; ainsi débute le livre, page 15… _,
…
avec _ ce face à face, donc, rétrospectif… _
avec la formation de lui-même _ de Jean Clair _,
en ses enfance, adolescence et jeunesse
…
_ du temps que son prénom n’était pas Jean, et que son nom, reçu de son père, morvandiau, était Régnier : mais on trouve aussi des Régnier, et en Flandres, et à Venise (Ranier, ou Ranieri…) ; cf à la page 264 : « Quel étrange détour par l’écriture me faisait réexhumer des passages et réinscrire des palimpsestes que des arrière-parents, dont je ne savais rien, avaient autrefois tracés, quelque part entre Bruges et la Sérénissime ?« ; avec ce résultat, majeur !, page 265 : « L’écriture est un refuge et un foyer : ce qu’elle désigne, c’est précisément l’impossibilité d’en appeler au Père. Elle trace les repères d’une topographie imaginaire _ où Venise est alors, dans le cas de Jean Clair, à la façon de New-York pour d’autres transhumants encore, un passage (de ressourcement créatif !) crucial ; et pour toujours ! _, dans l’espoir insensé _ malgré tout ! _ d’y découvrir une toponymie familiale« … : j’y reviendrai ! ce point est capital ! _ :
…
rétrospection
de la naissance (le 20 octobre 1940) jusqu’à la mort de son père (en 1966 ou 1967),
quand le jeune homme passablement turbulent et « en colère » qu’il avait été (en cette jeunesse
…
_ « quelque temps même ce purgatoire _ celui de son enfance mayennaise, à la Pagerie : cf les premiers chapitres : « l’âge de lait« , « l’âge de craie« … _ devint un enfer« , page 237 : « je devenais la proie de colères violentes » ;
…
au point qu’« on m’envoya consulter dans ce qu’on appelait alors un dispensaire public d’Hygiène sociale. J’y fus accueilli par une jeune psychologue qui, un peu désemparée, m’adressa à un « psychanalyste », mot nouveau, étrange, inconnu, qui cachait sans aucun doute des savoirs étonnants« , page 237 toujours. « C’était une femme d’une cinquantaine d’années, l’une des premières en France à avoir imposé en hôpital public cette spécialité et à pouvoir l’exercer » : une rencontre déterminante ! « Elle avait été comme ma seconde mère » (celle qui « avait appris la parole » (page 240), même si « les mots ne me viendraient jamais comme il faut _ « faute d’une aisance de naissance que je ne posséderais jamais« … _, comme si je n’avais _ jamais _ pu _ in fine… _ tout à fait _ voilà ! _ me réconcilier« … : j’y reviendrai aussi : c’est l’épisode-seuil sur le chemin de soi, en critique d’art exigeant !, de Jean Clair !.. _),
…
quand le jeune homme passablement turbulent et en colère, donc, qu’il avait été
_ et demeure, d’une certaine façon (mais contenue et polissée…) encore ! : « la seule rage qui m’habite encore, c’est celle du malappris que je suis resté, et qui parfois explose en mots orduriers. Comme un réflexe primitif, l’enfance remonte en moi. La colère, je crois, ne me quittera jamais« .., voilà !, page 240 _
…
perdit
_ lui-même était alors en sa vingt-septième année : « à vingt-six ans, quand il _ le père, donc _ avait disparu _ soit en 1966, ou 67 _, j’avais quitté mes études, et, mal à l’aise, n’avais rien décidé de mon avenir, perdais mon temps et multipliais les échecs.
…
Beaucoup de mon comportement et de mes décisions ultérieurs serait dicté par l’angoisse de réparer _ voilà ! _ cette impression _ laissée au père _, alors qu’il avait dû, en vérité _ tous les mots comptent ! _ emporter sa tristesse et ses craintes dans sa tombe, irrémédiablement », page 254 : voilà ce à quoi il faut donc impérativement et comme cela se pourra, « remédier« ! et ce qu’accomplit, probablement, ce livre !!!
…
même si on lit, page 279, soit à peine vingt-cinq lignes avant le mot final (« les armoires fermées à clef de son enfance« , page 280..), ceci : « J’imagine en ce moment que mon père frappe à la porte, que je lui ouvre et qu’il me dit : « Pardonne-moi, je suis en retard »… Sans prendre le temps d’être saisi, je me précipiterais vers lui et je l’enlacerais, et ce baiser serait si long, pour dissiper le silence et l’absence de toutes ces années d’enfance où il était là et où je ne lui parlais pas, qu’il y faudra tout le temps _ voilà ! _ qui me sépare de ma propre mort« … _
…
quand le jeune homme
turbulent et en colère
perdit, donc,
son père…
…
…
Jean Clair entre maintenant _ le 20 octobre 2010 _ en sa septième décennie de vie :
quel nom donne-t-il à ce nouvel « âge » sien-ci de vie ?..
…
Peut-être celui _ tant qu’il est encore temps : de l’écrire ! Jean Clair est (toujours, encore…) un homme davantage de l’écrire que du parler… : « parler, c’est toujours un peu commander, au moins imposer le silence autour de soi. C’est un travers. Pourquoi parler en tout cas, quand ce n’est pas pour demander ou pour commander ?« , lit-on page 96… _
…
du « règlement de la dette«
envers ceux auxquels
l’homme accompli qu’est devenu Jean Clair
doit le plus…
…
_ cf le commentaire au cadeau paternel de « la tourterelle grise et rose, attrapée dans les champs de son pays« , le Morvan (ce récit, avec cette expression, se trouve page 252 ; cf aussi La Tourterelle et le chat-huant ; ainsi que mon article du 27 mars 2009 : Rebander les ressorts de l’esprit (= ressourcer l’@-tention) à l’heure d’une avancée de la mélancolie : Jean Clair…) : « C’est la colombe qui, succédant au corbeau, vient annoncer aux passagers de l’Arche que la terre approche, et avec elle le salut. Symbolisant le vol de l’âme, serrée dans la main tendue par-dessus le vide, l’oiseau blanc assure la transmission des générations _ voilà ! _, le geste d’amour qui permettra aux enfants de reconnaître la dette et de la diminuer peut-être« , aux pages 252-253 : des éléments cruciaux, comme on voit…
…
Car « retrouver l’écho _ voilà ! persistant ! et non repoussé… _ des voix de ceux qui ont disparu
me retient désormais _ voilà ! _ avec une force que j’ignorais autrefois _ tant inconsciemment que consciemment : les deux !
…
C’est sans doute que,
le temps aidant _ il faut le prendre à la lettre : le temps peut, et très effectivement !, « aider » ! si on y met aussi un peu du sien : à travailler avec lui, en ses forces… _,
le fait de me rapprocher d’eux
et de m’éloigner des vivants
_ en proie à bien des « débâcles« , tant et tant (même si pas tous : beaucoup trop !..) ; cf la terrible vérité des croquis de personnes dans le très beau chapitre « La Débâcle« ; par exemple, à côté de ceux des S.D.F., celui, pages 195-196, du « monomaniaque du mobile« , avec cette conclusion-ci : « ce dialogue avec les spectres, où un individu dans le désert des hommes ne connait que lui-même, me paraît plus inquiétant que celui du bigot ou du fou quêtant son salut ou apprenant sa damnation d’une voix qui sort de bien plus loin que du petit cercle de ses semblables. Cette clôture _ étroitissime ! _ de l’homme sur l’homme seul et parmi les hommes, c’est ce qu’on appelait jadis, probablement, l’Enfer« … _
…
me les fait entendre plus distinctement _ oui _, et sur un ton plus grave _ et comme profond : d’« élévation« , en fait et plutôt : « monter, accéder à la lumière, élucider, maîtriser les apparences, ce sont des images qui me paraissent préférables à celles qui supposent de se laisser couler vers on ne sait quel abîme _ profond ! et sans fond… _ de l’être, qui n’est que ténèbres, étouffement et solitude« , précise Jean Clair, page 100… _,
…
par un phénomène spirituel _ voilà _ guère différent de l’effet Doppler en physique« ,
peut-on lire page 97…
…
Et Jean Clair de préciser, un peu plus bas, pages 97-98 :
…
« Ce dialogue _ avec réciprocité : davantage qu’autrefois, moins timide… _ avec les morts,
une fois qu’on ne peut plus les entendre _ in vivo _,
prend une forme singulière quand il devient un dialogue avec ses parents ou ses proches
…
_ Jean Clair évoquera aussi, même si ce sera fort discrètement et très, très rapidement, et à l’occasion du goût
(voire de la cuisine _ cf page 247, en un passage, du chapitre « Eros« , intitulé « L’Apprentissage du goût« : « Les femmes que l’on a aimées vous ont ouvert avec douceur le royaume des sensations nouvelles jusqu’à pousser la porte de la cuisine. La mère nourricière se confond avec l’amante attentive, dans l’apprentissage _ voilà ! être homme, c’est apprendre ! _ qu’elles offrent l’une et l’autre, au palais du jeune homme que l’on fut, des saveurs, des douceurs et des amertumes d’un genre plus domestique que celles de l’amour des corps, et néanmoins aussi précieux. « Ici aussi les dieux sont présents », avait dit Héraclite près de son four _ une citation qui m’est aussi très précieuse ! C’est une autre version de la Madone au bol de lait, ou à l’auréole d’osier, avec l’ange qui vient familièrement s’inviter à la table« , page 247, donc… _ ),
…
en de furtifs superbes portraits à peine crayonnés _ à la Fragonard… _,
…
Jean Clair évoquera aussi, donc,
les femmes qu’il a aimées,
et ce qu’elles lui _ ainsi « conduit par de jeunes fées« , dit-il, page 246 _ ont
merveilleusement généreusement donné
…
_ le livre lui-même est dédié, page 9, « A la jeune fille« ;
…
de même, qu’a pour titre « La Jeune fille« une partie (très courte) du chapitre « Eros« ;
…
que voici, même, in extenso :
…
« Plus elle avance dans la vie _ voilà ! _
et plus,
sur le cliché qu’on a pris d’elle un jour, bien avant que je la rencontre,
et où elle apparaît radieuse, les mains tendues vers un inconnu demeuré hors champ,
je la vois rajeunir,
me semble-t-il,
comme si les années qu’elle additionne de ce côté-ci du temps
lui étaient à mesure retirées de la photo ancienne,
au point qu’elle finira par m’apparaître sans doute comme cette adolescente
que je regretterai toujours de n’avoir pas connue« …
…
…
On échange _ enfin ! _ avec eux
…
_ « ses parents ou ses proches« , donc,
je reprends le fil de la citation, après l’incise de « La Jeune fille« … _
…
on échange avec eux
les mots qu’on aurait aimé leur adresser quand ils étaient vivants
et qu’il n’était pas possible _ = trop difficile, alors ! On n’en avait encore acquis la force d’y parvenir ! _ de leur dire.
…
Ces mots, on les imagine _ maintenant ; et désormais.
…
Et comme ils ne provoquent pas de réponse _ nette _,
ils se fondent dans un silence embarrassé« …
…
_ voilà qui m’évoque le dialogue (bouleversant de probité, lui aussi !) avec son épouse disparue, Marisa Madieri,
de l’immense (triestin
_ et Trieste, sinon Magris lui-même, est présente dans ce livre-ci de Jean Clair : aux pages 257 à 266… ;
ces pages, intitulées « Les Miroirs de Trieste« , ouvrent même l’ultime chapitre du Dialogue avec les morts de Jean Clair , « Une enfance« )
…
voilà qui m’évoque, donc,
le dialogue (bouleversant de probité, lui aussi !) avec son épouse disparue (en 1997), Marisa Madieri,
de l’immense (triestin) Claudio Magris,
en son si intensément troublant (et étrange, et profondément grave), lui aussi,
et sublime,
Vous comprendrez donc :
...
Dialogue avec les morts et Vous comprendrez donc : deux immenses livres
intensément troublants
qui s’adressent à la plus noble (et formatrice : civilisatrice !) part d’humanité des lecteurs que nous en devenons…
…
De Marisa Madieri,
séjournant de l’autre côté de l’Achéron depuis 1997,
lire le lumineux Vert d’eau, édité en traduction française à L’Esprit des Péninsules…
…
Et sur la Trieste de Claudio Magris,
courir au merveilleux Microcosmes !!
…
Et, un peu plus bas encore, page 98,
face à la difficulté de,
en ce quasi impossible dialogue à rebrousse-temps (irrémédiablement passé !), avec les disparus,
…
face à la difficulté, donc,
de partager (avec eux, les années ayant passé…) la pratique d’une même langue :
…
« Mais la plupart du temps, comme dans les rêves,
il n’est pas besoin de parler,
la présence suffit
…
_ voilà !
précise Jean Clair ; parmi un monde de fuyards s’absentant (frénétiquement ou pas) de tout, à commencer d’eux-mêmes et de l’intimité (charnelle) aux autres ; cf ici le beau livre (important !) de Michaël Foessel, La Privation de l’intime ; et mon article du 11 novembre 2008 : la pulvérisation maintenant de l’intime : une menace envers la réalité de la démocratie…
…
On parle le langage des sourds-muets.
…
On ne signifie rien,
on ne signale pas,
on signe, simplement« …
…
_ on fait (enfin ; et pleinement !) simplement acte (plénier)
de reconnaissance : de sujet humain à sujet humain ;
de visage à visage
…
_ sur la « visée du visage« ,
à partir de l’exemple de la peinture d’Avigdor Arikha (« une peinture qui dit tout, rien que tout, mais tout du tout qui se présente aux yeux« , page 59…),
et débouchant sur une « histoire (…) qu’il faudrait enseigner dans les écoles« , celle qui lie et relie Monet, Bonnard, Balthus et Lucian Freud : « de Monet à Freud, une chaîne s’est formée d’individus qui se reconnaissaient _ voilà _ et qui cherchaient à se parler _ oui ! _ et à transmettre un métier« … : c’est tellement précieux !
…
Et « de Balthus à Lucian Freud : toute une famille de peintres a rappelé, après la guerre comme avant, qu’un visage était sans prix _ voilà !
Les trois derniers _ soient Bonnard (1867-1947), Balthus (1908-2001) et Lucian Freud (né en 1922) _ ont été les témoins d’une époque où, mû par une idéologie démente, on s’était mis à immatriculer les gens. Ces gens qu’on dénombrait, après les avoir dévisagés, et dont on inscrivait le chiffre sur la peau à l’encre indélébile, craignait-on qu’on n’arrive plus, au Jugement dernier, à les reconnaître et à les distinguer ?
…
Ce fut l’entreprise la plus meurtrière que l’homme _ individus, un par un, comme l’espèce entière ! _ ait affrontée.
…
Les vivants ont le nez droit ou recourbé, court ou allongé, mais la mort a le nez camus ; tous les morts ont le nez camus. Pour les distinguer à nouveau, il faut leur refaire un visage. Le peintre y répond _ en peintre ! _ comme il peut : les gens se reconnaissent, non pas à leur numéro d’abattage comme les brebis, mais à leur visage, à leurs traits. Et les nommer, les peindre un par un, les transformer en personne, c’est les tirer _ en leur irréductible singularité ! de sujet ! et pour jamais !!! cf, déjà, les (sublimes) visages du Fayoum… ; là-dessus, lire, de l’excellent Jean Christophe Bailly, le très fin et très puissant L’Apostrophe muette… _ de la mort« , page 63 ;
…
sur la « visée du visage« , donc,
lire (et méditer : longtemps !) l’admirable passage qui court de la page 60 à la page 63 :
…
par exemple,
« L’homme, en tant que personne, ne se remplace pas. Il n’est pas interchangeable, ni renouvelable, il est unique à chaque fois ; et c’est bien là le mystère auquel le peintre doive s’affronter, et qui suffit à occuper _ certes ! _ toutes ses forces« ;
…
et « Dénommer, appeler, rappeler les apparences, c’est sauver l’homme de la mort. Dénommer et non pas dénombrer, désigner et non pas mesurer ou quantifier. Dire et peindre, c’est rappeler les êtres à la vie, c’est le contraire de les précipiter dans le nombre » _ soit le contraire du (stalinien) « à la fin, c’est la mort qui gagne !« …
…
« Représenter un visage humain et lui donner sa valeur unique, est (…) rare et compliqué puisqu’il est là, devant soi, embarrassant, et qu’on ne peut pas ruser _ voilà ! _ avec sa présence » : c’est elle qu’il faut ainsi, et pour jamais, ressentir et donner…
…
Et lire aussi l’admirable passage intitulé « Les Guichets« , aux pages 198 à 201 du chapitre « La Débâcle« :
…
« On ferme l’un après l’autre les guichets qui étaient à l’homme laïque des temps républicains ce qu’étaient les confessionnaux à l’homme pieux des temps religieux. (…) J’imagine l’homme solitaire, la veuve, la petite vieille, l’étudiant célibataire ; ils vont rester des jours sans pouvoir _ de fait, simplement _ adresser la parole à quiconque.
…
La disparition lente et sournoise des bistrots où l’on allait prendre un petit blanc au zinc, moins pour se désaltérer que pour acheter le droit, moyennant trois sous, d’échanger quelques propos avec des inconnus, semble le point final de cette métamorphose _ régressive : barbare ! _ urbaine.
(…) Nous nous apprêtons à vivre dans un monde _ psychotique _ de solitaires contraints au silence,
qui, n’auront pas, contrairement aux ordres contemplatifs, le consolant espoir d’une vie dans l’autre monde.
…
Parallèlement à ce retrait de l’art _ mais oui ! _ de la conversation _ ce fut un art français… _ ,
la multiplication du « self-service »
_ où, qu’il s’agisse de se restaurer, de faire un plein d’essence, de réserver un billet de train ou de poster un paquet, il n’est plus possible de s’adresser _ si peu que ce soit _ à quelqu’un ayant face humaine… _
est assurément la trouvaille la plus cynique de l’esprit _ dit : auto-proclamé ! _ moderne,
qui réussit à faire passer _ et le tour est joué ! _ pour une libération
ce qui n’est qu’une servitude _ et comment ! _ supplémentaire.
…
Plus éprouvante encore que cet effacement _ avec la dé-subjectivation qui l’accompagne ; cf Michel Foucault… _ de la personne,
…
est l’imposition d’une voix sans visage.
…
Dois-je me faire livrer un bien, louer une voiture, requérir un service,
je serai « mis en relation » avec un inconnu dont je n’ai jamais vu et dont je ne verrai jamais le visage, et qui, à distance, m’adressera les règles nécessaires et m’adjoindra _ et quasi m’enjoindra : on est au bord de l’injonction !.. _, sans trop de politesse, d’y satisfaire sans trop tarder _ sinon, tant pis pour moi !..
…
Aucun recours bien sûr _ la marge du recours est un critère déterminant du degré de civilisation… _ s’il se produit, par accident, une confusion ou une erreur.
…
Si nul ne vous voit,
nul non plus n’est jamais vu
et nul par conséquent _ pas vu, pas pris _
n’est jamais responsable _ ne répond jamais,
en effet.
…
La relation est devenue immatérielle.
Le visage a disparu.
…
Vous êtes décidément seul et sans secours.
…
Maladie mortelle de la société,
la prosopagnosie généralisée _ voilà ! _
d’un monde où les visages pullulent,
mais où nul n’est plus jamais connu, ni reconnu.
…
(…)
Dans le même temps pourtant,
comme il semble que nous sommes passés insensiblement du visuel à l’abstrait,
pour satisfaire au besoin de la mise en chiffres,
…
jamais les visages n’auront été aussi continûment photographiés, identifiés, enregistrés et mis en fiche,
de l’aéroport au magasin de mode.
(…)
A peine aurai-je acheté quelques brimborions dans une entreprise de ci ou de ça
que je me verrai envahi d’un courrier promotionnel à mon nom commençant par « Cher client » ou pourquoi pas « Cher ami »,
et que ma boîte électronique débordera de « spams » à mon intention toute « personnelle ».
…
Anonyme, invisible, inexistant là où je réclame une parole, une aide, un mot,
…
je suis enregistré, diffusé, sollicité, sommé et menacé partout où je ne demande rien« ,
lit-on en ces magnifiques lucidissimes « Guichets« , aux pages 198 à 201…
…
…
Et voici _ pages 100-101 _
ce qu’apporte
(ou pourrait apporter : à l’écrivant Jean Clair, ici),
et tant bien que mal _ infiniment modestement, en effet ! _,
l’écriture
(en l’occurrence de ce qui peut-être deviendra le livre, soit ce Dialogue avec les morts-ci…) :
…
« J’écris pour (…) me prouver que j’existe.
Écrire me rassure,
plus qu’une parole ou une rencontre, toujours trop incertaines.
…
Quand je doute,
de moi, des autres, de la réalité des choses,
je me mets à écrire,
et le maléfice se défait,
le lien _ qui nouait et entravait (tout)… _ se dénoue : je peux vivre à nouveau.
…
Dans le désarroi du matin,
la langue apporte sa certitude« _ elle tient !
…
(…)
Écrire « est le dernier artifice avec lequel se protéger de la tyrannie de la durée que la mécanique puis l’électronique ont numérisée _ à entier rebours de la durée (qualitative !) vivante qu’analysait Bergson _,
dénombrée
…
_ cf aussi, page 111 : « la dénumération détruit à mesure la réalité sensible que la dénomination avait si patiemment créée. Les nombres détruisent les images _ mentales et spiritualisées , quand les images sont des œuvres !
On croit, par la mesure, comprendre le monde. Vanité des sociologues, de leurs chiffres, de leurs courbes et de leurs statistiques.
Vanité pire encore des psychologues, de leurs graphiques, de leurs pourcentages.
…
Les chiffres livrent peu _ et c’est un euphémisme ! _ de la réalité singulière des choses _ elles la nient !..
…
L’étape ultime est la digitalisation,
qui vide peu à peu les rayons des magasins de leurs disques, et les rayons des bibliothèques de leurs livres.
…
Triomphe d’un monde virtuel où nous appelons des spectres au secours de notre mémoire défaillante.
La philosophie du rationalisme _ en son appendice du pragmatisme utilitariste _ a pour fin, ici comme dans le domaine de l’art et de son marché, d’éliminer le problème des valeurs _ par un coup de baguette magique ! mais ultra-efficace !!! par ses effets dé-civilisationnels sur la foule de plus en plus majoritaire d’esprits bel et bien dé-subjectivisés : l’ignorance et la désinformation coûtent tellement moins cher que l’instruction et le travail de culture… _ pour se limiter au domaine du quantifiable et du mesurable » _ et monnayable… _,
…
jusqu’à la rendre _ cette « tyrannie de la durée numérisée« … _ insupportable _ et vainement fuie dans la vanité (symétrique !) du vide de l’entertainment aujourd’hui mondialisé : ah les profits expansifs de l’industrie du divertissement (efficacité de l’amplitude de la crétinisation aidant !)… _ comme la goutte d’eau du supplice chinois« …
(…)
« Au contraire de la langue de bois, si bien nommée,
qui flotte à la surface des eaux, qui monte et qui descend mais qui n’avance pas,
…
les mots que l’on ose et que l’on dépose _ dans le silence pacifié du recueillement _ sur la page
sont des mots singuliers _ voilà ! on y arrive peu à peu… _,
jetés par milliers
…
_ un trésor infini (« trésor des mots« , dit à plusieurs reprises Jean Clair, par exemple page 112) que celui de la générativité de la parole en le discours qu’offre au parlant la langue reçue, partagée et ré-utilisée, avec du jeu… cf Chomsky… ;
quand il ne s’agit pas de la misérable « langue de bois« de la plupart des médias (tant la plupart y sont tellement complaisants !), en effet… ; et des « clichés« que celle-ci répand et multiplie de par le monde… _
…
comme les laisses du langage sur l’estran du temps,
qui vous pousse et qui vous soutient » _ les deux : à la fois…
…
« Quand tout a disparu, quand tout est menacé,
il n’y a que les mots que l’on voudrait sauver encore,
l’un après l’autre _ et en leur singularité, en effet ! _,
…
mesurant _ certes ! _ le dérisoire aspect de l’entreprise,
…
et cependant convaincu _ qu’on est : aussi ! et plus encore ! _ que
le fil des mots _ voilà : en sa dynamique et son ordre… ; et à rebours des clichés ! _,
si on réussit à le conserver _ il y faut du souffle, et un peu de constance : cela s’apprend, avec le temps, et un peu de vaillance et de courage ! en le travail de subjectivation de soi (et du soi)… _,
suffirait _ et, de fait, il suffit ! _ à tirer du néant _ = ramener et retrouver _
tout ce qui s’y est englouti
…
_ et en sauver ainsi peut-être, si peu que ce soit, quelque chose,
même si c’est (passablement) encore ridiculement :
en osant espérer que cela ne soit, tout de même, pas trop
ridicule :
…
« Honneur des hommes, saint langage !« , a proposé le cher Paul Valéry…
…
…
J’en viens alors à l’apport plénier, à mes yeux, tout au moins, de ce très grand livre :
…
comment on apprend _ tel Jean Clair ; ainsi qu’un nouveau Montaigne en ses propres « essais« … _ à se former
_ ce que Michel Foucault appelle le processus de subjectivation _,
se donner un peu plus de consistance,
…
selon une exigence de « forme« , en effet,
de vérité et beauté,
tournant, in fine, plus ou moins à un style un peu singulier,
…
mais « vraiment« ,
sans pose, posture,
ni, a fortiori, imposture…
…
En toute vraie modestie…
…
Déjà, dans la Mayenne de l’enfance de Jean Clair, dans la décennie des années quarante,
« il n’était pas rare, dans cette campagne, qu’on gardât dans la maison une pièce plus belle, plus claire, plus apprêtée que les autres, fournie de quelques meubles et de bibelots gagnés dans les foires et que l’on croyait précieux. Elle était aussi balayée, dépoussiérée, cirée, mais elle demeurait fermée à clef et les rideaux tirés. (…) C’était plutôt une chambre idéale _ voilà ! _, la projection imaginaire, « comme à la ville », d’un lieu où l’on remisait ce qui était jugé « beau » _ voici une première approche de l’« idée« … _, et d’une beauté qui interdisait donc qu’on en fît usage _ ni encore moins commerce, échange.
…
Même ici, je le découvrais, la vie se déroulait selon deux plans bien distincts : le temps long et éreintant des journées ; et puis un autre temps, à la fin du jour, où l’on imaginait ce que pouvait être une existence autre _ et supérieure _, à laquelle on avait sacrifié _ noblement _ un espace et laissé quelques gages matériels, comme des offrandes à un dieu lare« , page 27…
…
« Cette permanence d’un monde invisible qui doublait le monde réel était sans doute nécessaire pour supporter la dureté du quotidien. Elle offrait l’attrait d’un au-delà plus sensible et plus simple à imaginer que celui dont parlaient les mystères de la messe dominicale.
…
Cette chambre vide était en fait un tombeau (…) qui permettait de rêver _ déjà _ à une vie supérieure« _ voilà ! une vie plus et mieux accomplie ! _, page 28…
…
En venant de ce monde de « taciturnes » (page 240) « taiseux« , sinon de « rustres » (page 252),
« un doute m’en est resté pourtant.
…
A l’Université, on me demanda un jour comment quelqu’un comme moi, à peine sorti des champs, avait eu l’envie de consacrer sa vie à un domaine aussi futile et féminin que le goût de la beauté et l’inclination pour les arts.
(…) Il m’en est resté un malaise. Le sentiment ne m’a jamais tout à fait quitté d’avoir _ étant à jamais, en quelque sorte, un « déplacé« … _ trahi, abandonné un front _ celui du plus dur labeur _, gagné _ lâchement _ le confort _ paresseux _ des arrières.
…
Plus encore quand le soupçon m’a pris, confronté à des œuvres en effet trop souvent inutiles et fort laides, que j’avais lâché la clarté d’un Désert habité par des sages pour gagner paresseusement l’ombre des musées peuplés de gens frivoles et de dandys.
…
J’ai toujours eu une double identité.
…
Je demeure un assimilé _ voilà : imparfaitement… _,
parlant un langage emprunté _ voire chapardé _,
traître à ma foi _ avec quelque culpabilité… _
comme un marrane au judaïsme« , pages 45-46 :
…
à relier à la remarque des pages 242-243 à propos de la psychanalyste qui fut à Jean Clair comme « ma seconde mère » (page 240),
en lui ouvrant le « trésor des mots _ voilà ! _,
un coffre des Mille et Une Nuits,
un Wortschatz possédant la magique propriété de s’agrandir _ oui ! _ à mesure qu’on puisait en lui, et de rendre au centuple _ voilà ! _ l’emprunt qu’on lui faisait » (page 241)
…
_ « Finalement je me retrouvais _ en cette psychanalyse _ jubilant _ rien moins ! _,
au sortir de l’adolescence comme au sortir de mon mutisme,
prêt à franchir le seuil de ce qui me semblait l’antichambre d’un Paradis« , lit-on aussi, page 238 ; et ce fut bien, en effet, cela qui advint !!! _ :
…
« Cette femme qui écoutait l’adolescent que j’étais
avec tant de patience et tant d’attention,
venait elle aussi du Peuple élu.
Elle m’avait proposé cette analyse sans rien me demander,
là où l’argent, la « passe », le billet furtivement glissé comme honteux dans la main du praticien deviendraient monnaie courante chez la plupart de ses confrères« …
…
Fin de l’incise sur ce sentiment de « déplacé »
_ et d’à jamais « en colère« … : « la colère, je crois bien, ne me quittera jamais« , page 240 aussi _
de Jean Clair…
…
…
Autre élément éminemment déclencheur de la vocation
au goût de la beauté (et de l’Art)
de Jean Clair,
cette toute première « rencontre » avec la peinture,
à l’école primaire, au final de la décennie _ pauvre ! _ des années 40,
par la grâce d’un instituteur de campagne
de la Mayenne profonde…
…
A l’école, dans la salle de classe,
première rencontre, donc,
avec « deux peintures dont je me souviens » :
…
« une nature morte de Braque » et « un paysage de Matisse » :
…
« Cette Annonciation de la Beauté, comme un ange en Visitation, si inattendue dans la grisaille et la pauvreté d’une classe de l’après-guerre,
cette lumière plus vive qui soudain traversait la salle,
furent une énigme qu’il me faudrait saisir« , page 54…
…
« Que peut donner la peinture
que le reste du visible ne vous offre pas,
et dont cette expérience enfantine me proposait l’énigme ?« , re-pense ainsi, rétrospectivement, Jean Clair, page 55…
…
Et puis,
force est aussi de constater que « ce _ tout premier _ don avait, à mes yeux, faibli _ ensuite _ avec le temps« …
…
« La question ne s’était pas posée aussi longtemps que la peinture avait eu pour mission _ lumineuse ! _ de célébrer _ voilà ! _ la gloire de Dieu et d’en donner l’idée. Elle participait de sa lumière et elle avait par ailleurs la capacité de nous en faire un peu comprendre les mystères.
…
Mais, une fois rendue à elle-même, la peinture « libérée » des modernes, (…) coupée du ciel, rendue à l’ici-bas, la peinture finissait par paraître bien pauvre. Plus pauvre encore quand, se détournant de son devoir de représenter le visible pour annoncer l’invisible, elle prétendait à elle seule se représenter, s’auto-représenter, représenter non pas les apparences de telle ou telle chose, mais représenter la façon même dont elle les peindrait s’il lui prenait par hasard la fantaisie de les peindre, cette peinture finissait par cabrioler dans le vide _ voilà ! _ et quêter les applaudissements d’un public _ bien trop _ complaisant.
Ces tours de force forains _ de bateleurs imposteurs _ m’apparurent finalement dérisoires, répétitifs, lassants et arrogants à la fois« , pages 55-56…
…
« Le malheur de l’art contemporain _ ensuite ! _, c’est de défendre des théories sur les pouvoirs de l’homme tout en les privant de leur theos, et par conséquent en les rendant impuissantes _ un défaut rédhibitoire ! pour un faire… _ à illustrer, comme autrefois aux yeux des Anciens la sidération _ voilà ! cf le concept d’« acte esthétique« selon la merveilleuse Baldine Saint-Girons, in L’Acte esthétique ! un must ! je ne le dirai jamais assez ! _ des formes et des couleurs, ou l’acte de contemplation _ même remarque ! _, ce qui glorifiait Dieu, comme premier et seul Créateur, et la beauté de l’univers qu’il avait créé à leurs yeux, entre six soirs et six matins« , pages 56-57…
…
Cependant, déjà,
« la petite chambre fermée à clef, à la ferme, qui ne servait à rien,
était un exemple _ un modèle : une première intuition… _
de ce discret appel vers le haut _ voilà _
qui permettait d’échapper à l’ennui répété des jours et de rêver à des vies _ supérieures : plus et mieux accomplies ! _ dont on imaginait mal _ au départ _ les aspects _ précis et détaillés _ et la félicité _ qui serait très effectivement ressentie : une aisthesis…
…
Cela valait l’offrande,
et donnait _ déjà ! _ aux gestes les plus simples et les plus communs
une apparence de nécessité et une obligation de perfection » _ voilà ! voilà ! avec une extrême et permanente (voire perpétuelle) rigueur !, en ce qui se découvrira, plus tard, du travail de l’œuvre de l’artiste « vrai« ! Jean Clair le découvrira ! Page 58.
…
Plus généralement,
« C’est du temple _ en effet ; au sens étymologique : un espace élu… _ que le monde se contemple.
…
Les dieux ne sont pas seulement les protecteurs des frontières, ils sont aussi les gardiens de la forme.
Ils sont là pour protéger du chaos, du monstrueux, et de l’illimité _ tel Apollon terrassant Python sur le territoire de Delphes.
…
Pareille croyance devient peu à peu incompréhensible en un monde qui se veut sans frontière et sans limite,
comme il est sans norme _ hélas _ dans la construction des formes _ du n’importe comment capricieux _ qu’il propose à notre appréciation.
Celles-ci sont proprement _ en effet ! _ devenues inhumaines si l’on rappelle que l’humus est et la terre nourricière et le mot fondateur _ oui ! _ de notre humanité _ un oubli payé au prix le plus fort !
…
Ce culte originaire, lié au sacré,
Cicéron l’appelait cultura animi, la culture de l’âme.
Cette belle expression s’est atrophiée sous le raccourci de « culture » _ cf aussi de Jean Clair, L’Hiver de la culture ; ainsi que mon article du 12 mars 2011 : OPA et titrisation réussies sur “l’art contemporain” : le constat d’un homme de goût et parfait connaisseur, Jean Clair, en “L’Hiver de la culture”…
Mais cultura animi se retrouve encore chez saint Ambroise…
La suite n’est guère qu’une lente décadence _ certes _ du sens original si riche, profane ou sacré, de « culture ».
…
Nous n’habitons plus guère _ que dirait Hölderlin ?.. _ le monde _ émondé ! au profit de l’immonde ! _ ;
et les paysans qui le cultivaient
ont à peu près tous disparu _ aujourd’hui : survit une minorité de producteurs de produits agricoles.
…
La culture de l’âme elle aussi a disparu, du coup.
…
Dans son Docteur Faustus, Thomas Mann fait dire à Méphisto que « depuis que la culture s’est détachée du culte pour se faire culte elle-même, elle n’est plus qu’un déchet. »
La culture au sens où nous l’entendons aujourd’hui, n’est qu’un culte _ minimaliste _ rendu à l’homme par l’homme seul, une fois que les dieux se sont éloignés. C’est une idolâtrie _ voilà _ de l’homme par lui-même, une anthropolâtrie.
…
Méphisto, dans le récit de Thomas Mann, en tire la conséquence, avec un sourire ironique : la culture dont vous vous glorifiez est moins qu’un résidu, une ordure, l’émission à jets continus d’un « moi » malodorant ».
…
(…) La culture laïque, et ses produits, livres, œuvres d’art, musique profane, tout occupée de ne célébrer que l’individu, est allée au désert« , pages 66-67…
…
« Il n’y a _ a contrario de ces pentes nihilistes _ qu’un dialogue qui vaille _ vraiment : il est sans prix ! _, (…) c’est celui qu’on engage avec les voix des morts.
Ce dialogue ne prétend pas abolir l’espace mais plonge _ avec fécondité : il l’embrasse vraiment… _ dans le temps, discret et silencieux,
et ne réclame de l’interlocuteur qu’un peu de connaissance et de bienveillance.
…
Chaque fois que j’ouvre un livre _ « vrai« , du moins ; œuvre d’un « vrai« auteur, qui le signe « vraiment« !.. _,
se renouvelle un petit miracle _ mais oui ! _ qui me fait entendre, inaudibles à l’enregistreur électronique mais perceptibles à mes propres sens _ voilà : en un « acte esthétique« … _, les voix singulières, jamais confondues _ quand ces voix accèdent à un vrai style, qui soit « vraiment« (tout naturellement) le leur : pas par artifice de « décalage« calculé ! _, d’écrivains que je n’ai jamais vus et que je n’ai jamais entendus, parmi tant d’autres perdus dans les siècles.
…
Ils sont loin,
et pourtant dans les modulations et le rythme de leur style respectif _ et effectivement singulier, sans artifice ! _,
je les distingue _ oui ! _,
je comprends d’emblée _ oui ! _ ce qu’ils veulent dire,
je mesure à chaque ligne le pouvoir indéfiniment renouvelable _ de l’écriture « vraie« de l’auteur _ et transmis par le simple geste de la main qui sort le livre des rayons _ suivi de l’acte (attentif) de ma lecture… _ qui, sans artifice et sans contrainte, me fait goûter leur présence _ voilà _ et partager leur génie« _ à l’œuvre, se déployant dans les phrases, irradiant dans les lignes, dans le tracé qui est demeuré, et que je puis toujours contempler… _, pages 70-71…
…
« La beauté, autrefois, c’était la politesse de la forme« , dit ainsi Jean Clair, page 90, à propos de la statuaire _ dont celles d’Aristide Maillol (1861-1944), Arturo Martini (1889-1947), Raymond Mason (1922-2010) _ quand elle sait se tenir…
…
Et sur la forme,
cette « belle réflexion de Paul Valéry dans Tel Quel :
« La forme est essentiellement liée à la répétition. L’idole du nouveau est donc contraire au souci de la forme« .
…
Le drame de la modernité, dans sa composante hystérique, est là résumé.
La forme, en musique, du grégorien à Bach, est répétition ; comme en peinture la forme en écho, des figures des vases grecs à celles de Poussin.
…
Vouloir innover, ce n’est jamais que casser la forme, faire voler en éclats la plénitude de l’objet sonore ou plastique, qui relève en effet de la répétition, comme d’une loi de la biologie qui répète les formes« , pages 101-102…
…
…
Une autre initiation et impulsion à l’Art
(et au goût de la beauté),
fut l’exemple de la psychanalyste des quinze ans
de celui qui n’était pas encore Jean Clair,
à propos de ce qui allait _ « vraiment« … _ devenir son goût de l’Art…
…
D’abord à propos de la personnalité de cette psychanalyste elle-même :
…
« Je devais aussi remarquer assez vite que,
parallèlement à la collecte et à la pesée des mots,
il y avait chez elle le goût de la collection et l’amour de l’art _ voilà !
…
C’était la première fois que je voyais accrochés aux murs d’une maison,
outre la petite gravure de Rembrandt
…
_ « Au-dessus du divan où j’étais allongé, il y avait, je me souviens _ a-t-il déjà noté, page 239 _, Les Trois Arbres. Je fixais sur eux mon regard. Ils me semblaient d’une infinie solitude. Ce n’était pas les Trois Croix et moins encore la sainte Trinité, c’était les spécimens végétaux d’une triade naturaliste, pleins d’une vie que je devinais riche, emplie d’ombres et d’odeurs, mais qui n’avait pas encore éclaté au milieu de la plaine immense et déserte des polders »… _,
…
des tableaux de peintres dont je connaissais un peu les noms.
Je me souviens d’un Marquet, d’un Kisling.
…
Les liens secrets qui unissent l’art et l’or,
je passerais bien plus tard ma vie à en deviner les ressorts,
à en analyser la puissance ou la perversion,
sans doute pour donner quelque raison et quelque apparence de sérieux à une activité, la critique d’art, jugée si étrange _ par d’autres _ quand elle se manifeste chez quelqu’un qui vient d’ailleurs.
…
Ils avaient pris _ ces liens-là… _ leur forme parfaite
chez ceux sur qui pesait encore l’ancien interdit de la figuration :
la collection de beaux objets,
…
comme la pratique quotidienne de la lecture
et l’usage des langues
demeuraient essentiels
pour mieux se fondre
et se fonder
là où ils s’établiraient.
…
Éloigné de mes origines _ campagnardes _,
j’ai pu me sentir proche _ en effet _ de ceux-là
dont la patrie,
située en nul lieu de l’étendue
mais au cœur même du temps,
se recrée,
non pas dans un terreau appelé « nation »,
mais partout où sont,
mêlés au texte saint,
les livres et les tableaux« , page 243…
…
Et ceci, encore, sur la psychanalyse même, cette fois,
à la page 244 :
…
« L’effacement lent de la psychanalyse
et les attaques forcenées dont elle fait aujourd’hui l’objet
ont accompagné ce que, faute de mieux, je ne peux appeler que la débâcle de l’intelligence _ voilà !
…
La petite voix sourde,
si vulnérable et si précieuse
de l’analyse,
…
nul ne peut plus l’entendre aujourd’hui.
…
Et ce qu’elle dit,
nul ne veut plus l’écouter.
…
Elle était la dernière sagesse d’un monde
après qu’il a repoussé Dieu,
…
ou du moins avait-elle été sa dernière discipline.
…
Thomas Mann l’avait très tôt écrit, je crois, dans sa conférence de 1938.
…
Bien plus que l’existentialisme de Sartre,
la psychanalyse de Freud avait été un humanisme.
…
Le dernier sans doute.
…
Refusée, oubliée, moquée,
elle laisse aux fanatismes du jour,
et d’abord aux fondamentalismes religieux ou idéologiques, nourris de la bêtise du temps,
tout le loisir de reprendre la main
et de faire entendre à nouveau leurs vociférations« , page 244…
…
Par là,
« la société moderne ne peut fonctionner qu’à l’amnésie« , page 245 :
…
ce que ne peut certes pas faire un artiste tant soit peu « vrai » ;
tels
un Monet,
un Bonnard,
un Balthus
ou un Lucian Freud (cf pages 62-63) ;
…
ou, encore, un Avigdor Arikha (cf pages 59 à 61) ;
et un Zoran Music (cf pages 129 à 133), aussi…
…
…
Dernier élément que j’aimerais relever :
le rapport (complexe, enchevêtré…) entre création et filiation ;
et la question adjacente du pseudonyme et de la signature…
…
J’ai déjà relevé, page 265, cette remarque
que
« l’écriture est un refuge et un foyer :
ce qu’elle désigne, c’est précisément
l’impossibilité d’en appeler au Père« …
…
Jean Clair va creuser plus avant et profond ce point-là…
…
D’abord, aux pages 268-269 :
…
« Le désir du retour dans la patrie
n’est pas que la nostalgie du retour à une matrice originelle,
c’est la nostalgie du Vaterland,
autant que celle de la Heimat.
…
Malade, on est rapatrié,
on n’est pas ramatrié.
On y regagne son feu et son lieu. Hic est locus patriæ.
…
Pervers, celui qui ne retrouve pas sa voix dans le père,
celui qui se croit,
dans l’excès de ses actes et de ses manifestations,
sans égal et sans pair.«
…
Mais : « Rechercher la terre du père, c’est trouver la mort : « Quid patriam quaerit, mortem invenit. »
Était-ce si sûr ? » _ les questions vont bon train…
…
Jean Clair continue donc de creuser…
…
Et il en arrive à ceci, vers la conclusion de ce livre,
aux pages 276-277, d’un livre qui en compte 280 :
…
« Prendre à quinze ans un pseudonyme et rejeter le patronyme _ voilà… _,
ce n’était pas seulement, comme on l’a dit, vouloir attenter à la vie du père.
C’était affirmer l’inutilité de signer une œuvre.
…
C’était du moins rappeler la vanité de vouloir attacher son nom à ce que l’on fait.
Ce que l’on fait, n’importe qui en ce bas monde, le pourrait faire« _ pense-t-on alors, à quinze ans…
…
« Non que les êtres soient interchangeables,
mais que chacun vient en son temps, appelé par la nécessité du moment _ de l’époque, en quelque sorte _,
et non pas mû par la vocation d’un génie _ jugé probablement alors comme une illusion romantique…
…
Pourquoi donc vouloir « illustrer » son nom _ son patronyme : le nom, aussi, donc, de son père… _ lorsque la création est d’essence anonyme ?
…
Rien dans ce que faisais _ alors, vers 1955 et après… _, ne justifiait mon patronyme.
Aucune origine _ ni filiation, donc _ n’expliquait mon besoin de tracer des lignes jusqu’à les ratifier _ voilà : par une due signature ! _ d’un nom,
à la façon dont la noblesse justifie ses titres de propriété en exhibant ses armoiries… »
…
« Qui exactement fait ceci ou cela
dans cette chaîne ininterrompue d’échanges, d’emprunts, de citations, de calques, de moules et de copies _ ouf ! _
dont une œuvre se constitue ?
…
L’originalité d’une œuvre est sans origine.
L’homme passait _ tout simplement, en un pur et simple relais _ la main.
Et c’était là son pouvoir,
que la femme n’avait pas _ nous étions là dans les années cinquante...
…
Et c’était ainsi _ et pas autrement ! _,
cette _ pseudo _ nuée ardente de la création :
le nom n’était que la diffusion dans la nuit d’une lumière dont la source serait à jamais inconnue« , page 276…
…
« Un pseudonyme imposait en revanche ses obligations,
comme si le nom _ que l’on s’attribuait, ex nihilo _ portait avec lui des responsabilités égales à celles qu’on s’engage à assumer envers un enfant qu’on adopterait.
…
J’avais pu croire le mien _ « Jean Clair« , donc… _ le plus innocent.
Sa sonorité lunaire et transparente, son côté un peu niais,
auraient dû m’assurer l’impunité de l’anonymat.
…
Mais non : je ne commençai d’écrire que lorsque ce nom prit consistance et force,
prit son vrai sens à vrai dire,
qui est d’avoir le tranchant et la transparence du matériau dont il est fait.
…
On ne troque les responsabilités héritées de la filiation
que pour mieux assumer les devoirs entraînés par une paternité d’adoption« , page 277…
…
Pour conclure, toujours page 277,
et à propos de l’étymologie :
…
« A défaut d’un lignage, d’un historial, d’une chronique ou d’un récit familial,
je veux,
fils de paysans sans nom et sans renommée,
dans le développement d’une langue aussi commune que celle de la gens d’où je viens,
trouver dans l’origine de ses mots _ de cette langue partagée _,
les traces d’une histoire et d’un
lieu,
les racines mêmes des raisons _ voilà _
pour lesquelles je vis ici et aujourd’hui« …
…
…
Et pour en revenir, enfin, au « goût des formes » de Jean Clair
et conclure là-dessus,
…
encore ce passage-ci, page 253, à propos de son père :
…
« Cet homme, mon père, d’une grande pudeur et d’une bonté désarmée
_ mais un paysan a-t-il le droit de se montrer tendre ? _,
je l’avais méprisé.
…
Que les fils tuent les pères
et qu’ils quittent les mères,
oui,
cela se sait, depuis toujours.
…
Mais au moins, comme on dit, il convient d’y mettre les formes.
…
Je l’avais fait avec violence _ voilà !
…
De là peut-être
que,
dans ce qui suivit,
je fus attentif
à reconnaître et à aimer,
sinon à respecter _ on notera la nuance _ les formes.
…
Bien sûr, ma plus grande peine
est _ et demeurera _ de penser
que mon père est mort avec l’impression
que le fils dont il était si fier,
et pour lequel il avait travaillé bien au-delà de son temps,
était en réalité quelqu’un
qui ne valait rien de bon« …
…
Voilà,
avec ce beau et grand Dialogue avec les morts,
l’hommage
_ et la réparation ! _
du(s),
par un homme (et auteur) de très grande probité,
à ce père
« d’une bonté désarmée« …
…
…
Titus Curiosus, le 27 mars 2011
news and informations automotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travelautomotive,business,crime,health,life,politics,science,technology,travel


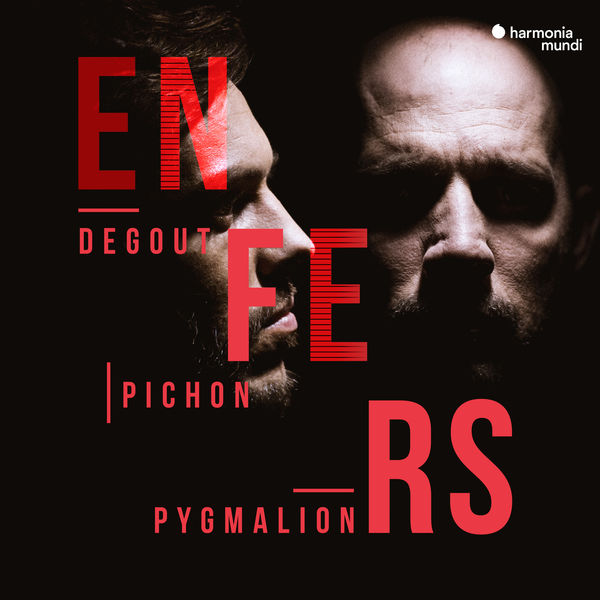
 Éditions Gallimard
Éditions Gallimard