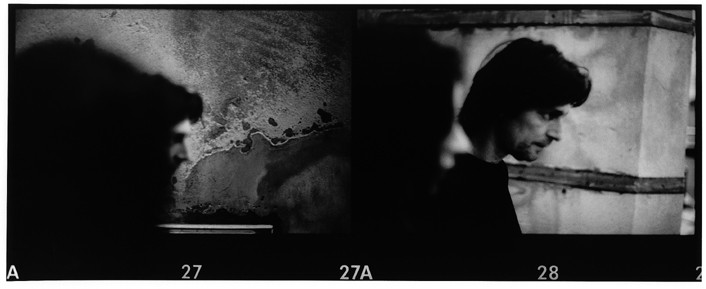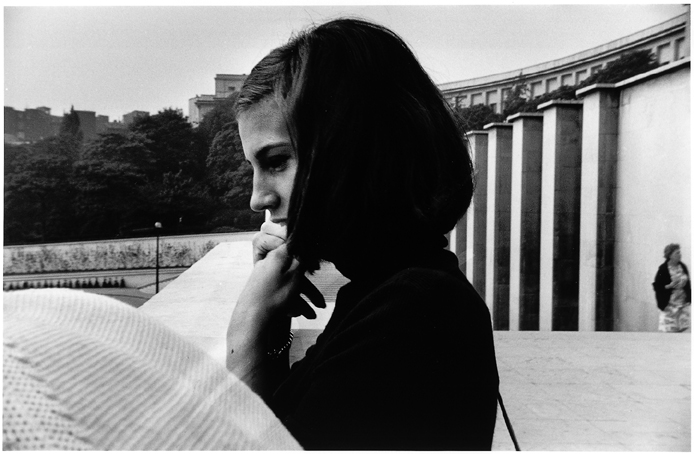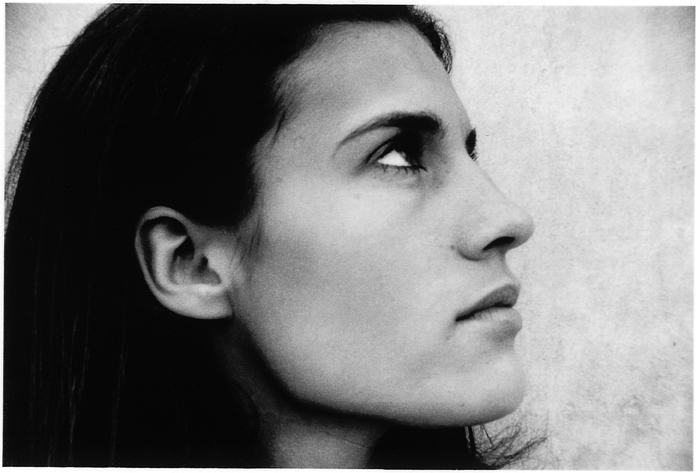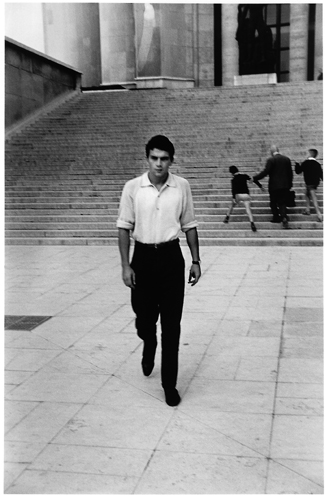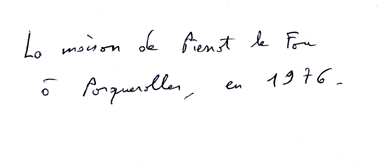Retour de bouteille à la mer : (passionnante !) réponse de Christophe Pradeau à ma lecture de sa « Grande Sauvagerie »
19juin
A l’envoi de mon tout récent article « Cultiver (en son regard !) la lumière de la luciole et subvertir la carole magique : l’enchantement de l’écrire de Christophe Pradeau« ,
…
Christophe Pradeau,
l’auteur de La Grande Sauvagerie, aux Éditions Verdier _ dont on peut écouter la très intéressante présentation dans les salons Albert-Mollat, le lendemain de la réception du Prix Lavinal, à Lynch-Bages, en dialogue avec Véronique, sa fervente lectrice (l’entretien, riche, comme l’œuvre en ses 154 pages denses, de multiples ouvertures, dure une bonne heure) _,
répond sur le champ,
et d’une manière merveilleusement circonstanciée…
…
…
Je livre ce message, infiniment précieux _ sans rien de personnel, ni d’indiscret, on va le voir _, de l’auteur,
livrant ici quelque coin des plus « intime »_ sinon secret _ de la « fabrique » même de sa « fiction » :
…
cette fiction
s’étant « faite » (et, ainsi qu’il l’énonce, « faisant désormais seule autorité« en son livre tel qu’il existe, en l' »achèvement » de ses 154 pages),
…
mais aussi, « continuant« , encore, en quelque sorte, de « se faire« ,
« de creuser« ,
continuant de « pousser » quelques sillons (ou plutôt, en le terreau, l’humus noir nourrissant, quelques nouvelles radicelles d’un processus de déploiement d’une « arboration » foisonnante…)
en le terreau-territoire, donc, de son imagination d’auteur-roi de sa fiction « fictionnante » ;
…
mais aussi en celles, « fictionnées« , elles,
mais en mouvement continué ! vivant ! ému ! encore (= mobilisée ! _ et mobilisatrice !),
de ses lecteurs les plus (ou mieux) attentifs, du moins… _ puisqu’il (= l’auteur) nous (= les lecteurs) accule _ et combien brillamment ! _ à l’exercice _ vivant ! je le répète ! _ de tenter de résoudre, à notre tour, l' »énigme » que constituent, encore, pour nous, les blancs, les lacunes, sinon, même, peut-être, quelques contradictions de ce que le roman (tel qu’il est présentement _ et dorénavant ! _ figé en les 154 pages du livre achevé et disponible, entre nos mains) nous livre,
à travers le récit rétrospectif (lui même tout vibrant de mille émotions toujours mouvantes… ; et parfois approximatif) de sa narratrice, Thérèse Gandalonie,
…
à la façon des proliférantes racines du (très) grand arbre rouge,
« acclimaté« , lui aussi _ je veux dire comme l’ont été, en cet enclos de La Grande Sauvagerie, sur un promontoire rocheux du Limousin, les lucioles, importées, transplantées et « naturalisées« (page 147), elles, de Toscane, par Antoine Lambert) _, en Limousin, des rivages d’Amérique,
par un autre de la « tribu » Lambert, le cousin (d’Octave et Antoine, ou plutôt, quoi
que plus âgé qu’elle, d’Agathe, née, elle, en 1909) Alban, assez âgé, lui, pour être mobilisé à faire cette Grande Guerre et finir fauché par la mitraille, un des tout derniers jours de celle-ci, à l’automne, et peut-être même, un des premiers jours de novembre, 1918…
_ une période qui tout particulièrement m’intéresse, eu égard à la préparation « en cours« (elle me « travaille« aussi, continument…) de mes deux contributions au colloque Lucien Durosoir (1878-1955) de Venise, à l’« Institut de la musique française romantique » (ou « Fondation Bru-Zane« ), les 19 et 20 février 2011 ; je vais en reparler, puisque vient de sortir une nouvelle « pépite« merveilleuse Alpha, en l’espèce du troisième CD de l’interprétation intégrale de l’œuvre musical de Lucien Durosoir, que met en œuvre l’éditeur d’Alpha, mon ami Jean-Paul Combet, en l’espèce du CD Alpha 164 Jouvence, par l’ensemble Calliopée : éblouissant !!! j’en reparle sur ce blog très bientôt !!! _,
…
à la façon des proliférantes racines du (très) grand arbre
rouge : le « cèdre » dit « rouge« ,
ou « thuya géant » ;
…
je lis le passage (et en son souffle : celui de la narratrice, Thérèse Gandalonie), aux pages 137-139 de La Grande Sauvagerie :
…
« Pendant qu’Agathe poursuivait son récit _ ce soir de 1990, en son domicile de la rue de Babylone, à Paris _, je voyais,
ce qui s’appelle voir, image intrusive _ ou la réussite de la poiesis de la parole humaine en sa capacité (de semaille de graines de vie) d’« enchantement« … _, presque effrayante par sa force de persuasion _ en effet ! _,
je voyais, donc,
Jean-François _ le Rameau qui avait eu la folie de s’affronter, corps et biens perdus, à la « réalité« , lui, de la « grande sauvagerie » (sans majuscules, elle !) des territoires les plus blancs (et pas que sur les cartes d’alors !) d’Amérique (et du Nord)… _
pousser _ lui, donc ! _ ses racines _ on lit bien : les « racines » de Jean-François (Rameau) lui-même ! _
dans la tête de ses enfants _ dont Jean-Guillaume, le père de Jeanne-Marie, qui épouserait ensuite Jérôme Lambert : ceux qui (en « une dizaine de voitures« , à « la fin octobre 1822« , page 136) se transplanteraient de Bourgogne en Limousin… _,
à la façon patiente de cet arbre géant de la Colombie britannique,
le cèdre rouge,
dont il était le premier européen sans doute à avoir donné une description,
dont il avait dessiné, et c’était très certainement la plus belle aquarelle des Carnets,
le racinage,
la façon dont les racines s’insinuent à travers les roches les plus compactes,
pouvoir de pénétration plus irrésistible, plus redoutable, mystérieux, nocturne et silencieux, que le fracas _ même : dissolvant, lui _ des vagues contre les falaises.
…
Agathe voulut bien acquiescer :
l’image ne lui semblait pas très juste pourtant, et elle ne l’était certes pas,
mais vigoureuse ;
et puis elle allait au cœur :
…
elle m’apprit que, dans les dernières années de la Belle Époque _ peu avant 1914, donc _, l’un des descendants de Jean-François,
Alban Lambert,
un cousin qu’elle aimait comme le grand-frère qu’elle n’avait pas eu _ elle s’entendit moins bien avec son propre petit frère, Léonard, né en 1912, lui… _
un cousin mort à la guerre, l’avant-veille de l’armistice,
devait planter,
sans rien savoir _ pourtant _ des pages du Journal que je venais d’évoquer
_ et « inventé » quelques années plus tard seulement : « à l’automne 1936« , par un certain John Fleming (page 109), d’abord ; puis lors d’« une publication savante« , par les soins d’« un (sien) ancien camarade d’études, le Dr Anders« , quand « fut annoncée en mai« 1938 cette « découverte« (page 11) ; mais surtout « l’été 1954« , lors de « la mise aux enchères des manuscrits« et « l’acquisition décriée des douze carnets de cuir rouge par une université américaine« (celle de Yale : les carnets quittant alors le Québec ; et le Canada), « pour voir le nom de Jean-François Rameau refaire surface » planétairement alors (page 111 aussi) _,
…
deux magnifiques spécimens de cèdre rouge
ou, comme on dit plus volontiers aujourd’hui, de thuya géant :
…
on peut encore les voir, du moins, se reprit-elle, était-ce encore le cas lors de son dernier séjour à Saint-Léonard, dans le parc de La Grande Sauvagerie, derrière la tour de l’observatoire. »
…
Et c’est là que se situe, page 138, le passage
déjà cité en mon compte-rendu précédent de La Grande Sauvagerie,
sur la constitution, par la « légende« , de la famille Rameau-Lambert, en une véritable « tribu » :
« la légende de Jean-François…« , l’expression se trouve page 138.
…
…
Voici donc ce courriel passionnant :
…
De : Christophe Pradeau
Objet : RE: Article de mon blog Mollat sur « La Grande Sauvagerie »
Date : 18 juin 2010 01:24:46 HAEC
À : Titus Curiosus
…
Cher Titus Curiosus,
…
je trouve vos messages et votre article au retour d’un séjour de quelques jours à X… Merci infiniment pour cette belle lecture, si impliquée et si précise à la fois, qui, par la façon qu’elle a d’accompagner le texte commenté, de se glisser dans ses recoins et ses interstices, dans ses blancs et lacunes, de digresser, de revenir en arrière, de piétiner et d’aller de l’avant, m’a rappelé l’écriture si singulière de Péguy _ mazette ! _, notamment dans ses essais sur Hugo ou sur la trilogie de Beaumarchais (ce merveilleux livre posthume que l’on connaît sous le titre de Clio) ; ou encore, moins connu et nettement moins accompli mais vraiment étonnant, le commentaire linéaire intégral de Madame Bovary par Léon Bopp _ inconnu de moi jusqu’à ce jour : grand merci, Christophe !
…
Vous avez presque toujours touché juste _ merci ! _, jusque dans le choix des illustrations. L’horloge de la « Maison Renaissance » de Lubersac flotte bien quelque part, en effet, derrière celle du Vieux Logis de Saint-Léonard ; et la Thérèse des Âmes fortes _ Christophe a écrit, comme j’avais, moi aussi, failli le faire : Âmes mortes ! mais là, ce n’est pas de Giono, mais de Gogol, qu’il s’agit ! _ derrière Thérèse Gandalonie _ je m’en réjouis, tant j’apprécie, et c’est encore un euphémisme, ce Giono-là : celui aussi d’Un Roi sans divertissement, Noé, Deux Cavaliers de l’orage, Les Grands chemins, Ennemonde et autres caractères, L’Iris de Suse : quel (jubilatoire) magicien du récit !.. Et en creusant un peu, j’ai découvert, alors, que Christophe Pradeau a réalisé un Jean Giono, paru aux Éditions Ellipses en 1998…
…
Pour ce qui est des précisions demandées…
…
Je n’ai pas constitué de chronologie précise, qui aurait préexisté au livre à la façon d’un plan _ et d’un cadre (ou d’une cage) a priori _, et je n’en ai pas établi a posteriori pour m’assurer _ Christophe n’a pas ce type d’« inquiétude« maniaque… ; par là, il est tout à fait dans la descendance (poïetique) d’un Giono ! pour ne rien dire d’un Faulkner… _ de la cohérence de l’ensemble ; j’avais intuitivement _ cela devant largement « suffire« … ; la priorité étant la coulée (et plus encore le coulant) du flux… _ le sentiment que cela tenait, globalement… Mes premiers lecteurs – les lecteurs si précieux du premier cercle amical – l’ont fait pour moi et m’ont permis de corriger deux ou trois incohérences _ sans nulle gravité : Thérèse qui raconte n’est pas une machine ; ni une exégète (d’elle-même) maniaque… _ de détail : je croyais que cela avait été fait pour avril 1954-avril 1956… _ une discordance signalée entre les pages 62 et 16… Sans doute un problème de report sur les 3es et dernières épreuves… Il reste toujours des choses de ce type dans un livre et c’est assez rageant…
…
Pour ce qui est des liens familiaux. Marie-Lou _ la tante protectrice de Thérèse, dont le jardin au figuier généreux lui est (chaleureuse !) terre d’asile _ est, abusivement, qualifiée d’ « épouse morganatique » parce que, fille du bas pays, issue d’une famille paysanne d’une modeste aisance, elle épouse le frère de la mère de Thérèse _ voilà ! _, rejeton d’une famille prospère du haut pays
…
_ le jeu bas/haut – haut / bas est important dans l’économie du roman de Saint-Léonard : dès la première page, où tout « dévale« , tantôt abordé d’en-bas (à grimper, avec ses pieds : « Elle (la « lanterne des morts » : fascinante ! pas encore nommée par la narratrice, Thérèse, en cette toute première phrase, déballée par son récit, du livre !) domine le village, lui-même haut perché avec ses raidillons coupe-jarrets, ses monte-à-regret cabrés vers le ciel« …), tantôt vu d’en-haut (par un regard non essoufflé, alors ; mais le corps peut se mettre, et, bien vite, à se laisser aller à courir ! en fonction de l’âge, surtout… : « l’emmêlement têtu, le ruissellement (surtout : tout se met à couler !) gris bleu de ses toitures d’ardoises, ses étagements de balcons, de tourelles en encorbellement arrimés aux redans du rocher, avec l’ample retombée (voilà !) de ses jardins en terrasses, ses volées de marche dévalant (ça s’accélère ! la course vite emporte…) la pente, impatiente (voilà !) de se faufiler au milieu du quant-à-soi des vergers,
…
…
entre les hauts murs de granit, gainés de mousses et de lichens, alourdis par le débord cornucopien (à foison !) des arbres en espalier, la plénitude (oui !) tentatrice (paradisiaque !) des reine-claudes, des figues fleurs (les voici déjà !) , des sanguinoles ou des pavies, tunnels d’ombres et de feuillages le long desquels on dégringole (voilà, voilà ! de plus en plus vite, par l’effet de l’attraction gouleyante de l’ivresse de la pente avalée…) en criant à tue-tête pour déboucher enfin, hors d’haleine, échevelés, les joues en feu, au milieu des éclats de rire des berges, des courses trébuchantes sur les bancs de galet, face à l’éclaboussement (cézannien ! et zolien : cf les rives de l’Arc tout au bas de la pente d’Aix-en-Provence !)
…
 …
…
des corps nus dans l’eau froissée de soleil« … : c’est superbe ! quel bonheur d’écriture !)… _,
…
…
Marie-Lou est, abusivement, qualifiée d’ « épouse morganatique » parce que, fille du bas pays, issue d’une famille paysanne d’une modeste aisance, elle épouse le frère de la mère de Thérèse, rejeton d’une famille prospère du haut pays,
famille bourgeoise déjà, affranchie _ elle _ des servitudes _ lourdes _ de la terre. Je n’ai pas imaginé de prénom à cet oncle maternel de Thérèse, l’époux de Marie-Lou _ il demeure seulement (rien qu’) une « fonction » : comme pas mal des personnages masculins, ici… _, mais j’avais pensé lui donner le nom de Decay _ un mot de la famille de « descente » ; cf « décadence » (en anglais, « to decay« signifie « se gâter« , « pourrir« , « partir en ruines« : « déchoir« , donc… Il est censé avoir fait l’acquisition de la maison aux arcades et du jardin au figuier _ celui de la « chute« , au Paradis, dans la Genèse… _ quelques années après la mort d’Antoine, maison dont la famille Lambert, les héritiers d’Antoine, se défont, on ne sait pourquoi _ non plus _, au profit d’une famille du bourg, les Decay _ mais de telles transactions ne sont pas dénuées d’importance à l’échelle d’un petit pays… _, pas plus qu’on ne sait dans quelles circonstances Antoine a pu l’acquérir et à qui il l’a acheté _ le souci de l’auteur (quant à la « fabrique« de son « monde« ) va assez loin, on le voit ; jusque dans ce qu’il choisit de délaisser : dans l’ombre (= sans focalisation trop nette). Pas de lien de famille donc entre Thérèse et les Lambert, du moins dans mon esprit, mais le texte autorise, bien entendu, à en imaginer et je l’ai voulu ainsi _ bravo ! La grand-mère de Thérèse, dont la mort la touche tant, est sa grand-mère maternelle : donc la mère _ aussi _ du mari de Marie-Lou. Cette dernière _ la bonhomie généreuse et la faconde de sa silhouette n’étant pas sans me rappeler celles de l’« Ennemonde » de Giono, sans sa « patte« de carnassier, toutefois… _ est une sorte de figure de substitution sur laquelle se reporte l’amour de Thérèse pour son aïeule. Le père de Thérèse est laissé _ lui aussi _ dans l’ombre parce qu’il en est une _ c’est dit ! _ : d’une famille un tout petit peu moins aisée _ une différence infinitésimale suffisant ! _ que les Decay, d’un caractère moins bien trempé que celui de sa femme, il passe le plus clair de son temps _ fuyant comme la truite de montagne, à la peau un peu gluante quand on veut la saisir, ou tenir _ à la pêche… J’imagine tout ce que sa femme a pu dire _ certes ! _ sur les Gandalonie ! _ un nom qui me paraît proche de celui des « Vandales« , qui passèrent jadis par là aussi, avant de se poser et fixer en Vandalousie… Ai pensé, je m’en aperçois en vous écrivant, aux Dodson du Moulin sur la Floss.
…
Bien entendu, tout ce que je viens d’écrire est pour ainsi dire virtuel puisque seul le texte fait autorité _ bien sûr ! Ce sont des données qui m’ont été utiles pour écrire le roman _ en la gestation pétulante et pétillante : festive, de sa « fabrique« … _ mais que j’ai retirées – comme un échafaudage – ou qui sont restées en suspension _ c’est aussi bien intéressant, cela _, tout au long de l’élaboration du livre, dans le blanc de la page _ que le lecteur bien attentif ne peut que deviner : il est jubilatoirement passionnant de pouvoir, ainsi, glisser un œil dans ce « chantier de construction« tout frais et si vivant : frémissant encore… Lire alors aussi est frémir…
…
Merci encore de m’avoir offert le plaisir de replonger _ merci ! _ avec vous au plus intime _ voilà ! mais c’est moi qui vous suis infiniment reconnaissant de l’éclairer ainsi ! en son frémissement ainsi « continué« , « retrouvé » par vous, l’auteur, en la lecture du « commentaire« … : le chantier de l’activité fictionnante se poursuivant par là, non seulement en le lecteur, mais même, ici, en l’auteur, lecteur du « commentaire« … _ de La Grande Sauvagerie. J’ai retrouvé, en effet, en vous lisant, une saveur, une qualité d’intimité _ merci de me le faire, à votre tour, ainsi, partager ! _, inséparable de l’écriture, du livre en chantier _ mais oui ! _, mais dont, le livre publié, il s’agit de faire son deuil, à moins que certaines lectures ne vous la restituent _ la lecture, bien sûr, est (toujours, mais surtout à son plus vif) une reviviscence… C’est un plaisir rare et troublant, que je vous dois _ doublement merci (beaucoup) à vous, Christophe !
…
C’est pour cela que s’adresser à l’auteur, et continuer la « conversation« , en quelque sorte, qu’il a proposé d’entamer avec vous, lecteur, en vous offrant (à l’opération risquée, vôtre, de la lecture) « sa bouteille à la mer » (qu’est le livre : fictionné), est l’occasion de lui témoigner un peu de la (magnifique) reconnaissance (et gratitude) de cette joie pure de lire, en sa richesse, du lecteur ! admis à « collaborer« , en quelque sorte, à son tour _ à la façon de l’interprète musical de la partition écrite, notée… _, à partir des perches que lui tend (ou ne lui tend pas, avec des blancs et des lacunes, ou des ombres, volontaires), en ses phrases, l’auteur, à un jeu (comme « de l’oie« : en partie ouvert par les hasards organisés et à moitié imprévisibles de la partie : la retombée des dés et le jeu qu’elle vient soulever…) ; à un jeu, donc, de perspicacité, au plaisir d’élucidation (jamais achevée, en effet) des « énigmes » (patentes) du récit lui-même, organisé ainsi et pour cela (ces portes ouvertes sur des pistes diverses devenant possibles…), du livre…Avec quelle densité et profusion ici : proprement « cornucopienne« ! en effet !
…
il me semble que l’adjectif, présent en l’ouverture (assez audacieuse par là ! vis-à-vis de tant d’« indiligents lecteurs« , près de quitter, dès pareil seuil, le livre _ de fiction, le roman _, qu’ils viennent à peine d’entrouvrir !..) du récit de l’universitaire, désormais émérite, qu’est Thérèse, page 11, à propos des « hauts murs de granit« , enserrant les « vergers« de Saint-Léonard (ou Saint-Robert, son modèle dans la réalité du territoire, si l’on préfère), « gainés de mousses et de lichens« : « alourdis par le débord _ voilà ! _ cornucopien des arbres en espalier« (et combien ce « débord« , fructiforme, ou fruitier, est superbe !),
revient une autre fois : je viens de le trouver, page 51,
à propos de « la langue » et de « la veille patiente« , dans les « bibliothèques de la Nouvelle-Angleterre dont les portes restent ouvertes jour et nuit« : « où s’entretient sans discontinuer, tous les jours de l’année, jusque dans les heures les plus hostiles du petit matin, le feu vacillant des lectures buissonnantes, la veille patiente de ceux qu’on appelle, dans la langue cornucopienne de la Renaissance (voilà !), les Lychnobiens (ceux qui vivent à la lueur des lanternes)« … Fin, ici,de mon incise sur ce généreux, un peu rare aujourd’hui, adjectif : « cornucopien, cornucopienne« …
…
Bien amicalement,
…
Christophe Pradeau
…
…
Dans la curiosité festive de votre prochain opus…
…
Titus Curiosus, le 19 juin 2010
…
Post-scriptum :
…
Lui ayant demandé son blanc-seing
à la publication de notre (modeste) échange,
…
voici le petit mot (de réponse)
que je reçois ce matin, il est 5 heures, de Christophe Pradeau :
…
Cher Titus,
…
Je ne vois pas d’inconvénient à publier ma réponse à votre article et le commentaire qui l’accompagne.
Merci encore…
Vous avez une façon d’écrire d’une tonicité réjouissante et communicative.
…
Bien amicalement,
…
Christophe Pradeau
…
« Wow » ! _ soufflerait le cher ami Plossu…
…
C’est moi qui suis le débiteur :
de la richesse proliférante, « cornucopienne« , donc
(mais contenue : retaillée _ sans perdre le souffle, tout au contraire, pour mieux affûter ses fulgurantes, ou terribles, envolées : tout respire ! _, retaillée au burin, au ciseau, au stylet, à la plume _ michel-angelesque ! sur la blancheur du marbre chaleureux, en fusion (en sa merveilleuse fondante autant que consistante plasticité…) de vos mots ! _ d’exigence artiste ! cf le « en espalier » de la taille des arbres des vergers de Saint-Léonard !)
de votre « monde« ,
…
cher Christophe,
celui qui jaillit et sourd de votre écriture _ et « le style, c’est l’homme même » ! _ :
…
en une densité qui continue d’échapper _ et donner à profusion : en votre générosité (« cornucopienne » ! donc…) d’auteur-écrivain : oui, vous l’êtes ! _ fruits, fleurs, feuilles, rameaux _ eh ! oui ! _, branches et frondaisons splendides, caressés (et soulevés) par le vent et la lumière , dans l’univers d’en-haut,
et racines et radicelles (à champignons !), dans l’univers « souterrain« , ou d’en-bas, dans le terreau et le terrain et le territoire :
…
tous, frémissants qu’ils s’agitent (et que vous percevez ! si merveilleusement, en votre écriture !)
…
_ tel Lucrèce ;
je n’ai encore rien dit (quelle faute ! mille pardons !) de ce que vous en faites, aux pages 86 :
…
« j’entends la pluie d’atomes chantée par Lucrèce«
…
et 87 : « plus rien ne compte que les entrechoquements d’atomes, ces écarts et pas de côté (oui ! le clinamen décisif !) qui sont tout à la fois la genèse et l’apocalypse (en effet : « à la fois« , oui ! d’un seul et même mouvement, en la richesse infinie de ses métamorphoses rebondissantes complexes !), le début et la fin (l’alpha et l’oméga !), toutes choses mêlées, confondues dans la même (giboyeuse !) pluie fine de printemps«
…
(celle-là même rencontrée, avant-guerre certainement, par la merveilleuse Marie-Lou, elle, à la page 60 du récit de sa nièce Thérèse Gandalonie, en ce que cette dernière nomme, avec tant de justesse, une de ses « heures enchantées » (jusqu’à donner son titre au « chapitre troisième » : « Les heures enchantées« ) :
…
« elle _ Marie-Lou, donc _ avait fini par pénétrer pourtant dans la lumière, par se glisser (voilà ce qui est requis de nous, vivants humains : ce banal, mais décisif geste de courage ! que tant, telle la mère de Thérèse, se refusent, eux, rigidement, d’accomplir !) dans le ruissellement dansant du spectre. Le monde s’était replié, resserré sur lui-même ; tout n’était plus qu’entrechoquements, retombées erratiques et joyeuses (mais oui ! car la joie « est« spacieuse ; cf Jean-Louis Chrétien ! en son décisif La Joie spacieuse _ essai sur la dilatation : je le recommande éminemment !) de petits grains de couleurs. Lou s’abandonna, la bouche ouverte, prise d’une envie folle de courir et de crier, de chanter sa joie et sa peur, et incapable d’articuler un son, de faire le moindre geste, offerte (oui ! telle une Danaé à la pluie d’or…) tout entière (oui !) à la pluie lumineuse qui s’enroulait autour d’elle (magiquement et naturellement ! les deux vont de pair : et le poète le « voit« ! telle la Thérèse du livre de Christophe !!!), qui l’enlaçait, la pénétrait comme l’eau la terre meuble, l’entraînant corps et âme (oui ! et elle ne l’oubliera plus !) dans une ronde où elle se démultipliait (voilà : en se dépliant…) à l’infini et finissait (se décentrant ainsi de son « quant-à-elle-même » trop social-bête, en se livrant à cette altérité !) par se perdre ( bien heureusement ! une grâce !) de vue« (pour se déployer « corps et âme« , donc, à jamais…) ;
…
ensuite :
« pas un bruit, si ce n’est le glou-glou des rigoles, le travail obscur, l’odyssée invisible de l’eau, le lent ruissellement, la lente traversée des épaisseurs d’humus vers le silence étale des nappes phréatiques« : ce bonheur d’écriture et de vérité-là se savoure à la page 61 de La Grande Sauvagerie…),
…
« plus rien ne compte que les entrechoquements d’atomes, ces écarts et pas de côté
qui sont tout à la fois la genèse et l’apocalypse, le début et la fin,
toutes choses mêlées, confondues dans la même pluie fine de printemps, donc
…
_ je reprends ici l’envol du récit de Thérèse, cette fois (après celui _ que Thérèse rapporte, en sa mémoire, ou plutôt évoque et reconstitue, avec, aussi, ses nouveaux mots à elle… _ celui de Marie-Lou, avant-guerre, elle, à la page 60) de Thérèse, cette fois, et maintenant !, la plume à la main de ce livre, à la page 87 :
…
« ce livre que vous lisez, dont je suis tout près d’écrire le dernier mot« , dira Thérèse Gandalonie à la page finale de La Grande Sauvagerie, page 154… _,
…
de celles (ces « choses mêlées, confondues dans la même pluie fine de printemps« , donc)
qui exaltent, libèrent toutes les odeurs, tous les parfums (et aussi les saveurs) de la terre,
une petite pluie pénétrante (et fécondante !) qui contient en elle (oui !) l’infinie diversité des formes et des existences » _ eu leur incessant jeu (tant héraclitéen qu’ovidien !) de « métamorphoses« tant obscures, immergées dans la nuit ou reléguées dans l’ombre, que luminescentes : il faut apprendre, aussi, à les recevoir et accueillir, au lieu de les nier et refuser, dénier, pour savoir en toute simplicité, et vérité, les percevoir !.. ;
même si la nièce Thérèse a semblé, un temps, moins habile ou douée pour cela que sa tante (ni Decay, ni Gandalonie, en son enfance des « fonds humides« , elle ; voire des « fosses à purin« , dont elle s’extrait et s’extirpe, « grimpée sur le talus », déjà, page 57…) Marie-Lou ;
…
Thérèse ayant dû, elle, passer par, et accomplir quelques larges détours : tant dans l’espace et le temps (l’histoire autant que la géographie) que dans les « curiosités« (toujours singulières) d’une culture, ultra-fine, incorporée peu à peu, dans l’éclairement patient de quelques lumineux livres ; encore lui a-t-il fallu, aussi, oser s’essayer à l’exercice (insu ! pour commencer) de bien, bien les lire… _ :
…
comme je vous suis, cher Christophe,
en ce lucidissime lucrécianisme !..
…
qui n’est pas sans m’évoquer aussi l’enchantement « électrique« si follement généreux et déployé d’un Walt Whitman ! en son magistralement magique Feuilles d’herbe !.. ;
et fin ici de l’incise lucrécienne ! _,
…
tous
(fruits, fleurs, feuilles, rameaux, branches et frondaisons splendides, caressés, et soulevés, par le vent et la lumière, dans l’univers d’en-haut, et racines et radicelles (à champignons !) continuant leur poussée, dans le monde inverse d’en-bas) _ je reprends et poursuis pour l’achever enfin ma propre phrase ! _
frémissants qu’ils s’agitent,
parties prenantes, et combien ! _ on l’a perçu _, du circuit de la vie,
et féconds…
…
Merci ! de tout cela ! Christophe…